Introduction
Nous marchons dans la voie ouverte par les autres,
D’après leurs sentiments plus que d’après les nôtres.Lucrèce – La Nature des choses – livre V
Faut-il s’étonner tant que, doué d’une voix,
L’homme ait aux sons divers marqué divers emplois,
Selon l’impression dont il fixait l’image?Lucrèce – La Nature des choses – livre V
Le second volume de l’atlas s’était achevé par la colonisation de l’Afrique par l’Homme moderne. Ce troisième volume détaille la suite de son expansion en Eurasie, en Océanie et au seuil du Nouveau-Monde. Avouons-le clairement : notre reconstitution de la préhistoire humaine est très invasionniste ! Il ne s’agit pas d’une position idéologique mais de la conséquence d’un constat : la répartition mondiale des marqueurs génétiques ADN-Y de nos contemporains, ne peut s’expliquer QUE par les migrations de leurs ancêtres ; migrations qu’il faut dater en grande partie du Paléolithique sur la foi des horloges biologiques !
Reconstituer le détail de ces migrations très anciennes nécessite de prendre en compte toutes les données dont nous disposons : les marqueurs génétiques bien sûr, mais aussi la phylogénie linguistique ainsi que les informations contextuelles données par les industries lithiques, par la datation absolue des sites archéologiques et par l’étude des variations climatiques. Il est aisé à bon droit de faire remarquer les insuffisances de chacune de ces sciences dont aucune n’offre – en soi – des précisions suffisantes pour oser se lancer dans une reconstitution continue du passé humain. Cependant, comme des unijambistes qui s’appuieraient les uns sur les autres, elles constituent – ensemble – un cadre très contraint qui limite considérablement le champ des possibles.
Cet atlas est donc un essai : le premier qui ambitionne de retracer en totalité les mouvements des populations humaines paléolithiques, de leurs gènes, de leurs langues et de leurs technologies. Mais avant de détailler ces mouvements au travers d’une série de cartes chronologiques, il convient de nous livrer à plusieurs réflexions qui sont indispensables à la bonne compréhension de la trame historique dont nous proposons la reconstitution.
Chronologie climatique
L’établissement d’une chronologie précise des variations climatiques et une bonne datation des sites archéologiques sont des préalables indispensables à la reconstitution d’une trame historique.
Les glaciations
Comme les autres volumes de l’atlas, le volume n°3 est aussi une histoire du climat. Précisément, il s’agit de l’histoire de la ‘’dernière glaciation’’. Qu’est-ce qu’une glaciation ? Une longue période très froide, bien sûr ! Mais la vraie réponse est plus complexe que cela car une ‘’glaciation’’ doit globalement être appréhendée comme une suite fractale de ‘’moments’’ plus ou moins longs et plus ou moins froids entrecoupés de ‘’moments’’ plus ou moins longs et plus ou moins chauds.
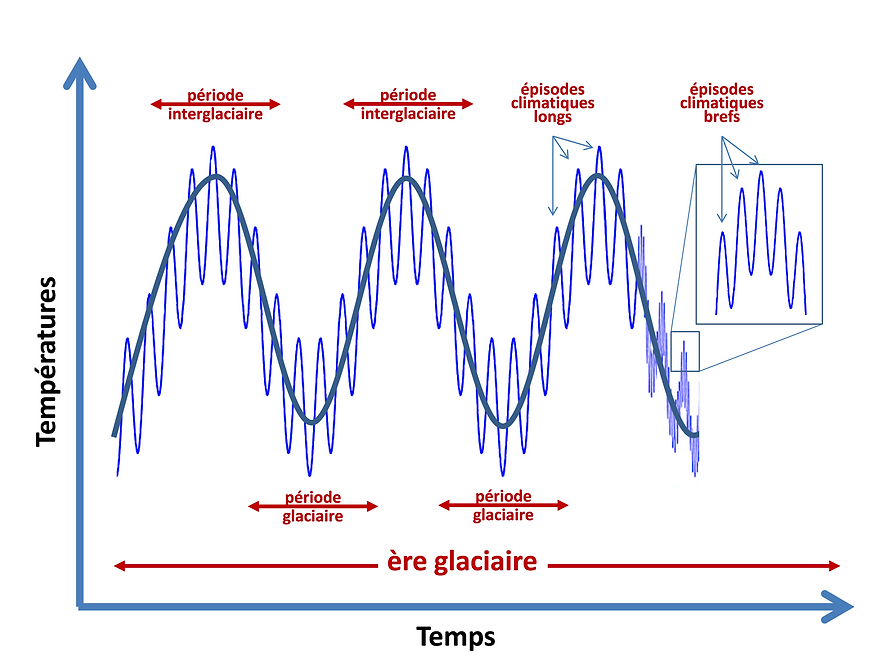
Variations climatiques
Le schéma ci-dessus aidera à comprendre l’emboitement des variations climatiques :
- Au niveau fractal supérieur, se trouve l’ère glaciaire QUATERNAIRE qui commença v. 2.600.000 avant l’ère commune (AEC) et dans laquelle nous vivons toujours [cf. atlas n°2]. Il s’agit d’une étape importante de la vie de notre planète, puisqu’elle est sans équivalent depuis l’ère glaciaire permo-carbonifère qui s’étendit approximativement de 340 à 260 millions d’années avant nous.
- Notre ère glaciaire quaternaire amalgame une alternance de très longues périodes glaciaires et de très longues périodes interglaciaires dont on a commencé à réaliser l’existence passée dès la première moitié du XIX° siècle. Essentiellement définies sur la base d’observations géologiques, ce sont ces périodes glaciaires qui sont le plus couramment appelés ‘’glaciations’’ lorsque l’emploi de ce terme n’appelle pas de plus grande précision. Au début du Quaternaire, le rythme des périodes glaciaires et interglaciaires était irrégulier ; mais depuis 900.000 ans, il est devenu beaucoup plus régulier sans que l’on sache parfaitement pourquoi. En effet, depuis cette époque, une glaciation ‘’moyenne’’ dure environ 80 à 90.000 ans avant d’être suivie par un interglaciaire qui dure entre 10 à 20.000 ans et qui précède à son tour la survenue d’une nouvelle glaciation. Ces grandes périodes glaciaires et interglaciaires du Quaternaire constituèrent la toile de fond de la préhistoire des Humains archaïques [cf. atlas n°2]. Puis, la ‘’dernière’’ glaciation fut le cadre de l’expansion planétaire des Humains modernes et de l’établissement de leurs grands groupes génétiques et ethnolinguistiques ; le présent atlas n°3 couvre exactement la durée de cette ‘’dernière glaciation’’. Dans les publications, elle porte divers noms nationaux qui rappellent les régions où elle a tout d’abord été séparément identifiée : parmi les plus couramment utilisés, on citera les noms de WURM (Alpes), de VALDAI (Russie), de la VISTULE (Europe Centrale), de SARTAN (Sibérie) et de WISCONSIN (Amérique du Nord). Lorsque cette ‘’dernière’’ glaciation prit fin, la période interglaciaire qui suivit permit l’émergence de notre civilisation agricole et urbaine [cf. atlas n°4] ; depuis près de 10.000 ans, nous vivons dans cette période interglaciaire appelée HOLOCENE, sans savoir combien de temps elle durera encore, et cela d’autant plus que les incertitudes sur l’intensité et la durée de l’impact anthropique influent sur le calcul des prévisions.
- Au niveau fractal inférieur, chacune de ces très longues périodes glaciaires peut regrouper plusieurs longs épisodes climatiques alternativement froids et chauds appelés Marine Isotope Stage (MIS) ou Oxygen Isotope Stage (OIS) parce que leur étude est basée sur la proportion des isotopes de l’oxygène dans les sédiments marins. Dans l’atlas n°2, nous avons déjà rencontré ces MIS qui portent un numéro pair lorsque la proportion d’oxygène 18 est élevé (i.e. indicateur d’un climat globalement froid) et un numéro impair lorsque la proportion d’oxygène 16 est élevé (i.e. indicateur d’un climat globalement chaud). La ‘’dernière glaciation’’ – définie sur des critères géologiques continentaux – regroupa quatre stades isotopiques marins : la fin du MIS 5 (MIS 5d à 5a, collectivement appelés Primiglaciaire dans cet atlas), le MIS 4 (Premier Pléniglaciaire, au cours duquel le froid fut intense), le MIS 3 (Interpléniglaciaire, au cours duquel le climat fluctua autours d’une moyenne tempérée mais moins chaude que celle de notre époque) et le MIS 2 (regroupant le Second Pléniglaciaire, qui fut encore plus froid que le premier, et le Tardiglaciaire pendant lequel le climat se réchauffa progressivement au travers d’une série d’oscillations). Dans ce système numéroté qui remonte le temps, notre interglaciaire Holocène est le MIS 1.
- Au niveau fractal sous-jacent, chaque MIS est lui-même finement composé d’une série de grandes oscillations climatiques froides puis chaudes qui durent chacune quelques milliers d’années. Les phases froide sont appelées ‘’stades’’, tandis que les phases chaudes qui les séparent sont appelées ‘’interstades’’. Leur rythme est irrégulier et les températures moyennes reconstituées apparaissent souvent différentes d’une oscillation à l’autre. De ce fait, au cours de toutes les glaciations, il a existé des stades très froids et d’autres où le froid était modéré ; de même, certains interstades ont été très chauds, tandis que d’autres étaient au contraire très frais.
- On peut encore descendre d’un cran l’ordonnancement fractal des variations climatiques, car aucune période climatique – longue ou courte – ne fut jamais uniforme tout au long de sa durée. Dans le détail, chacun des ‘’stades’’ et ‘’interstades’’ fut en réalité l’addition de plusieurs petites oscillations froides puis chaudes qui ne durèrent souvent que quelques siècles voire quelques décennies seulement, et dont il arriva que certaines soient très contrastées.
- Cela ne devrait pas nous étonner. Pour s’en persuader, il suffit de se reporter aux variations climatiques enregistrées dans l’histoire récente bien connue des deux derniers millénaires (cf. le petit âge de glace) ; et plus finement encore, penser aux variations que nos courtes vies nous permettent d’observer : lorsque des hivers glaciaux succèdent à des hivers doux, ou lorsque des étés froids et pluvieux succèdent à des étés secs et caniculaires. Au plus petit échelon du système fractal, on terminera notre survol de l’instabilité climatique en faisant remarquer que nos saisons trimestrielles compilent elles-mêmes des moments climatiques très divers : d’un jour à l’autre et même d’une heure à l’autre …
Chronologie de la dernière glaciation
Il serait illusoire d’espérer reconstituer l’histoire des Humains du Paléolithique supérieur si l’on ne pouvait pas établir un cadre chronologique solide. Pendant longtemps, nous avons seulement disposé des chronologies relatives dont il vient d’être question ci-dessus et dont la séquence complète n’a jamais cessé de faire l’objet de controverses, parce qu’une oscillation donnée peut avoir laissé des traces très marquées dans un pays, tandis que les traces sont assez discrètes dans un autre et qu’elles sont même totalement absentes dans un troisième pays dont l’histoire climatique et géologique a été différente. Dans une certaine mesure, ce flou perturbateur obscurcit encore les publications modernes. Heureusement, des méthodes de datations isotopiques des sédiments ont fait leur apparition il y a déjà plus de 60 ans, générant un nombre toujours croissant de datations BP (Before Present). Malheureusement, ces méthodes comportent des marges d’erreurs importantes qui s’accroissent avec le temps au point de générer des résultats ininterprétables au-delà de 40 à 50.000 ans avant nous ; marges d’erreurs qui accentuent la difficulté à transposer des fourchettes de dates isotopiques en de véritables dates calendaires exprimées en années Avant l’Ere Commune (AEC). Heureusement, les glaciologues ont ramené à la surface de très longues carottes de glace qui nous ont enfin livré la chronologie calendaire détaillée de tous les épisodes chauds et froids survenus depuis le dernier interglaciaire ; et qui nous donnent aussi des précisions quant à leur intensité. En pratique, qu’elles proviennent de forages profonds entrepris en Antarctique ou au Groenland, les archives glaciaires se correspondent étroitement ; attestant la fiabilité de la méthode. Dans cet atlas, c’est la chronologie glaciaire du Groenland qui sera sollicitée pour dater précisément les stades et les interstades de la ‘’dernière glaciation’’ ; ce système est bâti sur l’alternance de périodes froides appelées Greenland Stadial (GS) et de périodes chaudes appelées Greenland Interstadial (GI). Désormais munis de cette chronologie solide et précise, il nous reste encore à la faire étroitement coïncider avec les stades (froids) et les interstades (chauds) traditionnellement repérés par l’étude des sédiments continentaux et marins. Ces interprétations suscitent parfois des reconstructions légèrement différentes d’un auteur à l’autre, mais sans que cela traduise toujours un désaccord fondamental ; en effet, essentiellement en ce qui concerne les époques les plus anciennes, il peut arriver qu’un chercheur fasse commencer un stade donné par un épisode froid qu’il estime significatif, tandis qu’un autre chercheur considérera ce même épisode climatique comme une simple oscillation froide qui faisait encore partie intégrante de l’interstade tempéré précédent. Cela ne doit pas nous étonner : il en va ainsi des nombreux seuils artificiels que notre besoin de classification nous pousse à établir au long de tous les processus continus ou oscillatoires …
Sans prétendre, donc, refléter un consensus qui n’a pas fini de se construire et qui ne pourra l’être qu’en acceptant une part d’arbitraire consenti, l’atlas n°3 propose un cadre chronologique détaillé de tous les épisodes froids et chauds significatifs qui sont survenus entre la fin de l’Eémien (i.e. MIS 5e, le précédent Interglaciaire par lequel se conclut l’atlas n°2) et le début de l’Holocène (i.e. MIS 1, l’Interglaciaire auquel notre siècle appartient et dont l’atlas n°4 retrace les débuts). Chacune des cartes de l’atlas n°3 décrivant aussi précisément que possible la géographie changeante de ces stades et interstades qui sont datés aussi précisément que possible.
Routes de migration et climat
Dans cet atlas, nous situons l’arrivée des Humains modernes en Eurasie au cours du MIS 5d, c’est-à-dire pendant la première grande offensive du froid qui inaugura la dernière glaciation et qui eut pour effet de réduire la largeur du détroit de Bab-el-Mandeb séparant la corne de l’Afrique du Yémen.
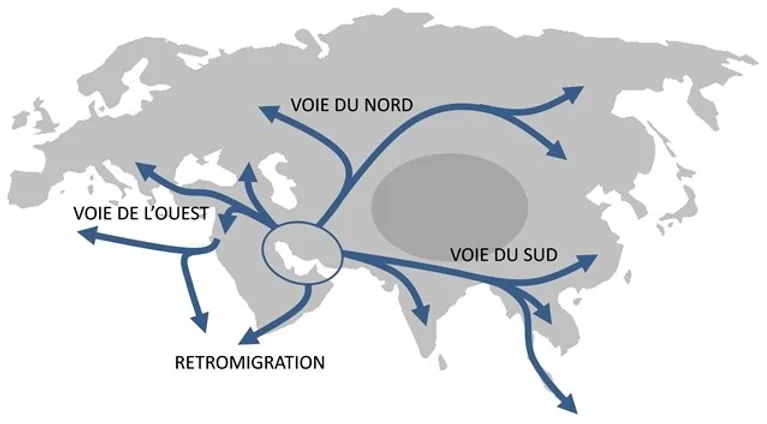
Rétromigration
Sans entrer dans les détails de la reconstitution historique qui sera abordée carte après carte, on avancera simplement ici que, récemment sortis d’Afrique, les premiers Humains modernes du Moyen-Orient n’étaient pas adaptés à un climat froid. C’est pourquoi il est probable qu’ils ne purent tout d’abord migrer qu’en direction de l’Est, en longeant le chaud littoral iranien avant de pénétrer aux Indes puis de déboucher dans la péninsule indochinoise qui était alors prolongée par la vaste étendue du Sunda (réunion au continent asiatique de tout le plateau émergé des îles de la Sonde). Cette route qui conduit en Extrême-Orient est ici qualifiée de ‘’voie du Sud’’. Dans l’atlas n° 2, nous avons vu que cette ‘’voie du Sud’’ peut poser le problème du franchissement de l’immense delta du Gange et du Brahmapoutre (Sundarbans) et de la forêt tropicale qui lui fait suite sur son flanc Est ; toutefois, les Sundarbans disparaissent presque totalement pendant les périodes glaciaires intenses (sécheresse) et peuvent alors être franchis, tandis que l’étendue de la forêt tropicale régresse.
Plus tard, à partir du MIS 3, leur technologie progressant – et peut-être leur adaptation biologique aussi –, il est certain que des Humains modernes d’Eurasie parvinrent à survivre et à prospérer jusqu’à des latitudes élevées qui auraient été fatales à leurs ancêtres africains tropicaux. A partir de cette époque, ils eurent d’une part la possibilité de coloniser l’Europe en empruntant une ‘’voie de l’Ouest’’, et d’autre part la possibilité de se répandre dans tout le système des steppes asiatiques en empruntant une ‘’voie du Nord’’ qui constitua dès lors une route alternative pour atteindre l’Extrême-Orient. Tout cela ne heurte pas la logique : pour aller en Extrême-Orient par voie de terre en partant du Moyen-Orient, il n’existe toujours que deux possibilités : soit contourner le massif tibétain par le Sud, soit le contourner par le Nord. Régulièrement, tout au long de l’atlas n°3, nous invoquerons l’une ou l’autre de ces routes pour expliquer la répartition actuelle des haplogroupes ADN-Y, et nous constaterons souvent qu’elles furent empruntées concomitamment par des peuples de même origine, lors de chacune des pulsations migratoires qui déborderont régulièrement d’un trop-plein humain moyen-oriental. Une quatrième voie de migration – moins arpentée que les autres en raison de la très longue sécheresse glaciaire – fut celle qui, par le littoral arabe, conduisit un groupe humain à retourner précocement en Afrique au début du Premier Maximum Glaciaire. Un tel mouvement de retour sur le continent originel est qualifié de ‘’rétromigration’’ ; le Tardiglaciaire et l’Holocène en connaitront d’autres [cf. atlas n°4].
Marqueurs génétiques profonds
Notre génome est un système de stockage d’information qui repose sur la molécule d’ADN. Chez les animaux, l’ADN est organisé en deux ensembles distincts : celui qui est contenu dans le noyau de nos cellules (ADN nucléaire, replié en plusieurs paires de chromosomes) et celui qui est contenu dans les mitochondries de nos cellules (ADN mitochondrial). A chaque génération, un individu hérite de la moitié de l’ADN nucléaire de son père et de la moitié de celui de sa mère, ce dont résulte des caractéristiques physiques et comportementales qui sont un mélange hétérogène de celles de ses deux parents. Au fil des générations, les brassages successifs finissent par être tellement importants, qu’il est mathématiquement possible qu’un aïeul ne laisse AUCUN gène à ses descendants directs à partir de la 15ème génération. Il y a cependant deux exceptions à cette dilution rapide de notre ADN : l’ADN de nos mitochondries et l’ADN d’une petite portion du chromosome Y se transmettent l’un et l’autre de génération en génération sans jamais être brassés.
Les haplogroupes basés sur l’ADN mitochondrial (ADN-mt)
La première exception concerne l’ADN mitochondrial ou ADN-mt, ainsi appelé parce qu’il est celui que contiennent les mitochondries de nos cellules. Parce que seules les mères sont capable de transmettent des mitochondries à leur progéniture, il en résulte que chacun d’entre nous – que nous soyons homme ou femme – possède des mitochondries qui sont INTEGRALEMENT héritées de notre mère ; et, avant elle, de toute la colonne de ses ancêtres MATRILINEAIRES exclusivement. L’analyse de notre ADN mitochondrial nous renseigne donc in fine sur celui de la mère de la mère de la mère [etc.] de notre mère ; et cela jusqu’à une femme théorique – mais dont l’existence fut pourtant bien réelle – que l’on appelle familièrement ‘’Eve mitochondriale’’ parce qu’elle fut à l’origine de TOUTES les variantes de l’ADN mitochondrial observées chez la TOTALITE des Humains contemporains des deux sexes. La période à laquelle vivait cette femme – qui est notre aïeule matrilinéaire à TOUS –, varie selon les calculs mais pourrait se situer plus de 150.000 ans avant nous et peut-être bien plus, jusque v. 500.000 ans. A partir d’elle – dans la mesure où des mutations (i.e. des modifications de séquence) apparaissent de temps à autre sur l’ADN-mt et se transmettent à la descendance –, on peut reconstituer une immense famille humaine matrilinéaire qui se divise en grosses branches principales, puis se ramifie en de nombreuses sous-branches de plus en plus fines ; et cela jusqu’à chacun d’entre nous qui sommes les feuilles de cet arbre gigantesque. Ainsi, lorsque l’on compare deux individus de notre temps, on peut estimer l’époque où vivait leur dernière ancêtre matrilinéaire commune ; et si l’on dispose d’informations sur les lieux d’origine des ancêtres récents de ces individus contemporains, on peut essayer de se faire une idée de la région où vivait cette aïeule commune ou les autres femmes qui nous relient à elle.
Les haplogroupes basés sur l’ADN du chromosome Y (ADN-Y)
La seconde exception à la dilution de l’ADN au fil des générations concerne un segment particulier du chromosome Y, dont chacun sait qu’il n’est présent que chez les hommes (mâles). Lors de la fabrication des cellules sexuelles mâles, tout le matériel génétique nucléaire (i.e. non mitochondrial) – organisé en 23 paires de chromosomes – subit une ‘’recombinaison’’, c’est-à-dire un intense brassage de l’ADN de chacune des paires, en préalable à une division cellulaire qui réduit de moitié le matériel génétique ; il en résulte la création de deux ‘’demi-cellules’’ (spermatozoïdes) qui – à l’issue d’une relation sexuelle – chercheront à fusionner avec une autre ‘’demi-cellule’’ complémentaire (ovule) afin de créer une nouvelle cellule complète (œuf) ; cette dernière étant à l’origine d’un nouvel individu (enfant). Or, une petite portion du chromosome Y est systématiquement épargnée par le brassage génétique. Ce sont les variations mutationnelles de cette portion ‘’non recombinante’’ qui constituent ce que l’on appelle des ‘’marqueurs ADN-Y’’ ; marqueurs qui ne sont donc présents que chez les hommes (mâles) et qui ne peuvent être hérités que de père en fils. Ces marqueurs constituent des HAPLOGROUPES ADN-Y (séries de gènes transmis ensemble). Aujourd’hui, ces haplogroupes ADN-Y sont très diversifiés ; mais lorsqu’on remonte à l’origine patrilinéaire des TOUS les hommes actuels, on converge peu à peu vers un unique homme théorique – dont l’existence fut pourtant bien réelle – que les médias ont appelé ‘’Adam Y’’ et les chercheurs « Plus Récent Ancêtre Commun-Y » (Y-MRCA, Y – Most Recent Common Ancestor). La période à laquelle cet homme vivait varie selon les calculs, mais pourrait avoir été située environ 300.000 avant nous. Comme dans le cas de l’ADN mitochondrial, les mutations accumulées au fil des générations sur l’ADN-Y de notre ancêtre commun ont tout d’abord défini des grosses branches dans l’arbre généalogique patrilinéaire de l’Humanité ; puis celles-ci se sont ramifiées de plus en plus finement, jusqu’à parvenir à chacun des hommes (mâles) contemporains qui sont comme les feuilles de cet immense arbre. Pour se représenter sa ramure, on peut parfaitement s’appuyer sur le modèle classique d’un arbre généalogique qui serait exclusivement axé sur la lignée patrilinéaire (i.e. le nom de famille) . L’histoire détaillée de ces ramifications et des mouvements de leurs porteurs constitue précisément le sujet de l’atlas n°3 tout entier.
Cette nouvelle science des haplogroupes ADN-Y est très récente. Elle a surtout décollé à partir de 2005 ; vers 2010, on commençait déjà à avoir une certaine idée de leur répartition mondiale actuelle ; enfin, depuis 2015 environ, grâce au développement de l’archéogénétique – c’est-à-dire via l’ADN conservé dans les os et surtout dans les dents des fossiles –, nous commençons même à appréhender leur répartition à dates anciennes et très anciennes, y compris à dates paléolithiques. On voit que le progrès est très rapide dans ce domaine. Dans l’atlas n°3, les haplogroupes ADN-Y sont identifiés selon la nomenclature ISOGG 2018. Il est important de bien prendre acte de cela car la nomenclature des haplogroupes a rapidement évolué, avec deux changements majeurs survenus au cours des 10 ans écoulés seulement ! Ainsi, un lecteur qui souhaiterait confronter à des travaux scientifiques originaux les données que nous présentons dans l’atlas, pourrait être dérouté en découvrant des haplogroupes ADN-Y dénommés tout autrement ! Et cela, y compris lorsque ces travaux remontent à quelques années seulement ! Si le lecteur en a la patience, il lui faudra alors se rapporter aux tables de conversions retraçant l’évolution progressive du système ISOGG.
Génétique psychologique évolutionniste
La reconstitution des mouvements humains préhistoriques proposée dans l’atlas n°3 est exclusivement basée sur les haplogroupes ADN‑Y (transmission patrilinéaire) et non pas sur les haplogroupes ADN-mt (transmission matrilinéaire) ; au motif que les premiers sont bien davantage porteurs d’histoire évènementielle que les seconds.
Il convient d’expliquer une affirmation aussi forte. Et cette explication passe tout d’abord par un long préambule qui va nous confronter à l’une des faces les plus sombres de notre Humanité : un aspect de notre nature que les Sciences Humaines et Sociales ont longtemps rejeté mais que l’observation de nos proches parents Chimpanzés, la relecture des récits ethnologiques anciens, l’archéologie moderne et un regard détaché sur notre comportement dans le Monde actuel ne nous permettent plus d’ignorer.
La guerre est un puissant vecteur de gènes
Nous nous représentons parfaitement les comportements meurtriers et cruels que la guerre implique parce que l’histoire ancienne, l’histoire récente et le quotidien médiatique ne nous permettent pas de les ignorer. Mais une fois les grandes émotions et les grands principes philosophiques mis de côté, la guerre peut simplement apparaître comme une lutte organisée entre deux groupes qui cherchent à contrôler les ressources d’un territoire dont chacun des deux estime avoir besoin pour son propre développement égoïste. Ce faisant, chez les Humains modernes comme chez les Chimpanzés, la guerre apparait comme un important arrière-plan du flux génique. Devant l’importance des similitudes que nous allons pointer entre nos deux espèces, il est hautement probable qu’un comportement guerrier de même type caractérisait aussi les Humains archaïques.
Chez les Chimpanzés
La conquête de nouveaux territoires et de leurs ressources anime tous les Animaux et même tout le Vivant. Chez la plupart des espèces animales, les luttes se résument à des duels, le plus souvent entre mâles. Mais en dehors de l’Homme, peu d’animaux font la guerre au sens groupal qui vient d’être dit. C’est pourtant le cas des Chimpanzés, c’est-à-dire de l’une des deux espèces dont nous sommes génétiquement les plus proches ; espèce qui partage avec la nôtre la caractéristique que les mâles non seulement se tolèrent entre eux, mais sont également capables d’aller bien plus loin que cela en nouant des alliances centrées sur l’amitié et sur ses à-côtés utilitaires que sont les stratégies de chasse, la conquête des femelles et la conquête ou le maintien d’un pouvoir politique sur le groupe d’appartenance. Il faut souligner que de telles alliances entre mâles sont assez rares chez la plupart des autres Mammifères. Chez les Chimpanzés, les mâles d’un même clan sont philopatriques, c’est-à-dire restent toute leur vie dans leur communauté de naissance ; ce dont il résulte qu’ils sont tous apparentés en lignée patrilinéaire. Soudés par ces liens de famille et par des camaraderies durables établies depuis l’enfance, ils ont l’habitude de chasser ensemble les Colobes sous la conduite d’un mâle dominant qui leur tient lieu de chef ; chasse qui leur permet de se familiariser avec les stratégies collectives dont ils pourront ensuite profiter en d’autres occasions de la vie. En effet, bien organisés et bien coordonnés, ces mâles veillent à l’intégrité de leur territoire tribal, en patrouillant régulièrement à ses frontières. Au cours de ces rondes, lorsque le risque leur parait acceptable, ils se mettent parfois à explorer la périphérie d’un territoire voisin ; probablement parce qu’ils convoitent les ressources de ce territoire. Dans cette interface, s’ils se sentent en force, ils attaquent par surprise les mâles étrangers qui commettent l’étourderie mortelle de se déplacer seul dans la banlieue de leur domaine. Tuer les ennemis un par un, en catimini, est la stratégie guerrière la moins risquée et la plus efficace parce que – dans les petites communautés de quelques dizaines d’individus – elle peut faire diminuer assez rapidement les capacités de résistance des voisins, c’est-à-dire des ennemis. Puis, lorsqu’ils se sentent suffisamment en force, les attaquants prennent solidement possession des arbres fruitiers situés sur un secteur donné du territoire du clan adverse, et se préparent à affronter les mâles indigènes qui arrivent alors en groupe pour essayer de les en déloger parce que ces arbres sont indispensables à l’alimentation de leur clan … Les attaques des intrus en position de force sont violentes, avec l’objectif évident de tuer un maximum d’ennemis et de s’emparer de tout ou partie de leur territoire ; c’est-à-dire de leurs ressources. Avec l’objectif, aussi, de s’emparer de leurs femelles. Car après la bataille, lorsque les mâles adverses sont vaincus, c’est-à-dire morts ou enfuis, leurs femelles se retrouvent alors au pouvoir des vainqueurs. Impuissantes à les défendre, leurs petits sont souvent tués et dévorés sur le coup, tandis qu’elles sont tabassées et violées ; mais survivent cependant le plus souvent à ces mauvais traitements. Comme elles présentent un intérêt sexuel, les mâles vainqueurs les laissent alors s’intégrer à leur bande, mais cela à un niveau inférieur de la hiérarchie des femelles, parce que les femelles de la bande victorieuse veillent jalousement au maintien de leur rang social. Alors, les femelles vaincues n’ont pas d’autre choix que d’accepter ce triste destin qu’on leur offre, puisqu’elles ne sont pas en mesure de survivre sans le support d’un groupe organisé, fut-il maltraitant au début31. Mais si elles ont la chance de plaire à desMais si elles ont la chance de plaire à des mâles vainqueurs dominants et si elles ont la chance de mettre au monde des fils, elles parviendront parfois à se ménager un statut plus envié dans leur communauté ‘’d’accueil’’ ; surtout si leurs fils arrivent un jour à faire partie des mâles les plus en vue de la jeune génération32. Ainsi, chez les Chimpanzés, on constate que la guerre est bien un arrière-plan du flux génique.
Chez les Humains anciens
L’archéologie préhistorique et protohistorique moderne met au jour ou réinterprète de plus en plus de vestiges dont l’explication la plus rationnelle oblige à invoquer des violences intercommunautaires, c’est-à-dire des guerres primitives. Mais pour avoir des données vécues sur le déroulé des opérations, il suffit de se tourner vers l’ethnologie des peuples subactuels qui fournissent un constat éloquent : sur tous les continents, les récits des anciens explorateurs décrivent des guerres primitives qui ressemblent au détail près à ce qui vient d’être relaté pour les Chimpanzés. A la différence près que les Humains sont capable de formuler des raisons à ces conflits. Parmi ces raisons – qui sont toujours les mêmes – on évoquera pêle-mêle : des catastrophes économiques (i.e. ‘’Il faut envahir le voisin parce que sinon on va mourir de faim !’’) ; des catastrophes démographiques (i.e. ‘’Nous sommes trop nombreux pour notre territoire ; il faut envahir le voisin pour que tous nos enfants puissent s’établir dans la vie !’’) ; le besoin en certaines ressources (i.e. ‘’Il faut envahir le voisin parce qu’il possède un bon gisement de silex!’’) ; un rapport de force favorable, qu’il soit technologique ou démographique (i.e. ‘’C’est le meilleur moment pour attaquer préventivement le voisin tant que nous sommes plus forts que lui !’’) ; des ambitions individuelles de la part de seconds couteaux (i.e. ‘’Ce sont nos frères qui sont les chefs de notre tribu ; si nous voulons devenir des chefs nous aussi, nous devons nous emparer du territoire voisin’’) ; des désirs de progression sociale (i.e. ‘’Pour devenir membre du conseil tribal, je dois rapporter trois têtes ennemies’’) ; un manque de femme (i.e. ‘’Tous nos garçons ne parviennent pas à se marier ; il nous faut leur trouver des épouses gratuites chez nos voisins’’ ; des chimères oraculaires (i.e. ‘’Les voisins pratiquent la sorcellerie contre nous ; le Grand Faucon nous demande de les punir’’)… Toutes ces variations sur le thème de la convoitise étant systématiquement justifiées par l’infernal cycle de la vengeance qui vient répondre aux nombreuses avanies que les voisins nous ont précédemment fait subir au cours d’une longue suite de conflits incessants, grands et petits. Toute l’ethnologie et toute l’histoire ancienne nous montrent que, chez les Humains pré-étatiques, la norme c’était la guerre ; pas la paix ! Au point que ces guerres tribales étaient quasi annuelles, tant étaient nombreuses les occasions de conflits que nous venons de lister. De telles guerres d’allure primitive existent d’ailleurs toujours chez les Humains actuels dont les pays traversent une période d’instabilité résultant de la faillite d’un pouvoir central. En valeur absolue, ces guerres primitives ou d’allure primitive étaient (sont) plus meurtrières que les guerres qui opposent des états nations organisés. De fait, elles se terminaient souvent en génocide de la tribu vaincue ; mais en général en génocide asymétrique, puisque l’extermination concernait bien davantage les hommes vaincus que les femmes vaincues. Cependant, contrairement à ce qui se passe chez les impitoyables Chimpanzés qui tuent tous les mâles ennemis lorsqu’ils le peuvent, le génocide des mâles vaincus était souvent partiel chez les Humains pré-étatiques, parce que ceux-ci avaient tendance à épargner les jeunes garçons ‘’ennemis’’ afin de les intégrer à leur société en tant que main d’œuvre gratuite, économique ou militaire. Au XIX° siècle, l’un des premiers missionnaires aventurés en Nouvelle-Zélande rapporta cette invective qu’un chef Maori lança en sa présence à la tête d’un chef ennemi qu’il venait de vaincre :
– Tu voulais t’enfuir n’est-ce pas ? Mais ma massue t’a rattrapé !
– Tu as été cuisiné et tu es devenu ma nourriture !
– Et où est ton père ? Il a été cuisiné !
– Et où est ton frère ? Il a été mangé !
– Et où est ta femme ? Elle est là ! Maintenant c’est l’une de mes femmes !
– Et où sont tes enfants ? Les voilà ! Ils travaillent pour moi ! Ce sont mes esclaves !
Avec plus d’éloquence qu’un rapport ethnologique, ce chef victorieux racontait parfaitement la mécanique crue des guerres primitives et nous invitait à méditer sur leur conséquences en terme de devenir des peuples : les hommes d’une tribu vaincue sont (presque tous) tués et ne peuvent donc plus faire d’enfants ; tandis que les femmes d’une tribu vaincue sont épargnées pour les besoins du sexe et donnent, par conséquent, des enfants aux hommes de la tribu victorieuse… Ainsi, chez l’Humain comme chez le Chimpanzé, la guerre est bien un important arrière-plan du flux génique.
Les haplogroupes ADN-Y dans la guerre
Ce que nous venons de décrire est ce qui a été moult fois observé dans les sociétés primitives des siècles derniers. Il est possible que dès le Mésolithique, les vainqueurs aient commencé à épargner certains hommes adultes vaincus, pour les besoins d’un esclavage de prestige encore limité. Mais c’est surtout à partir du Néolithique que les vainqueurs auront tendance à épargner un plus grand nombre de vaincus, pour les besoins d’un esclavage productiviste devenus très concrets. Il serait possible de confirmer scientifiquement cette affirmation en étudiant – pour chaque époque et dans chaque région du Monde – la diversité archéogénétique des haplogroupes ADN-Y ; on verrait alors probablement qu’aux temps paléolithiques (sociétés non-accumulatrices et non-productivistes), un haplogroupe ADN-Y victorieux éliminait presque tous les haplogroupes ADN-Y vaincus (situation génocidaire masculine quasi-totale, à l’exception de certains petits garçons parfois intégrés), alors qu’aux temps mésolithiques (sociétés accumulatrices et non-productivistes) et plus encore aux temps néolithiques (sociétés productivistes et accumulatrices), un haplogroupe ADN-Y victorieux laissait subsister une fraction plus importante des haplogroupes ADN-Y vaincus, se contentant de les reléguer provisoirement tout en bas de la nouvelle société. Plus près de nous encore, aux temps ‘’des métaux’’ et de l’histoire antique (sociétés très-productivistes et très-accumulatrices), cette ‘’clémence utilitaire’’ continua d’être exercée à grande échelle par les vainqueurs sur les vaincus ; mais à ces époques plus récentes et déjà proches de la nôtre, chacun de ces partenaires inégalitaires étaient déjà devenu le produit complexe d’une succession des mélanges haplogroupaux ADN-Y qui étaient survenus aux époques antérieures. Dans ce contexte historique déjà avancé, l’ancienne relation ‘’un groupe ethnolinguistique donné = un haplogroupe ADN-Y donné’’ avait depuis longtemps cessé d’être absolue. C’est la raison pour laquelle les groupes ethnolinguistiques actuels sont toujours composés de porteurs d’haplogroupes ADN-Y divers, et la raison pour laquelle il est devenu impossible de lier étroitement les langues et les gènes dans le Monde d’aujourd’hui, alors que langues et gènes (i.e. haplogroupes patrilinéaires plus souvent que matrilinéaires) étaient probablement étroitement associés au début de l’expansion des Hommes modernes en Eurasie [cf. linguistique ci-dessous].
Génétique historique
Le cadre universel des relations vainqueurs / vaincus étant posé en tant que mécanisme psychologique évolutionniste inscrit depuis au moins 7.000.000 d’années dans le comportement de la lignée humaine – et la précision étant apportée que nous ne parlons pas ici des états nations modernes mais des bandes hiérarchisées et des chefferies primitives qui furent jusqu’à l’antiquité le seul mode d’organisation que connurent les Humains –, il nous reste à examiner comment les proportions d’haplogroupes ADN-Y (transmission patrilinéaire) que nous observons dans une région donnée, peuvent nous aider à reconstituer une histoire évènementielle des temps oubliés.
Portée historique évènementielle des haplogroupes ADN-Y
A la première génération, quand des hommes étrangers victorieux s’installent sur un territoire dont ils viennent de s’emparer, nous venons de voir qu’ils éliminent ou marginalisent les hommes indigènes vaincus et se mettent à faire des enfants avec leurs veuves et avec leurs filles ; peu importe pour cela que ces femmes deviennent les épouses légales des vainqueurs ou qu’elles soient cantonnées dans le rôle de simples concubines officielles (entretenues) ou non officielles (servantes). Du fait de la polygamie des cadres dirigeants – que celle-ci soit de droit ou de fait selon les cultures – les hommes vainqueurs – évidemment tous considérés comme dominants et disposant de ce fait d’un pouvoir sexuel plus étendu que les autres –, répandent rapidement leurs haplogroupes ADN-Y puisqu’ils ont la possibilité de devenir pères de nombreux fils avec le concours volontaire ou involontaire de toutes ces femmes. De leur côté, les hommes indigènes qui ont survécu à leur défaite, ont été relégués tout en bas de la nouvelle société issue de la conquête ; par conséquent, ils ont nécessairement moins de femmes et donc moins de fils .
A la seconde génération, les fils des conquérants se retrouvent systémiquement en position éminente dans la nouvelle société. Car même si leur mère n’était qu’une simple concubine, ils ont tendance à mieux tirer leur épingle du jeu que les fils des purs indigènes, et se situent alors à un niveau social intermédiaire, aux côtés des quelques purs indigènes qui ont réussi à se faire intégrer. Or, tous les fils des conquérants – qu’ils soient les jeunes princes héritiers qui succèdent directement à leurs vieux pères fondateurs de la nouvelle nation, ou bien seulement leurs demi-frères placés en position sociale intermédiaire – portent nécessairement les haplogroupes ADN-Y des conquérants. Naturellement, puisqu’ils sont les cadres dirigeants et les cadres intermédiaires de la nouvelle société qui se reconstruit, tous ces individus de la deuxième génération sont favorisés pour le sexe et vont à leur tour avoir de nombreux fils qui hériteront leur haplogroupe ADN-Y.
De sorte que dès la troisième génération après la conquête, les haplogroupes ADN-Y intrusifs commencent à représenter une fraction significative de tous les haplogroupes ADN-Y de la population totale, voire peuvent déjà être devenus majoritaires si très peu d’hommes indigènes avaient initialement été épargnés. Ainsi, lorsque la victoire des envahisseurs est totale et définitive, on voit que moins de 100 ans peuvent suffire pour qu’un haplogroupe ADN‑Y jusque-là totalement absent d’une région donnée, devienne majoritaire voire exclusif dans cette même région. Les variables pertinentes étant 1) le nombre total des hommes envahisseurs rapporté au nombre total des hommes indigènes épargnés ; et 2) le ‘’rendement’’ reproducteur différentiel de chacune de ces deux sortes d’hommes. Ce rendement reproducteur étant beaucoup plus élevé chez les ‘’élites’’ sociales, l’ADN-Y étranger diffuse donc rapidement dans la société toute entière, et cela y compris lorsqu’un nombre significatif d’hommes indigènes avait été épargné lors du conflit refondateur ; dans ce dernier cas, le remplacement des haplogroupes ADN-Y est simplement un peu moins rapide et un peu moins complet.
Au cours des générations suivantes, s’ils ne sont pas déjà devenus majoritaires ou exclusifs, les haplogroupes ADN-Y intrusifs vont continuer à diffuser à tous les niveaux de la société, c’est-à-dire pas seulement chez les cadres supérieurs et les cadres intermédiaires, mais aussi parmi le peuple. Cela s’explique facilement parce que les hommes accoutumés au sexe facile ne se préoccupent pas nécessairement du devenir individuel de tous les enfants engendrés lors de rencontres ancillaires et de passage ; mais aussi, et surtout, parce que les hommes porteurs des haplogroupes ADN-Y intrusifs sont désormais devenus très nombreux dans la population totale, et que chacun d’entre eux ne peut pas être un cadre dirigeant, ni même un cadre intermédiaire, dans un rapport numérique qui banalise de plus en plus les haplogroupes intrusifs ! Ainsi, bien qu’étant – tout comme leurs Princes – de purs descendants patrilinéaires des glorieux conquérants étrangers, les moins chanceux de ces hommes porteurs des haplogroupes ADN-Y intrusifs vont progressivement rejoindre les rangs des subalternes, où ils se mêlent aux descendants patrilinéaires des purs indigènes autrefois vaincus. Cette dégringolade sociale inévitable a pour conséquence que les nouveaux haplogroupes ADN-Y sont désormais installés à tous les niveaux de la nouvelle société … Le schéma ci-dessous illustre ce phénomène de remplacement. Les carrés orange représentent les hommes envahisseurs (d’éventuelles femmes envahisseurs ne sont pas figurées). Les carrés bleus et les ronds bleus représentent respectivement les hommes et les femmes indigènes. Les femmes ne sont plus figurées à partir de la deuxième génération qui suit la conquête.
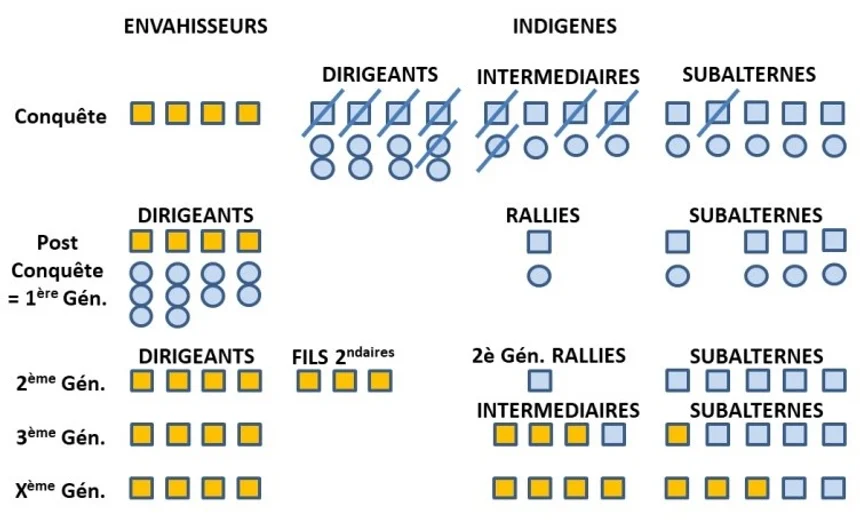
Envahisseurs et indigènes
Puis, passe encore le temps … Quelques générations de plus, et le souvenir traumatique de la conquête s’est évanoui des mémoires ou est entré dans la légende nationale chantée rituellement lors des occasions solennelles ; la société fonctionne de nouveau ‘’normalement’’, comme si rien ne s’était jamais passé ; toute la population a de nouveau le sentiment profond de former un seul groupe ethnoculturel homogène et parfaitement indigène, puisque chacun peut se prévaloir à juste titre de vivre dans le pays des pères de ses pères et des mères de ses mères … Mais le paysage génétique a pourtant complètement changé car les haplogroupes ADN-Y intrusifs ont pratiquement remplacé tous les autres ! Avec le temps, la proportion de ces haplogroupes ADN-Y intrusifs et des anciens haplogroupes ADN-Y indigènes a fini par se stabiliser dans la population ; et cette proportion pourra demeurer stable pendant des milliers d’années si aucune nouvelle invasion significative (par des hommes porteurs d’haplogroupes ADN-Y différents) ne vient rééditer toute la séquence des évènements que nous avons décrite.
Reconstituer une histoire évènementielle des temps oubliés
On comprend donc pourquoi les haplogroupes ADN-Y sont porteurs d’histoire évènementielle : lorsque 1) un haplogroupe ADN-Y se répand dans une région dont il était absent auparavant, et que 2) les haplogroupes ADN-Y locaux s’effacent devant lui, c’est nécessairement parce que des hommes (mâles) intrusifs se sont massivement imposés par la force aux hommes (mâles) indigènes de la région étudiée. Ce qui revient à dire que la région a été conquise et que les vainqueurs se sont débarrassés des hommes (mâles) vaincus. On peut ajouter que plus la proportion des haplogroupes ADN-Y intrusifs est grande, plus l’apport (masculin) extérieur a été important et/ou s’est imposé dans une extrême violence génocidaire (masculine). Ensuite, pour déterminer la date de ce mouvement migratoire traumatique, il reste à faire appel aux horloges moléculaires qui permettent d’estimer les dates de divergences entre les haplogroupes ADN-Y des descendants des migrants intrusifs et les haplogroupes ADN-Y des descendants de ceux de leurs frères qui n’ont jamais quitté le pays d’origine de l’haplogroupe intrusif. Enfin, pour se faire une idée du contexte dans lequel le mouvement migratoire s’est produit, il faut se tourner vers d’autres spécialités (climatologie, archéo-botanique, archéologie, …) et disposer de datations fiables. De la sorte, et avec une prudente hardiesse, on peut commencer à écrire un fragment de l’histoire évènementielle des temps oubliés.
Moindre apport évènementiel des haplogroupes ADN-mt
Les haplogroupes ADN-mt sont étudiés depuis plus longtemps que les haplogroupes ADN-Y parce que leur étude est plus facile. Nous avons dit que comme ceux-ci, ils permettent de dessiner un grand arbre généalogique de l’Humanité (en lignée matrilinéaire). A ce stade du raisonnement, il est frappant de constater que si les deux arbres généalogiques – patrilinéaire et matrilinéaire – sont très superposables au niveau de leurs grosses branches maitresses (i.e. aux époques datant des premiers temps du peuplement moderne de l’Eurasie), ils divergent rapidement dans la suite (i.e. aux époques moyennes et récentes du peuplement de l’Eurasie) et décrivent dès lors une structure complètement différente de la famille humaine. Alors qui croire ? Les hommes ou les femmes ? Pourquoi vouloir baser la reconstitution (pré)historique sur les haplogroupes ADN-Y masculins plutôt que sur les haplogroupes ADN-mt féminins ? Autrement dit, pourquoi ces derniers délivreraient-ils moins d’information évènementielle ?
La raison de ces configurations – initialement parallèles avant de diverger – se déduit pourtant aisément du comportement guerrier des Humains primitifs qui vient d’être décrit au chapitre précédent : au tout début de la dernière glaciation (MIS 5d), venant de sortir d’Afrique, les hommes et les femmes d’Eurasie vivaient au sein de bandes tribales d’origine uniforme et répandaient conjointement leurs haplogroupes ADN-Y et ADN-mt en pénétrant ici et là un continent septentrional encore vide d’Humains modernes. Bien sûr, en commençant à s’éloigner les unes des autres pour occuper toutes les terres habitables, ces bandes de même origine commençaient à se diversifier sur le plan génétique, en accumulant des mutations ADN-Y et ADN-mt que la distance ne leur permettait pas de diffuser à d’autres bandes. Puis, peu à peu, le monde commença à se remplir d’Hommes modernes. Vint alors le jour où des ethnies très lointainement cousines – et donc porteuses d’haplogroupes devenus très différents – entrèrent par hasard en contact ; et par conséquent en conflit. Or, lors des conflits, si les hommes vaincus sont généralement massacrés ou marginalisés [cf. ce qui précède], nous avons vu que les femmes vaincues sont le plus souvent épargnées et donnent à leurs vainqueurs des enfants des deux sexes qui portent les haplogroupes ADN-mt indigènes de leur mère ; cela parce que seules les femmes sont capables de transmettre des mitochondries à leurs enfants des deux sexes. Par conséquent, si au temps de leur conquête les hommes intrusifs n’étaient pas accompagnés de femmes de leur propre ethnie, TOUS leurs descendants posséderont des haplogroupes ADN-mt indigènes ; exactement comme les ‘’purs’’ indigènes d’autrefois ! Et cela quelle qu’ait pu être la violence de la conquête et l’intensité du génocide masculin qui l’avait accompagnée. Et cela, également, quel que soit le nombre des invasions successives et la provenance variée des divers envahisseurs de la région sur le très long terme. Ainsi, en raison du destin différent des hommes vaincus et des femmes vaincues, les haplogroupes ADN-Y peuvent être renouvelés plusieurs fois dans la longue (pré)histoire d’une région donnée, tandis que les haplogroupes ADN-mt demeurent toujours en place ! Voici la raison pour laquelle les haplogroupes ADN-mt nous donnent moins d’information que les haplogroupes ADN-Y lorsqu’on s’intéresse aux migrations anciennes ! Ils sont indicateurs de stabilité au long cours du vieux fond populationnel initial, tandis que les haplogroupes ADN-Y sont les indicateurs des mouvements successifs qui sont venus l’enrichir.
Il n’y a que dans le cas où les femmes intrusives sont nombreuses au moment de la conquête, que des haplogroupes ADN-mt intrusifs vont s’installer significativement au sein de la nouvelle population qui émerge des ruines de la guerre. Arrivé à ce niveau du raisonnement, il nous faut considérer une autre différence encore, qui sépare les hommes des femmes : contrairement aux hommes – dont le ‘’rendement’’ reproductif s’accroit lorsque leur statut social est élevé – les femmes gardent pratiquement toujours le même ‘’rendement’’ reproductif qu’elles soient des princesses royales adulées ou des indigentes méprisées. Par conséquent, la proportion des haplogroupes ADN-mt intrusifs et ADN-mt indigènes que nous observons dans une population donnée, reflète – y compris sur le long terme – l’exacte proportion des femmes intrusives et indigènes qui existait au lendemain de la conquête.
Les différences hommes / femmes que nous venons d’exposer, expliquent par exemple pourquoi les plus anciens haplogroupes ADN-Y d’Europe ont disparu, tandis que les plus anciens haplogroupes ADN-mt d’Europe – comme U5 – sont toujours bien présents chez les populations actuelles de ce continent. Dans un Monde plein – c’est-à-dire où tout déplacement impacte le territoire d’un autre groupe – les phénomènes que nous avons décrits sont universels ; et sont à l’origine de la ‘’cristallisation’’ de tous les nouveaux peuples.
Génétique ethnolinguistique
Plus loin dans l’introduction, nous aborderons l’épineuse question du langage des Hommes archaïques lorsque nous discuterons de leurs facultés cognitives avant de réfléchir aux conséquences de leur métissage avec les Hommes modernes. Il suffit d’avancer ici que le langage des Dénisoviens et des Néandertaliens pourrait avoir été l’expression d’une pensée concrète, similaire à celle de nos enfants de moins de 10 ans. Pour cette raison, le postulat adopté dans cet ouvrage est de considérer que les langues des Humains modernes se sont développées en l’absence d’apport archaïque notable, c’est-à-dire dans un Monde qu’il faut considérer comme à peu près linguistiquement vide ; et qu’elles se sont d’abord différenciées au gré de leur séparation, avant de subir, dans un second temps, les chocs frontaux de leurs retrouvailles.
Ethnolinguistique profonde – Langues paternelles
Beaucoup de linguistes refusent encore d’admettre la possibilité d’accéder à une linguistique historique profonde, qui serait plus ancienne que quelques milliers d’années avant le présent. Pourtant, la construction récente et rapidement progressive de la phylogénie des haplogroupes ADN-Y leur donne entièrement tort ! En effet, cette nouvelle phylogénie génétique calque assez parfaitement la phylogénie profonde des langues proposée depuis 50 à 100 ans par certains linguistes audacieux qui ont travaillé toute leur vie dans l’ignorance absolue de toute référence génétique ! Dans cet atlas, nous adhérons donc pleinement à l’hypothèse d’une langue initiale – dite Proto-Sapiens – qui fut élaborée par les premiers Homo sapiens sapiens d’Afrique de l’Est parce qu’une mutation pro-cognitive survenue au MIS 8 [cf. atlas n°2] leur avait donné la possibilité d’établir des liens arbitraires entre signifiants et signifiés et probablement de créer une première ‘’grammaire universelle’’ qui peut être rangée au nombre des expressions phénotypiques de la mutation. Dès le MIS 7, l’éclatement de ce groupe initial en plusieurs courants migratoires distincts, généra de lentes dérives parallèles des gènes et des dialectes. Les tribus qui firent souche sur le très long terme furent à la fois à l’origine des grands haplogroupes ADN-Y racines et des macro-familles linguistiques dans lesquelles nous pouvons ranger – avec une conviction variable – l’ensemble des langues vivantes et mortes que nous connaissons. Ce processus universel de divergence conjointe ‘’gènes + langue’’ fut exacerbé par un évènement remarquable qui survint au MIS 5d, lorsqu’un petit groupe tribal installa une tête de pont sur le continent eurasien ; laquelle fut à l’origine de presque toutes les langues et de presque tous les haplogroupes ADN-Y actuels.
Les langues sont pour l’essentiel des ‘’langues paternelles’’. En effet, à dates ancienne, une association étroite entre haplogroupes ADN-Y et langues réalisait l’arrière-plan de toute cristallisation d’un nouveau groupe ethnolinguistique ; couplage dont il n’y a pas lieu de s’étonner si l’on se réfère à la dynamique évolutionniste des guerres primitives que nous avons exposée plus haut. Toutes les associations ‘’ADN-Y + langues’’ que nous proposons seront discutées au fil des cartes successives ; et à la fin de l’atlas, un tableau permettra de les visualiser dans leur ensemble. Il faut toutefois comprendre qu’un couplage étroit ‘’ADN-Y + langues’’ ne fonctionna parfaitement que jusqu’au MIS 2 (second maximum glaciaire) ; en effet, jusqu’à cette époque, lorsqu’il arrivait que des vagues migratoires successives se télescopent, l’implacable mécanique génocidaire des guerres paléolithiques limitait de facto les échanges linguistiques, sauf, peut-être, dans les Finis Terrae. La langue des femmes indigènes épargnées devait toutefois impacter l’évolution de la langue des hommes vainqueurs, lorsque ces deux langues étaient très différentes. Puis, à partir du Tardiglaciaire mésolithique et plus encore à partir de l’Holocène néolithique, c’est le besoin d’esclaves qui mit fin au couplage étroit ‘’ADN-Y + langues’’ ; parce que les vaincus épargnés finirent tôt ou tard par s’intégrer à la nouvelle société des vainqueurs, en lui léguant à la fois leurs haplogroupes ADN-Y et quelque chose de leur ancienne langue … c’est donc à partir de ces époques récentes que les échanges de matériel linguistiques se firent plus nombreux, brouillant parfois les contours des vieilles macro-familles de langues.
Divergence des langues – Approches théorique et géographique
L’hypothèse d’un couplage ‘’ADN-Y + langue’’ chez les Hommes modernes qui vécurent pendant l’essentiel du Paléolithique moyen et supérieur, puis d’un découplage de ce tandem à l’issue de cette période, nous permet de proposer trois grands scénarios universels de l’histoire profonde des langues :
1) langues tranquilles
Chez les populations qui restèrent stables sur le long terme – c’est-à-dire celles qui habitèrent continuellement la même région, sans apport extérieur massif pendant de très nombreux millénaires –, la langue évolua lentement sous l’effet de simples changements internes. Nous postulons qu’une stabilité de ce type caractérisa pendant très longtemps le Moyen-Orient paléolithique. En effet, ayant été dès le MIS 5d la tête de pont des Humains modernes installés en Eurasie, cette région proche du Golfe Persique – voire sous les eaux du Golfe Persique d’aujourd’hui – resta peut-être jusqu’à l’Interpléniglaciaire (MIS 3) la zone plus densément peuplée de tout le nouveau continent, à l’aune des modestes standards démographiques de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs?
Au Moyen-Orient, à l’échelle des 4000 générations environ écoulées entre l’arrivée des premiers Humains modernes en Eurasie [cf. carte A de l’atlas n°3] et le début de l’Holocène [cf. début de l’atlas n°4], on reconstitue une filiation haplogroupale directe de l’haplogroupe racine CT qui témoigna probablement de la longue pérennité locale d’un même groupe ethnolinguistique pan-chronique. Bien que nous soyons contraints de donner plusieurs noms successifs à ce groupe populationnel central si nous voulons scander les grands stades de son évolution, cela signifie que, dans cette région, il n’y eut jamais aucune rupture ethnolinguistique perceptible entre les langues Boréales, les langues *Néo-Boréales, les langues Déné-Caucasiennes, les langues *Proto-Nostratiques et les phases successives d’évolution des langues Nostratiques dont les extensions géographiques seront détaillées dans les cartes de l’atlas n°3. La raison pour laquelle certaines de ces macro-familles de langues sont toujours repérables en comparant les langues d’aujourd’hui, provient vraisemblablement du fait que leurs locuteurs originels se sont détachés du cœur pulsatile moyen-oriental à des moments successifs de l’évolution de LA langue centrale panchronique. Lors de chaque pulsation populationnelle, les migrants emportèrent l’état contemporain de LA langue moyenne-orientale ; prélude à la rapide divergence de leur dialecte particulier, désormais éloigné de la zone de stabilité linguistique ; mais aussi prélude au maintien de certains traits archaïques qui disparurent ensuite de LA langue centrale. Naturellement, ces départs répétés vers l’Est, vers l’Ouest ou vers le Nord étaient sans aucune conséquence pour la stabilité linguistique de la zone centrale, puisque les migrations étaient toujours des allers simples en direction de l’inconnu ! C’est pour cette raison que nous postulons que l’ensemble génétique et linguistique de la zone centrale demeura longtemps relativement homogène ; comme ce fut d’ailleurs le cas de ses haplogroupes ADN-Y, dont la phylogénie détaillée – désormais connue – valide pleinement ce raisonnement en raison du couplage ancien ‘’ADN-Y + langues’’.
Nous proposons d’appeler ‘’hub’’ moyen-oriental ce cœur pulsatile génétique et linguistique de l’Humanité eurasienne, en invoquant la métaphore d’un centre de transports aérien à partir duquel les voyageurs auraient eu la faculté de partir dans toutes les directions ; avec pour bagages à la fois leurs haplogroupes ADN-Y et les langues qui leur étaient étroitement attachées. Concrètement, il est probable que ce ‘’hub’’ repose en partie sous les eaux du Golfe Persique. En effet, des reconstitutions climatiques et écologiques permettent de penser que le fond du Golfe Persique fut – pendant l’essentiel de la période couverte par l’atlas n°3 – une terre accueillante qui s’étendait sur les deux rives d’un fleuve majestueux constitué par la prolongation du Chatt-el-Arab actuel, lui-même résultant de la confluence du Tigre et de l’Euphrate ; une terre bien plus propice à une riche vie animale et végétale que ne l’étaient les semi-déserts qui l’entouraient ; et donc bien plus propice à une démographie dynamique. Si cela est vrai, cela signifie que les principaux sites archéologiques régionaux des MIS 4, MIS 3 et MIS 2 sont aujourd’hui engloutis pour la plupart, et donc inaccessibles aux chercheurs ! Ce qui entrave grandement notre compréhension de la dynamique d’installation et de diffusion des Hommes modernes en Eurasie. Le schéma ci-dessous matérialise le ‘’hub’’ moyen-oriental et les trois grands tapis-roulants qui emportent ses voyageurs au loin.

‘’Hub’’ moyen-oriental et les trois grands tapis-roulants qui emportent ses voyageurs au loin.
2) langues effilochées
Nous appellerons ainsi les langues qui dérivèrent solitairement une fois qu’elles se furent détachées de la zone de stabilité du ‘’hub moyen-oriental’’ pour s’avancer dans un Monde linguistiquement vide ou dont les expressions vocales archaïques s’effaçaient devant elle.
C’est la répartition actuelle et passée des haplogroupes ADN-Y qui nous incite à conclure que des petits groupes pionniers quittèrent à plusieurs reprises le ‘’hub’’ moyen-oriental ‘’pour’’ fonder des centres populationnels secondaires situés les uns à l’Ouest (Extrême-Occident d’Europe), d’autres à l’Est (Extrême-Orient méridional de l’Indochine et du Sunda), et d’autres encore au Nord (Altaï / Baïkalie, porte de l’Extrême-Orient septentrional de Sibérie orientale et de Chine du Nord). Ces mouvements – partis sur l’une ou l’autre des voies qui sont matérialisées sur le schéma ci-dessus – furent répétés à plusieurs reprises, au gré de chacune des embellies climatiques qui les rendaient possibles ; ce qui signifie qu’ils ont été particulièrement dense au cours du MIS 3 (Interpléniglaciaire) qui fut une pause globalement tempérée entre deux maximum glaciaires moins propices que lui aux voyages. Par conséquent, chaque strate de migrant emporta avec elle l’état contemporain de LA ‘’langue centrale’’ que l’on parlait à cette époque-là dans le ‘’hub’’ [cf. l’ensemble de l’atlas n°3]. Ceux dont les petites colonies exotiques furent prospères, furent à l’origine de la cristallisation de nouveaux groupes ethniques repérables par un nouvel haplogroupe ADN-Y majoritaire (effet fondateur à partir de l’haplogroupe ADN-Y des migrants) et probablement par un nouveau groupe ou sous-groupe linguistique (effet fondateur à partir du dialecte de la langue centrale que parlaient les migrants). Nous avons déjà dit qu’il faut faire ce lien entre nouvel haplogroupe et nouvelle langue, parce que dans le monde des chasseurs-cueilleurs paléolithiques il s’agissait de deux facettes d’une même réalité : celle de petites bandes humaines structurées autour d’hommes patrilocaux (i.e. apparenté en lignée mâle) qui devaient être assez forts, assez habiles et surtout assez chanceux pour réussir à prospérer dans l’adversité ; condition essentielle pour que leurs descendants deviennent nombreux et donc pour pouvoir répandre à la fois leurs haplogroupes ADN-Y et leurs langues ! Au total, une succession de réussites de ce type créa autant de ‘’hub secondaires’’ puis de ‘’hub tertiaires’’ qui furent à leur tour à l’origine de nouvelles cristallisations ethnolinguistiques et de nouvelles dispersions multidirectionnelles. De sorte que le Monde habitable cessa peu à peu d’être vide et devint un Monde plein.
Or nous venons de voir que, tout comme leurs haplogroupes ADN-Y, les groupes migrants emportaient bien évidemment leur dialecte avec eux. A partir de ce point, faute de pouvoir conserver des rapports étroits avec la constellation de langues sœurs du ‘’hub’’ – qui établissait une zone de stabilité prolongée –, le dialecte migrant isolé se transformait rapidement et profondément selon deux phénomènes qui s’amplifiaient avec le temps : conservation d’archaïsmes pour certains traits et apparition d’innovations pour d’autres traits ; cela parce que la moindre innovation qui survenaient dans cette petite communauté perdue au milieu de nulle part, se répandait immédiatement à tous les individus et avait donc tendance à se fixer rapidement dans l’usage. Ainsi, bien que contraires en apparence, innovations et archaïsmes opèrent exactement dans le même sens à l’origine de la cristallisation d’un nouveau groupe ethnolinguistique, en cela qu’ils accentuent les divergences entre le dialecte exilé et la langue centrale plus stable que continuent à parler les cousins demeurés sédentaires dans la lointaine patrie. Dans un tel cas, au bout de quelques générations seulement, l’intercompréhension commencera à être sérieusement altérée, puis disparaîtra complètement. On pourrait donc dire que ces langues migrantes s’effilochent au long de leur chemin d’exilées, tant qu’elles ne rencontrent aucun obstacle linguistique coriace. Dans le corps de l’atlas n°3, on verra notamment qu’une grande, féconde et très longue dérive de ce type se produisit au cours de l’Interpléniglaciaire, lorsqu’un petit groupe de migrants porteurs de l’haplogroupe K2 quitta le ‘’hub’’ moyen-oriental en direction de l’Asie Centrale et des steppes asiatiques, donnant naissance à un ‘’hub secondaire’’ qui contenait à la fois le germe des langues Eurasiatiques (nombreuses langues passées et actuelles des sous-groupes Indo-Européen, Eskaléoute, Ouralien, Altaïque, Tchouktche, etc.) et le germe des langues Amérindes qu’il faut comprendre comme un grand rameau de l’Eurasiatique extrêmement effiloché par sa conquête d’un Monde entièrement vide (Iroquois, Sioux, Chinook, Zuni, Natchez, Maya, Uto-Aztèque, Aymara, Quechua, Jivaro, Caribs, etc.).
3) Langues entrechoquées
Comme le génome nucléaire, les langues peuvent échanger du matériel à l’occasion d’échanges commerciaux, d’échanges matrimoniaux et de conflits. Evacuons toutefois de l’exposé les échanges – conflictuels ou non – qui surviennent entre deux tribus ou nations voisines et étroitement apparentées ; lesquelles partagent de ce fait des marqueurs génétiques très proches et des langues très voisines. Le bon sens aurait suffi pour l’affirmer, mais l’ethnologie confirme que c’est ce type d’échanges et de conflits qui sont les plus nombreux. Cependant, cette situation doit être versée au chapitre de la vie des langues tranquilles qui évoluent en vase clôt. En effet, puisqu’il ne s’agit que de querelles de famille, on s’entretue, on s’embrasse, on se viole et on se dévore au barbecue entre cousins ; ce dont il résulte que les conséquences linguistiques et génétiques sont nulles ou imperceptibles. Ce n’est que de l’écume historique bien vite digérée.
On réservera donc la notion de langues entrechoquées à celles qui – après s’être exilées de la zone de stabilité du ‘’hub’’ et après s’être effilochées comme il en a été question au chapitre précédent – entrèrent en compétition puis en fusion partielle ou complète avec d’autres langues qui résultaient d’autres exils lointainement précédents. Dans la mesure où aucune population migrante ne peut aller plus loin que l’une ou l’autre des deux extrémités du continent eurasien, et dans la mesure où aucune population indigène ne peut fuir au-delà de ces extrémités, les Finis Terraefurent les régions idéales pour un grand empilement des peuples et donc pour un grand entrechoquement de leurs langues ! Ce fut aussi le cas dans les montagnes et dans les îles, qui sont d’autres types de Finis Terrae. Dans le contexte d’un Monde devenu plein (à partir de la seconde partie du MIS 3), toute nouvelle migration coloniale entreprise par un groupe ethnolinguistique donné (i.e. groupe intrusif), eut donc désormais un risque élevé de buter sur un autre groupe ethnolinguistique suffisamment divergent pour lui apparaitre comme entièrement distinct (i.e. groupe indigène) en cela que l’intercompréhension les deux sociétés était devenue soit très difficile soit déjà totalement absente.
Ci-dessous, nous allons parler des cas où les envahisseurs s’imposent dans une région peuplée, mais sans que leur victoire ait pour conséquence l’élimination physique totale des indigènes.
a) Premier type d’entrechoquement : des envahisseurs victorieux sont tout un peuple en marche qui s’installe à demeure sur le territoire d’un groupe ethnolinguistique indigène, étranger à leur nation.
- Au Paléolithique, la tendance génocidaire masculine [cf. ci-dessus] devait entraîner la disparition quasi-totale de la langue et de la culture des vaincus. En effet, puisque les dominants de ‘’pure souche’’ qui s’installaient dans le pays conquis étaient nombreux et étaient accompagnés de femmes de leur ethnie, ils n’avaient pas besoin de faire l’effort d’apprendre la langue des vaincus rescapés (femmes essentiellement). Par ailleurs, les enfants métis, nés des femmes indigènes épargnées, n’avaient pas d’autre choix que d’apprendre et d’utiliser quotidiennement la langue de leurs pères envahisseurs, s’ils voulaient s’intégrer à une société dominante transposée en bloc.
- A partir du Mésolithique (sociétés sédentaires accumulatrices) et surtout du Néolithique (sociétés sédentaires accumulatrices et productivistes), nous avons dit que les pratiques génocidaires laissèrent la place à une clémence intéressée, dans le but d’exploiter le potentiel physique des hommes vaincus. Mais bien que la proportion d’indigènes survivants ait donc été plus grande qu’au Paléolithique, la langue victorieuse continua à faire disparaitre la langue indigène dans la situation d’hégémonie où nous nous plaçons. En effet, puisque les femmes intrusives étaient nombreuses, la langue des hommes intrusifs continuait d’être transmise sans effort à leurs enfants de ‘’pure souche’’ qui devenaient automatiquement les cadres dirigeants de la génération suivante ; tandis que cette même langue était nécessairement privilégiée dans l’usage quotidien par leurs enfants métis (bilingues) qui gravitaient dans l’orbite du pouvoir ; ainsi que par les serviteurs purement indigènes qui devaient apprendre la nouvelle langue étrangère pour pouvoir comprendre correctement leurs maîtres. Par conséquent, étant à la fois la langue maternelle d’un grand nombre de personnes et la langue quotidienne indispensable à tous les autres, la langue des envahisseurs avait peu de raison de se modifier en profondeur malgré l’apport inévitable de quelques mots indigènes, qui étaient d’autant plus facilement adoptés qu’ils n’avaient pas d’équivalent dans la leur (toponymie, nouvelles plantes ou animaux, technologies indigènes). Si le différentiel culturel n’était pas trop grand entre les deux peuples, la culture du nouveau peuple était elle aussi en parfaite continuité avec la vieille culture des envahisseurs, parce que ceux-ci s’étaient installés avec leurs élites religieuses (i.e. intellectuelles), leurs femmes et leurs vieux ; c’est-à-dire avec les universels gardiens des traditions.
b) Deuxième type d’entrechoquement : des envahisseurs victorieux peu nombreux mais quand même accompagnés de femmes de leurs clans, s’installent à demeure sur le territoire d’un groupe ethnolinguistique indigène, étranger à leur nation. Lorsque des envahisseurs peu nombreux parvenaient à s’imposer dans une région étrangère densément peuplée, c’était le plus souvent parce qu’ils disposaient d’un avantage militaire déterminant, et/ou parce que les indigènes avaient été incapables de se coaliser du fait de leurs querelles internes du moment. Passée la phase de conquête et ses massacres inévitables, le génocide complet des hommes vaincus n’était pas réalisable à grande échelle et les étrangers vainqueurs se contentaient de former une sorte de clan dominant dans la région conquise. Dans un tel contexte, l’évolution linguistique dépendait de paramètres tels que le nombre des envahisseurs des deux sexes, et le différentiel culturel réel (technologique) ou subjectif (prestige) qui existait entre les groupes intrusifs et indigènes. Les conséquences linguistiques étaient donc fonction de ces paramètres et peuvent être schématisées ainsi :
- Cas où les envahisseurs compensaient leur infériorité numérique grâce à un prestige et/ou une technologie supérieure, et parvenaient à imposer leur langue. A l’époque historique, c’est par exemple ce qui s’est passé en Amérique Centrale et en Amérique du Sud, lorsque les Espagnols conquirent les nombreuses nations indigènes de ces vastes contrées. De tels remplacements linguistiques se sont pareillement produits dans un passé plus lointain, par exemple lorsque des poignées de Romains (commerçants, militaires, administrateurs) installèrent le Latin dans les populeuses nations d’Europe Occidentale, et firent disparaitre les langues indigènes en quelques siècles seulement. Faute d’un différentiel technologique marqué, ce type de situation pourrait avoir été plus rare avant les grandes civilisations de l’antiquité ; mais on ne peut pas exclure que des colons néolithiques, étrangement entourés d’animaux dociles, aient autrefois vivement impressionné les indigènes mésolithiques dont ils brûlaient les forêts pour enfouir étrangement des graines sous la terre ?
- Cas où la culture indigène est perçue par les vainqueurs comme étant supérieure à la leur. A l’époque historique, toujours, c’est par exemple ce qui s’est passé lorsque des petits groupes de ‘’barbares’’ ont conquis les grandes civilisations qu’étaient l’Empire Romain ou l’Empire Chinois. Dans de tels cas, la langue des envahisseurs a fini par disparaitre des régions conquises au bout de quelques siècles seulement ; période pendant lesquels elle était restée cantonnée à l’aristocratie étrangère issue de la victoire. Au sortir de cette période intermédiaire, seuls quelques mots ou traits grammaticaux de la langue des vainqueurs avaient été intégrés à la langue des indigènes ; mais globalement, celle-ci émergea victorieuse, en dépit de la défaite passée de ses locuteurs. Il est peu probable que des situations de ce type furent nombreuses jusqu’au Néolithique voire jusqu’à l’âge des métaux, car on ne voit pas bien de quel prestiges civilisationnel auraient pu être parés les vaincus ?
- Cas où aucune des deux langues ne parvenait à s’imposer. A date préhistorique, lorsque la victoire était incertaine où lorsque le groupe ethnolinguistique intrusif s’installait – sans pouvoir la dominer intégralement – dans une contrée où le poids des tribus indigènes demeurait important, les échanges entre voisins devenaient inévitables : qu’il s’agisse d’échanges commerciaux, d’alliances contractées contre d’autres tribus de l’une ou de l’autre ethnie, de guerres à répétition et/ou de razzia de femmes. Dans ces contextes mosaïques, l’évolution linguistique de la région dépendait alors des proportions d’hommes et des femmes intrusifs et indigènes, et de l’intensité des échanges qui s’établissaient entre les groupes. Si toutes ces proportions étaient à peu près équilibrées dans une région donnée, les deux langues entamaient alors un lent processus d’alliage. Au début, des pidgins se créaient pour permettre des échanges minimums entre les deux communautés ; c’est-à-dire que chaque groupe conservait sa langue maternelle, mais que quelques mots de l’une ou l’autre langue étaient connus de tous les protagonistes ; ces échanges frustes se passaient de grammaire mais la juxtaposition de certains mots pouvait en tenir lieu. Avec la prolongation de cette promiscuité, de nombreux mots et tournures continuaient à percoler d’une langue à l’autre, et les pidgins maladroits des débuts devenaient peu à peu des créoles (néo-langues possédant un vocabulaire et une grammaire simple) qui commençaient à être utilisés dans la vie de tous les jours, à la place des deux anciennes langues ; cela parce que les communautés humaines étaient de plus en plus mêlées (échanges réguliers de femmes, acceptés ou contraints). Avec le temps, le créole se complexifiait de plus en plus sous le poids des innovations et de ce qui restait des deux anciennes langues en voie de disparition dans la région où le processus de fusion était à l’œuvre ; anciennes langues vis-à-vis desquelles le créole régional était devenu très divergent. Si des cristallisations ethnolinguistiques créolisantes se produisirent dans les Finis Terrae, il est aisé de comprendre pourquoi certaines familles de langues actuelles sont difficiles à classer : c’est parce que ces familles de langues se sont construites à partir de racines hybrides ! Nous postulons que ce processus d’amalgame linguistique fut très actif aux deux extrémités géographiques de l’Eurasie paléolithique ; parce que, dans ces régions périphériques, de nouvelles strates migratoires originaires du ‘’hub’’ moyen-oriental sont régulièrement venues apporter de nouveaux groupes ethnolinguistiques intrusifs (nouveaux haplogroupes Y-DNA au seuil d’une diversification + nouvelle langue proche de l’état contemporain de LA ‘’langue centrale du ‘’hub’’) qui se superposaient à d’anciens groupes ethnolinguistiques indigènes (anciens haplogroupes Y-DNA déjà bien diversifiés sur place + langue locale issue à la fois d’un état plus ancien de LA ‘’langue centrale du ‘’hub’’ et de rencontres précédentes avec des groupes ethnolinguistiques indigènes encore plus anciens).
C’est ce processus d’empilement de plusieurs strates linguistiques qui explique qu’il est aujourd’hui impossible de tracer correctement la phylogénie linguistique des langues anciennes du Sud-Est asiatique (parfois dites faute de mieux ‘’langues Pacifiques’’) ou même d’une langue classique comme le Japonais : c’est parce que les langues actuelles de ces divers Finis Terrae sont les produits d’une série d’entrechoquements débutés il y a 50.000 ans environ et qui perdurèrent jusqu’en pleine époque historique ; lesquels créèrent une pâte feuilletée de créoles successifs dont émergèrent les familles de langues les plus rebelles à la classification. En Europe – un autre grand Finis Terrae de l’Eurasie – le processus dut être parfaitement identique ; mais, à l’exception du Basque et du Nord-Caucasien qui ont survécu jusqu’à nous (et dont la difficulté à les classer indique qu’elles conservent la trace d’un semblable millefeuille), le remplacement linguistique fut ici total dans le sillage des invasions indo-européennes [cf. atlas n°4] ; évènement protohistorique qui nous prive de pouvoir étudier les anciens millefeuilles locaux !
Ainsi, suspendues entre les deux situations extrêmes dans lesquelles soit les envahisseurs imposent (presque) complètement leur langue [cf. § a], soit les indigènes imposent (presque) complètement la leur [cf. § c], les situations intermédiaires que nous venons d’étudier mêlent les deux langues protagonistes en proportions variées. Même si l’une d’entre elles peut parfois prédominer sur l’autre, il en résulte toujours in fine la création d’une langue originale qui s’écarte plus ou moins de ses deux modèles initiaux. Serait-ce par exemple ce qui s’est passé chez les Germains lorsqu’ils s’installèrent au Nord de l’Europe néolithique [cf. atlas n°4] ? Bien qu’à base Indo-Européenne très consensuelle, les langues Germaniques ont profondément renouvelé leur prononciation, ont simplifié leur grammaire et ont selon toute vraisemblance incorporé de nombreux mots indigènes, puisqu’on ne retrouve pas ces mots dans les autres langues Indo-Européennes ; tout ceci représentant l’état figé d’un processus d’entrechoquement puis de créolisation partielle dont la langue de l’ethnie victorieuse ne sortit pas indemne !
c) Troisième type d’entrechoquement : de jeunes envahisseurs peu nombreux et sans femmes de leurs clans, conquièrent le territoire d’un groupe ethnolinguistique indigène, étranger à leur nation. Dans cette situation, une fois les envahisseurs installés dans la région conquise, leur langue aura tendance à se perdre en quelques générations seulement, même s’ils sont technologiquement supérieurs aux indigènes ! Ceci, parce que les hommes vainqueurs ne sont pas accompagnés de femmes compatriotes et que les mères de leurs enfants ne pourront donc être QUE des femmes indigènes. Nécessairement, celles-ci apprendront leur langue indigène (maternelle) à leurs enfants métis ! A la génération suivante, tout le monde parlera donc la langue indigène ; seuls les garçons (métis et bilingues) utiliseront la langue de leurs pères envahisseurs lorsqu’ils interagiront avec eux, et cela plus particulièrement pour tout ce qui concernera les termes techniques et guerriers. A part ces mots qui se naturaliseront rapidement dans la nouvelle communauté, la langue des générations futures restera essentiellement la langue indigène, et cela en dépit du renouvellement massif des haplogroupes ADN‑Y. Par ailleurs, tout comme la langue, la culture du nouveau peuple conservera massivement sa base indigène ; et cela avec d’autant plus de facilité que les jeunes guerriers des débuts n’étaient pas accompagnés par des cadres culturels de leur ethnie (prêtres, femmes et vieux, gardiens des traditions en tous genres).
Etrangement, il arrive aussi que le processus qui vient d’être expliqué prenne pendant un temps la forme d’une diglossie, c’est-à-dire que chacun des deux sexes comprenne parfaitement l’autre, mais utilise quotidiennement une langue qui lui est propre, alors que tous les individus se considèrent pourtant comme faisant partie d’un même groupe humain. Cette situation a été étudiée aux Petites-Antilles. Au début du deuxième millénaire de notre ère, ces îles étaient peuplées par des tribus Arawak. Puis, à une date récente qui pourrait avoir été située au XVème siècle de notre ère (v. 1450 ?), des Caribs / Canibs venus du continent sud-américain colonisèrent ces îles. Au temps des Espagnols, la tradition orale avançait que les hommes Arawak vaincus avaient été massacrés et mangés, et que leurs veuves étaient devenues les femmes des vainqueurs. La séquence classique ! Mais dans la nouvelle société composée d’hommes Canibs et de femme Arawak, chacun conserva sa langue. Garçons et filles métis étaient bilingues, mais les hommes incitèrent leurs fils à parler la langue des Canibs, tandis que les filles parlaient l’arawak avec leurs mères. Ainsi, vers 1650 (soit, deux siècles peut-être après la conquête ?), la langue des hommes comprenait 64% de mots canibs et 36 % seulement de mots arawak ; tandis que la langue des femmes comprenait 16% seulement de mots canib et 84 % mots arawak. Trois siècles plus tard (12 générations), vers 1950, la diglossie était en voie d’arasement avec 23 % de mots canibs contre 77 % de mots arawak chez les hommes, et 18 % de mots canib contre 82% de mots arawak chez les femmes. Dans cet exemple, on voit que ce sont les hommes qui ont finalement rapproché leur langue intrusive de celle des femmes indigènes, et non l’inverse, ce qui nous ramène pratiquement au cas où les envahisseurs abandonnent rapidement leur langue ancestrale pour adopter celle de leurs vaincus. Une telle situation – temporairement instable, puis devenant stable en une vingtaine de générations – a probablement dû être fréquente. Et 20 générations, c’est rapide pour les échelles de temps auxquelles nous confronte l’atlas n°3. Dans ce type de nouveau peuple en cours de cristallisation, le vocabulaire domestique des indigènes vaincus a davantage de chance de survivre, puisque c’est le vocabulaire des femmes ; tandis que le vocabulaire guerrier, technique ou cynégétique sera plutôt issu de la langue des envahisseurs masculins. Chez les Canibs-Arawak, une nouvelle langue hybride homogène était en train de se stabiliser environ 5 siècles après la conquête gastronomique des Petites-Antilles ; mais le rouleau uniformisateur du monde contemporain a alors fait disparaitre cet intéressant témoignage d’un processus linguistique qui ne fut certainement pas unique. L’aventure des Canibs-Arawak nous explique peut-être même ce qui s’est passé chez les Basques des Pyrénées où une langue majoritairement non-indo-européenne mais contenant de nombreux mots indo-européens, est aujourd’hui parlée par des hommes dont la majorité exprime l’haplogroupe R1b, caractéristique des Indo-Européens-Occidentaux [cf. atlas n°4] ! Ce Basque, à la fois classé parmi les langues déné-caucasiennes, mais comprenant aussi des traits nostratiques non-indo-européens et des traits indo-européen, raconte un entrechoquement des langues dans le Far-West européen, et peut-être une histoire semblable à celle des Canibs et des Arawak ; mais une histoire qui aurait bégayé plusieurs fois, créant une succession chronologique de créoles locaux qui nous ramènent à l’image d’un millefeuille. Sur le grand mur du temps, l’histoire profonde du Basque ouvre un fenestron au travers duquel nous pouvons espérer entrapercevoir un tout petit aspect de la vaste préhistoire linguistique oubliée du Finis Terrae occidental.
Cristallisation ethnolinguistique
Pour résumer ce qui précède, il a donc existé trois modalités différentes d’évolution des langues et des peuples qui les parlaient :
- la première modalité est celle des ‘’langues tranquilles’’ qui ne subirent qu’une évolution interne et lente, sans interférence extérieure. L’exemple le plus éloquent de ce processus découla de la position fondatrice de la première population eurasienne venue d’Afrique au MIS 5d [cf. carte A]. Dans le ‘’hub’’ moyen-oriental (fond du Golfe Persique ?), elle développa une démographie dense qui lui permit de demeurer longtemps animée d’une force centrifuge ; et donc de protéger son cœur d’un possible retour des langues divergentes crées par les migrants partis coloniser les terres lointaines. Dans cette région, de telles rétromigrations ne survinrent qu’à partir du MIS 2 et surtout au MIS 1, lorsque des groupes proche-orientaux se convertiront précocement à l’économie de production et viendront, en bandes pléthoriques, mettre fin aux pulsations du ‘’hub moyen-oriental’’ dont ils recouvriront le cœur [cf. atlas n°4] !
- la deuxième modalité est celle des ‘’langues effilochées’’. Ce sont celles de locuteurs parties fonder un ‘’hub secondaire’’ dans des régions jusque-là vides d’autres groupes linguistiques. Avant que la nouvelle colonie ne devienne prospère et recrée une nouvelle zone de stabilité ethnolinguistique, la distance accélère les divergences avec le groupe d’origine demeuré dans le ‘’hub primaire’’. Un exemple éloquent de ce processus est celui du groupe Eurasiatique parti du ‘’hub primaire’’ moyen-oriental ‘’pour’’ fonder un ‘’hub secondaire’’ au cœur des steppes asiatiques. Un second exemple éloquent est celui du groupe Amérinde, issu de ce même ‘’hub secondaire’’ mais parti fonder un ‘’hub tertiaire’’ en Béringie, c’est-à-dire à nouveau dans des terres vierges encore plus lointaines. Dans de telles situations, le rattachement linguistique de ces groupes aux langues Nostratiques demeurées dans le ‘’hub primaire’’ n’est pas allé de soi, mais a quand même pu être opéré par Greenberg sur des bases très convaincantes parce que nombreuses.
- enfin, la troisième modalité est celle des ‘’langues entrechoquées’’. C’est-à-dire des langues que la raréfaction des nouvelles terres ou le simple hasard mettent en présence d’autres langues devenues très différentes et présentant une certaine capacité de résistance à l’envahisseur. Les conséquences de l’entrechoquement peuvent être de trois types : soit la langue des vainqueurs est globalement absorbée par celle des vaincus (des éléments de la langue intrusive s’installent cependant dans la langue des vaincus qui devient aussi celle des héritiers des vainqueurs) ; soit la langue des vainqueurs s’impose aux vaincus (des éléments de la langue des vaincus s’installent cependant dans celle des vainqueurs qui devient aussi celle des héritiers des vaincus) ; soit les deux langues sont de force équivalente ; et génèrent alors un pidgins, suivi d’un créole, puis enfin d’une nouvelle langue synthétiquedont les racines hybrides peuvent être difficiles à démêler ; et cela d’autant plus que le processus peut se répéter plusieurs fois, invasions après invasions, réalisant in fine une pâte feuilletée linguistique, c’est-à-dire un ‘’multi-créole’’. Dès le MIS 3, de tels entrechoquement de langues furent nécessairement actifs aux trois extrémités Est (Extrême-Orient), Sud-Est (Indo-Sunda) et Ouest (Europe) de l’Eurasie, où vinrent, vague après vague, s’empiler les ‘’transfuges’’ issus des pulsations itératives du ‘’hub’’ moyen-oriental. Plus tard, tous ces vieux multi-créoles finistériens seront presque totalement détruits par le rouleau compresseur des peuples qui s’adonneront à l’économie de production ; avec cependant quelques rares exceptions où la néolithisation puis les invasions de l’âge des métaux ne firent que rajouter de nouvelles couches par-dessus l’empilement (Basque, Japonais, etc.). En revanche, les vieux multi-créoles Proto-Papouasien et Proto-Macro-Pama-Nyungan seront protégés de cette destruction par le long isolement de l’Asie du Sud-Est ; ce qui leur donnera l’occasion d’arriver jusqu’à notre époque où leurs descendants font – comme le Basque et comme le Japonais – figure d’objets linguistiques étranges.
Psychologue cognitive et technologique
Faute de pouvoir observer beaucoup d’autres choses, c’est essentiellement les vestiges lithiques qui nous servent d’indicateurs pour repérer des étapes dans le développement technologique des sociétés paléolithiques, et pour tenter de proposer des délimitations chronologiques et géographiques à certains groupes humains.
La technologie découle des capacités cognitives
Dans l’atlas n°2 nous avons vu que des progrès technologiques ont existé dès le Paléolithique inférieur, mais qu’il est probable que ces progrès n’aient fait que traduire une évolution des facultés cognitives et praxiques qui découlaient mécaniquement du programme génétique des différentes strates d’humanités archaïques ; c’est-à-dire que ces progrès ne dépendaient pas de réelles facultés d’innovation mais constituaient plutôt un phénotype. Cet argument a été avancé dans l’atlas n°2 en raison des très longs paliers de plusieurs centaines de milliers d’années, qu’il serait malhonnête de vouloir occulter entre deux ‘’progrès’’ successifs ; durées abyssales qui contrastent éloquemment avec le rythme des inventions qui se succédèrent beaucoup plus rapidement dès que fut apparu l’Homme moderne. Rappelons simplement ici les dates de ces grandes étapes techno-comportementales des Humains archaïques : l’oldowayen / mode 1 (v. 3.000.000 AEC), l’acheuléen / mode 2 (v. 1.700.000 AEC) et le levalloisien / mode 3 (v. 650.000 AEC) ; ce dernier ayant représenté un véritable saut cognitivo-conceptuel en ceci que ce n’était plus l’outil qui était directement mis en forme, mais une matrice de pierre totalement inutile en elle-même mais à partir de laquelle on pouvait débiter les outils. Pour ces raisons, il nous semble très abusif de manipuler le concept de ‘’culture’’ aux Paléolithiques inférieur et moyen [cf. atlas n°2]. C’est pourquoi, dans l’atlas n°3, ce mot est systématiquement remplacé par ‘’industrie’’ ou ‘’technologie’’ qui apparaissent plus neutres.
Cependant, il y a environ 300.000 à 250.000 ans (au MIS 8), l’apparition de capacités cognitives proches des nôtres, conféra à un petit groupe d’Humains d’Afrique de l’Est la faculté d’innover ; ce qui est l’une des caractéristiques les plus caractéristiques d’Homo sapiens sapiens. Comme la double articulation du langage, l’art et les sépultures, la faculté d’innovation découla directement de l’apparition des capacités d’abstraction et d’une pensée symbolique pleinement constituée. Tout ceci n’existe pas chez les Chimpanzés et n’existait pas non plus chez les Hommes archaïques.C’est seulement à partir de ce déclic génétique mutationnel que les progrès technologiques et conceptuels commencèrent à s’enchaîner ; au début toujours selon un rythme très lent, lorsqu’on se réfère aux progrès de l’époque contemporaine, mais en réalité déjà à un rythme incroyablement rapide comparativement à tous les progrès antérieurs. En Eurasie, c’est seulement alors – c’est-à-dire à partir du MIS 3 –, que le terme de ‘’culture’’ deviendra moins contestable ; étant entendu que, même de nos jours, ce concept ne décrit pas autre chose qu’une assez mince pellicule recouvrant une masse de comportements génétiquement déterminés, largement identiques sur toute la planète chez tous les membres de notre espèce !
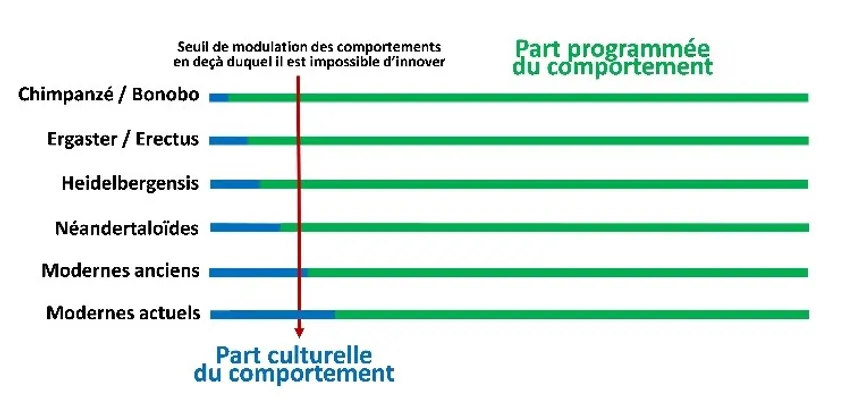
Part culturelle du comportement
Autre chose : beaucoup de gens semblent penser que le progrès technologique n’est qu’un sous-produit des évolutions de la société et du regard de plus en plus fin que l’Homme porte sur lui-même ; sans souvent se demander si ce ne sont pas plutôt ces transformations philosophiques et sociales qui découleraient du progrès technologique et de l’accroissement des ressources consommables qui en résulte. Pourtant, on peine à imaginer quels progrès philosophiques ou sociaux auraient pu conduire à la découverte de la technique Levallois, du propulseur, du microlithisme, du bronze, de l’imprimerie, de l’informatique ou du laser ! Alors qu’il est aisé de constater que tous ces progrès technologiques ont radicalement changé la manière de vivre et de penser la vie ! Ce ne sont pas les progrès de l’esprit qui créent les progrès technologiques, mais bien les progrès technologiques – souvent inattendus – qui nous imposent de nous adapterindividuellement et collectivement. Ce n’est peut-être pas un hasard si la disparition de l’esclavage (très progressive et non totalement parachevée à ce jour en attendant que les robots en renouvellent le concept) fut contemporaine de la révolution industrielle ? Aristote n’avait-il pas plaisanté prophétiquement en disant que ‘’si les navettes marchaient toutes seules, on pourrait se passer d’esclaves’’ ? Pas de chômage de masse dans l’antiquité ! Et pas de progrès de la société ou de l’esprit humain qui serait détaché des avancées technologiques. Dans le vrai Monde, nous faisons simplement preuve d’un opportunisme adaptatif, sans avoir aucune possibilité de modifier les bornes du programme génétique de Sapiens sapiens, dont découle essentiellement notre comportement individuel et social ; comportement qui reste globalement identique à celui d’un Chimpanzé ; mais d’un Chimpanzé davantage capable de modulation comportementale, de multiplication des cercles d’appartenance, d’abstraction et de communication à courte, moyenne et longue portée que ceux qui vivent encore dans les arbres ; et qui est de ce fait doté d’un rayon d’action supérieur.
La technologie est un vecteur de l’expansion des gènes
Comme la guerre – dont elle est la fille – la technologie est un puissant vecteur de l’expansion des gènes. Au cours de l’histoire des derniers millénaires, il a été facile de constater que la maitrise d’un progrès technologique a généralement conféré un avantage décisif sur les groupes ethnoculturels voisins, tant ce que ce progrès était encore ignoré desdits voisins. N’importe quel Aztèque, Herero, Patagon, Natchez ou Tasmanien pourrait nous le raconter avec éloquence, s’il n’avait pas eu l’in extremis infortune de découvrir un progrès inattendu dans les mains d’adversaires aussi brutaux que brutalement surgis du Néant ! Evacuons cependant notre culpabilité tardive, en nous persuadant que les victimes n’étaient pas meilleures que leurs bourreaux, et que bien avant de rencontrer les premiers Européens, leurs ancêtres et les ancêtres de leurs ancêtres avaient impitoyablement vaincu, massacré, violé et mangé les peuples oubliés qui les avaient précédés sur ce qui n’était pas encore leurs terres. Osons voir et admettre que tout peuple colonisé descend d’ancêtres colonisateurs ; et que ces deux peuples, l’ancien et le nouveau, ont inévitablement échangé des gènes au cours du processus traumatique de leur superposition. A ce petit jeu du ‘’C’est plus chez toi ! Maintenant c’est chez moi !’’ – dont la reconstitution est le sujet de cette série d’atlas –, tous les peuples sont forts, parce que tous les Humains sont dotés du même programme génétique qui les incite à accaparer un maximum de ressources afin de doper leur potentialité reproductrice ; quitte à ce que ce soit au dépend d’autrui. Nous avons vu que ce programme génétique est loin d’être propre aux Humains, et nous avons vu également que les Humains et les Chimpanzés l’expriment d’une manière particulière qui consiste à s’appuyer massivement sur tout leur groupe patrilocal (clan / tribu), en réalisant un comportement que nous appelons ‘’guerre’’. Mais, contrairement à leurs cousins Chimpanzés, guerriers autant qu’eux, les Humains modernes ont l’immense avantage de pouvoir exprimer ces gènes en s’appuyant également sur une course effrénée aux innovations meurtrières. Sachons donc voir que l’invention des armes à feu qui permirent aux Européens d’exterminer les malheureux peuples cités plus haut, n’était qu’une étape technologique de plus dans une longue liste de progrès à finalité meurtrière, initiée au Paléolithique supérieur. Et sachons voir que ceci fait partie d’un processus universel animé par des gènes qui bouillonnent en nous et qui se trouvent exacerbés lorsque surviennent des stress socio-environnementaux découlant de tensions sur les ressources. Au travers de cet universel ainsi posé, gageons que les premières sagaies eurent des conséquences comparables aux premières armes à feu sur ceux qui tentaient de se défendre cramponnés à leurs épieux ; et que ceux qui inventèrent le propulseur imposèrent sans tarder le silence à ceux qui ne pouvaient pas mieux faire que lancer leurs sagaies à la main …
Autre chose encore : les objets militaires ne sont pas tout quand il s’agit de culbuter le voisin pour prendre sa place ! La démographie compte aussi et beaucoup ; de telle façon que tout progrès technologique qui est de nature à faciliter la vie quotidienne (i.e. à permettre à davantage d’enfants d’atteindre l’âge de la reproduction), doit aussi être considéré comme une arme utilisable contre son voisin, si ce voisin ne dispose pas lui-même de cet avantage ; et cela, aussi pacifique que cette arme puisse paraitre au premier abord ! Car une démographie excessive engendre un stress socio-environnemental massif en fragilisant l’accès aux ressources ; stress qu’il sera généralement plus performant d’évacuer au détriment des voisins qu’au détriment de ses propres frères. Ce phénomène sera particulièrement criant au Néolithique en raison de l’invention de l’économie de production et des marrées humaines qui naitront de cette invention, et qui écraseront tout [cf. atlas n°4] ! Mais les progrès matériels du Paléolithique [cf. ci-dessous] et ceux du Mésolithique purent aussi avoir des conséquences similaires quoique de moindre ampleur.
Faute de mieux, lorsque nous verrons tel groupe ethnolinguistique s’étendre au dépend d’un autre groupe ethnolinguistique dans les cartes de l’atlas n°3, il faudra donc s’interroger sur les aspects démographiques et technologiques qui ont pu se combiner pour faciliter sa réussite et par conséquent précipiter l’échec de ses adversaires. Malheureusement, ces questions généreront plus d’hypothèses que de faits étayés.
Un Monde Paléolithique moyen technologiquement inhomogène
Parvenir à dater et à localiser les grands progrès technologiques du Paléolithique, serait par conséquent très utile pour le propos que nous nous sommes donné, qui est de reconstituer les mouvements humains anciens. Malheureusement, malgré l’enrichissement de la palette des techniques de datation des restes organiques et non-organiques, nous ne sommes pas encore capables de proposer un maillage chronologique et géographique fin de l’ensemble des vestiges connus. En attendant un bienvenu complément des données, un fait cependant saute aux yeux pour peu qu’on y prenne garde : pendant une grande partie de la dernière glaciation, le (Vieux) Monde fut partagé en trois grandes régions technologiques assez bien circonscrites :
- l’Afrique, et en particulier l’Afrique de l’Est et l’Afrique du Sud où des technologies caractéristiques du Paléolithique supérieur apparurent très tôt, avant même le MIS 5e par lequel s’est conclu l’atlas n°2. Bien que remarquablement avancées pour leur époque, on classe généralement ces industries dans le Paléolithique moyen, mais sans toujours préciser qu’il s’agit d’une version du Paléolithique moyen très particulière à l’Afrique et qui annonce déjà largement le Paléolithique supérieur. On l’appelle plus exactement ‘’Âge Moyen de la Pierre’’ (Middle Stone Age, MSA). Malheureusement, parce qu’elle comprend le terme ‘’moyen’’, cette dénomination à l’inconvénient de ne pas mettre en valeur les nombreuses manifestations modernes (outils laminaires, outils en os, objets de parures, utilisation de pigments) du MSA africain que nous faisons transparaitre sur nos cartes via les mentions successives ‘’mode 3-(4)’’, ‘’mode (3)-4’’, ‘’mode 4-(5)’’ et ‘’mode 5’’, proposées pour rendre compte de l’évolution graduelle de la technologie des Hommes modernes africains. En Afrique, l’évolution technologique fut précoce et graduelle ; tandis qu’elle fut plus tardive en Eurasie où elle se fit davantage sur un mode de ruptures successives. Conservant longtemps son avance, la technologie africaine évoluera plus rapidement que partout ailleurs jusqu’au second maximum glaciaire (première moitié du MIS 2).
- l’essentiel de l’Eurasie, où un vieux Paléolithique moyen très classique et très immobile (‘’mode 3’’) perdura bien plus longtemps qu’en Afrique. Et cela malgré l’arrivée de l’Homme moderne qui provenait pourtant d’une Afrique en avance sur son temps. Au point qu’il fallut attendre la seconde partie de l’Interpléniglaciaire (seconde partie du MIS 3) pour que commencent enfin à apparaître, sur le nouveau continent, les marqueurs caractéristiques du Paléolithique supérieur ; marqueurs qui – seulement alors – devinrent pratiquement identiques à ceux qui étaient apparus en Afrique au moins 100.000 ans plus tôt ! Ce décalage remarquable doit pouvoir être expliqué !
- l’Asie du Sud-Est et l’Océanie, enfin, qui constituèrent l’inexpugnable bastion d’un Paléolithique inférieur devenu presque éternel, figé dans une antiquissime technologie de ‘’mode 1’’ ; qui était cependant agrémentée de-ci de-là par des vestiges lithiques d’allure un peu plus modernes, que certains chercheurs rattachent parfois vaguement au ‘’mode 2’’ et/ou au ‘’mode 3’’, mais sans conviction. Constatant ce retard abyssal, plusieurs préhistoriens ont avancé qu’il n’était qu’une simple illusion optique liée au fait que les habitants de ces régions auraient développé une industrie moderne radicalement différente de celles que nous observons partout ailleurs, puisqu’elle aurait été entièrement constituée d’outils en bambous qui ne se seraient pas conservés jusqu’à nous. Toutefois, dans les pages qui suivent, c’est par une hypothèse cognitive bien différente que nous expliquerons ce retard local. Mais quoi qu’il en soit de la valeur de notre hypothèse, on observe bel et bien que cette préhistoire de la préhistoire ne prendra vraiment fin qu’au beau milieu de l’Holocène en Asie du Sud-Est ! C’est-à-dire franchement hier ! Paradoxalement, puisque géographiquement située plus loin encore, le monde australien se dégagera plus rapidement que la péninsule indochinoise et l’Indonésie de cette gangue passéiste ; nous tenterons aussi de l’expliquer.
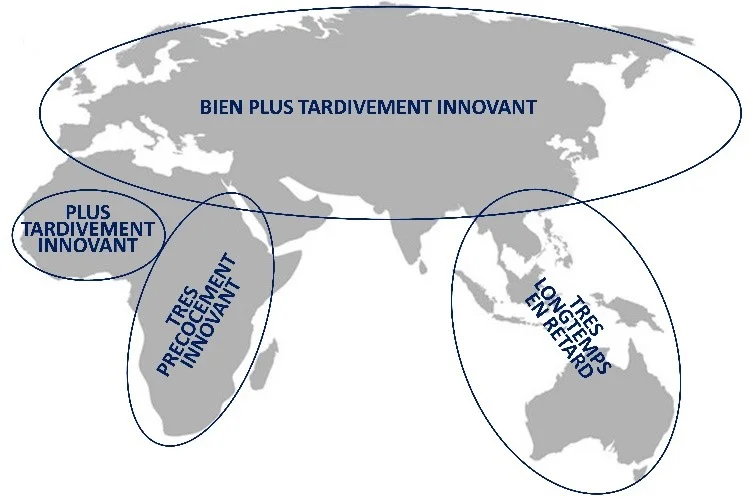
Progrès innovant
Des progrès difficiles à dater
Nous avons déjà examiné les chronologies relatives offertes par la sédimentation continentale et marine, et par la chronologie plus précise des carottes de glaces. Mais tout ceci ne nous dit rien sur la date des sites archéologiques et de ce qu’on y trouve. Depuis 70 ans, plusieurs méthodes de datations dites absolues ont été mises au point mais aucune de ces méthodes n’est pleinement satisfaisante en raison de marges d’erreurs parfois importantes. De plus, on constate souvent d’importants écarts entre deux méthodes utilisées sur un même site, ce qui signifie qu’on devrait systématiquement solliciter plusieurs méthodes sur chaque site avant d’appliquer un seuil décisionnel raisonné en fonction du contexte. Procédure rarement suivie.
Ceci étant dit, l’accumulation des datations absolues permet quand même de circonscrire grossièrement l’apparition d’un certain nombre de progrès technologiques dans les trois grandes régions du Monde examinées plus haut. C’est ainsi que nombre de ces progrès apparaissent d’âge ancien en Afrique, d’âge moyen en Eurasie, et d’âge très récent en Asie du Sud-Est. Cet important contraste géographique rend par conséquent impossible une datation des progrès technologiques qui aurait une portée universelle. Au total, nous devons nous contenter de quelques jalons imprécis qui sont résumés ci-dessous et que nous retrouverons dans les commentaires des cartes :
- Les vêtements. Les poux de tête et les poux de corps – c’est-à-dire les poux de vêtements – se seraient génétiquement séparés après v. 190.000 AEC. Bien que controversée, cette date proche de celle de l’apparition d’Homo sapiens sapiens rend plausible que le concept de vêtements découle de la mutation cognitive qu’il faut postuler à l’origine des Hommes modernes. Les vêtements sont à la fois des messages sociaux et des ‘’tropiques portatifs’’ ; ils permirent à notre espèce thermophile de supporter la vie dans les régions froides, sans avoir à subir de lentes transformations biologiques. De leur côté, dépourvus de vêtements mais disposant de beaucoup plus de temps que n’en eurent les Hommes modernes, les Hommes archaïques septentrionaux développèrent sans doute une véritable adaptation biologique au froid. En l’absence de vêtements, ils se protégeaient probablement à l’aide de peaux non ajustées ; mais étaient-ils par ailleurs recouverts d’un pelage abondant ? Certains le pensent. Cela ne signifie pas que leurs ancêtres sortis d’Afrique avaient été hirsutes avant eux, mais que le pelage pourrait être revenu chez eux en tant qu’adaptation classique des climats froids. Grâce à leurs vêtements, les Humains moderne qui peuplèrent le Nord furent dispensés de cette résurgence du pelage.
- Les bateaux. L’invention de la navigation est difficile à dater. Il est très probable qu’en période de basses eaux, des détroits de quelques kilomètres de large – c’est-à-dire dont l’autre rive était visible – ont volontairement été franchis dès le Paléolithique inférieur ; simplement sur des troncs ? C’est comme cela que nous avons expliqué l’arrivée de l’industrie acheuléenne en Europe du Sud-Est, v. 650.000 AEC, lorsque les conditions hyper-glaciales du MIS 16 avait réduit le détroit de Gibraltar à un très mince chenal [cf. atlas n°2]. Mais c’est seulement au temps des Hommes modernes qu’on vit des archipels être colonisés ; peut-être grâce à des embarcations un peu plus sophistiquées ? Des outils crétois pourraient être datés v. 130.000 AEC, et, si cela est vrai, leurs auteurs ne pouvaient venir que de la mer. Mais la datation est-elle fiable sachant que la Crète ne livre aucun autre vestige plus récent avant le Néolithique ? Et qui ces Hommes pouvaient-ils être ? De telles découvertes sont isolées et sujettes à interprétations … Avec certitude, cette fois, des embarcations furent utilisées pour atteindre le Sahul (bloc Nouvelle-Guinée + Australie + Tasmanie) aux alentours de 60 à 50.000 AEC. Seules des îles visibles depuis une côte peuplée pouvaient entraîner l’idée de les coloniser pour en exploiter les ressources supposées. De ce fait, les grandes îles lointaines de la planète (Madagascar, Nouvelle-Zélande) ne furent peuplées qu’il y a moins de 100 ou 50 générations ; et la Réunion il y a 15 générations seulement.
- Les sépultures / les croyances en un au-delà ; les manifestations ‘’artistiques’’ / les croyances magiques.L’observation de pratiques sépulcrales atteste ipso facto la croyance des membres du peuple étudié en l’existence d’un autre Monde ; et donc l’existence de capacités cognitives d’abstraction et de symbolisation. C’est au Levant, v. 100.000 AEC que l’on trouve les premières preuves de sépultures intentionnelles ; c’est-à-dire hors d’Afrique où de nombreux comportements modernes se manifestèrent pourtant bien plus tôt qu’ailleurs. Cependant, une absence de sépulture ne signifie pas nécessairement une absence de croyance. On le constate notamment chez les peuples subactuels qui pratiquaient la manducation rituelle des morts dans l’objectif de pérenniser leur existence dans le corps social et de faciliter leur réincarnation dans le corps des enfants à naitre ? Ou encore chez les peuples (dont les Parsis actuels) qui offrent intentionnellement leurs défunts en pâture à des animaux sauvages qui sont supposés assurer leur passage dans le Monde des Esprits ? De telles pratiques ne témoignent pas moins que les inhumations de la croyance en un ‘’ailleurs’’ ! Malheureusement, elles ne sont évidemment ni repérables ni datables …
Quant au mot ‘’art’’, il ne doit pas nous leurrer, car ce qui nous apparait comme tel n’était certainement pas de ‘’l’art pour l’art’’ jusqu’à l’époque de la Grèce classique et même bien au-delà ; il faut plutôt y voir – une fois encore – la marque d’un accès à la pensée abstraite et symbolique qui nous permet d’imaginer l’existence d’un autre Monde situé au-delà de notre Monde matériel, et qui nous incite à essayer d’assujettir à notre profit les forces mystérieuses qui le peuplent ! Notons bien que cette remarque utilitaire ne retire absolument rien à l’immense progrès cognitif qu’implique l’art ; progrès qui n’est en définitive qu’une autre facette de celui qui présida à l’apparition des rites sépulcraux, visibles ou non. En se basant sur des preuves bien minces, certains chercheurs ont voulu repousser l’origine de l’art en des âges fantastiques, sur la foi d’un caillou étrangement contourné ou d’un coquillage strié que d’autres chercheurs interprètent comme pouvant résulter de phénomènes naturels. Il arrive aussi que les grandes marges d’erreur de certaines méthodes de datation ne soient pas beaucoup soulignées par ceux que le gout du merveilleux et des scoops médiatiques pourrait conduire à officialiser la découverte d’un téléphone portable dans une tombe étrusque … Plus posément et plus certainement, c’est en Afrique de l’Est, précocement moderne, qu’on a révélé les manifestations ‘’artistiques’’ les plus anciennes grâce à des restes de pigments intentionnellement collectés qui ont été datés du MIS 7 (entre v. 240.000 et 190.000 AEC) [cf. atlas n°2]. Plus tard, v. 100.000 AEC (MIS 5c), des colorants (ocre, hématite) furent intentionnellement utilisés et parfois même transportés sur de grandes distances, ainsi qu’on le constate en plusieurs lieux d’Afrique et de la proche Eurasie ; à la même époque, on observe aussi des coquillages intentionnellement percés qui durent servir de pendentifs. Enfin, si l’on veut mieux que de ‘’simples’’ dépôts de couleurs ou de coquillages troués, les plus anciennes manifestations ‘’artistiques’’ élaborées, proviennent d’Afrique du Sud au début du MIS 4, v. 75.000 AEC : il s’agit de pierres colorées et gravées de motifs géométriques complexes, qui ont été trouvées associées à des objets de parure en coquillage ; tandis qu’en Eurasie, il faudra attendre la seconde partie du MIS 3 pour constater des artéfacts similaires (v. 50.000 à 45.000 AEC).
L’art fut-il l’apanage des Humains modernes ? Nous le pensons. Pourtant, plusieurs trouvailles ont associé l’art et des individus de morphotype néandertalien ! Cela semble véridique, mais c’est toujours dans des régions proches et à une époque proche du contact des Néandertaliens avec des Hommes modernes, comme on pourra le visualiser sur les cartes. Il est d’ailleurs intéressant de constater que les découvertes artistiques ne sont jamais absentes de controverses lorsqu’elles proviennent de régions où vivaient des Humains archaïques encore potentiellement vierges de tous contacts avec des Humains modernes. Alors, un Néandertalien de ‘’pure souche’’ pouvait-il être artiste ? Si l’on tient absolument à faire une réponse positive, il faut comprendre que cela signifie qu’une souche mutante ‘’normo-cognitive’’ apparut un jour parmi les Néandertaliens d’Eurasie : c’est-à-dire que survint une mutation cognitive génétiquement différente et géographiquement éloignée, mais phénotypiquement convergente de celle qu’on situe à l’origine des Humains modernes en Afrique de l’Est ! Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, pourquoi cette mutation aurait-elle coïncidé dans le temps et dans l’espace avec la proche présence d’Humains modernes sur le sol d’Eurasie ? Puisque les ancêtres levalloisiens des Néandertaliens sont arrivés en Eurasie au MIS 9 (entre v. 340.000 et 300.000 AEC) [cf. atlas n°2] et puisque leurs descendants ont traversé trois cycles glaciaires / interglaciaires sans jamais produire de manifestations artistiques, pourquoi les Néandertaliens seraient-ils devenus artistes tout d’un coup, précisément à l’époque et dans les régions des contacts avec l’Homme moderne ? Au total, ce scénario est peu crédible, tandis qu’un impact des métissages sur la cognition apparait plus probable. Reste aussi la possibilité d’un ‘’simple’’ comportement d’imitation ? Cependant, pour imiter quelqu’un il faut non seulement disposer des cognitions nécessaires pour le faire, mais il faut aussi l’avoir rencontré ; or nous avons étudié plus haut la dynamique populationnelle qui résultait de toutes rencontres entre des peuples primitifs…
L’art est-il une arme ? Oui, c’est une arme magique invoquée pour augmenter notre puissance et pour nous protéger des autres ; qu’il s’agisse d’Humains ou d’Esprits ! Et c’est peut-être aussi une arme psychologique car on peut se demander quelle terreur panique pouvait naître chez un Homme archaïque voyant arriver, dans ses ancestrales collines, de surréalistes individus lardés de coquillages tintinnabulants, aux visages zébrés de bandes rouges et jaunes, et dont la tête était surmontée d’un diadème de plumes agitées par le vent ? - Le débitage d’outils laminaires / macro-lames / ‘’mode 4’’. La vieille technique Levallois – peut-être apparue en Afrique de l’Est v. 650.000 AEC (MIS 16) [cf. atlas n°2] – consistait à préparer un nucleus de pierre à partir duquel on débitait des éclats relativement épais qui allaient constituer les outils désirés ; cela après avoir ou non retouché les éclats. Cette méthode de production d’outils en deux (ou trois) temps fut globalement synonyme du Moustérien dans une grande partie de l’Eurasie, et de technologies de ‘’mode 3’’ voisines du Moustérien ailleurs dans le Monde. Le ‘’mode 4’’ technologique en dériva directement : des cognitions plus performantes et une maitrise praxique supérieure permirent à l’artisan moderne d’exercer des pressions de force et de direction très précises en des endroits du bloc soigneusement prédéterminés ; de cette action résulta le débitage de grandes lames minces détachées de nuclei de forme le plus souvent prismatique, forme qui est assez caractéristique des industries paléolithiques supérieures d’Afrique et d’Eurasie occidentale ; lesquelles lames étaient ensuite retouchées en fonction de l’usage désiré. Mais, en première étape, ces manœuvres nécessitaient une réflexion élaborée sur la nature des matériaux et la façon dont ils réagissent ; c’est ce qui explique pourquoi nous retrouvons parfois des blocs de pierre dont la géologie nous enseigne qu’ils ont été ramassés à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de leur débitage. En outre, ce n’est certainement pas un hasard si, sur les sites archéologiques, la production de grandes lames est souvent associée aux témoignages d’une pensée abstraite, tels que l’art ou les sépultures. En Eurasie, ce ‘’mode 4’’ apparut v. 50.000 AEC (milieu du MIS 3) et fut la technologie caractéristique de la partie ancienne du Paléolithique supérieur (Paléolithique Supérieur Initial, PSI). Toutefois, des outils comparables apparurent bien plus tôt en Afrique puisqu’on en connait déjà entre v. 240.000 et 190.000 AEC (MIS 7) dans des industries que l’on peut tout aussi bien attribuer au ‘’Sangoen récent’’ qu’au ‘’Lupembien ancien’’ étant donnée l’évolution graduelle des industries africaines. Très tôt toujours, v. 200.000 AEC au cours du MIS 7, ces outils de ‘’mode 4’’ apparurent dans l’industrie Hummalienne du Levant, qui resta cependant sans lendemain et fut de nouveau remplacée par du Moustérien de ‘’mode 3’’ [cf. atlas n° 2 – carte X]. L’explication de ce va et vient technologique s’intègre dans l’hypothèse cognitive qui sera présentée en fin d’introduction.
- Les armes composites (bois et pierre) : d’estoc ou lancées ? Des traces d’emmanchement des outils sont visibles dès le Paléolithique moyen, aussi bien en Eurasie moustérienne que dans les cultures MSA d’Afrique. Cette relation avec le Moustérien incite à penser que le début des emmanchements pourrait avoir été contemporain de l’apparition de la méthode Levallois ? Quoi qu’il en soit, sur le continent originel que nous avons dit très en avance sur le reste du Monde, les pointes atériennes – parfaites dès v. 80.000 AEC (MIS 5a) mais découlant de prototypes plus anciens – furent fabriquées avec une soie qui était sans contestation possible destinée à faciliter leur emmanchement. Ces armes anciennes étaient-elles lancées ou simplement maniées d’estoc au poing ? Des épieux primitifs – avec une pointe pouvant être durcie au feu – existaient déjà au Paléolithique inférieur. Ce n’était pas des armes de jet : pour les utiliser à la chasse ou à la guerre, il fallait s’approcher au plus près du gibier ou de l’ennemi qu’on voulait embrocher.Au Paléolithique moyen, les épieux moustériens – pouvant désormais être terminés par une pointe de pierre emmanchée – devaient encore être utilisés d’estoc. En revanche, une sagaie est un objet plus léger qu’un épieu et que l’on peut de ce fait lancer pour atteindre son adversaire sans trop s’en approcher ; pour cela, elle est composée d’une hampe en bois, surmontée d’une fine pointe en pierre ou en os. De quand ce progrès date-t-il ? En Afrique du Sud, il est possible que des armes composites propulsées (à la main ou au propulseur ?) aient existé dès l’époque de Still-Bay, au tout début du MIS 4, c’est-à-dire dès 70.000 AEC environ ; par ailleurs, c’est à la même époque et dans la même région que les premières colles chauffées sont attestées, ce qui n’est peut-être pas sans rapport. Mais en Eurasie, les sagaies pourraient être apparues seulement v. 50.000 AEC, avec tout le reste de la panoplie du Paléolithique supérieur ? De ce fait, on peut se demander si elles n’ont pas été le vecteur de la grande et rapide extension des peuples Déné-Caucasiens qui se répandirent à l’Est et à l’Ouest aux alentours de cette date ? En tout cas, les sagaies seront des marqueurs caractéristiques de l’Aurignacien européen, dont il est légitime de rattacher l’expansion à ce groupe ethnolinguistique comme cela est proposé dans le présent atlas n°3. Apparus dès l’Aurignacien, les fameux ‘’bâtons percés’’ (autrefois dits ‘’bâtons de commandement’’) auraient été des outils complémentaires, utilisés pour mettre en forme les hampes et/ou les pointes (os, ivoire) de ces sagaies.
- Les aiguilles à chas. Des pointes en os qui auraient pu être utilisées comme des alènes ont été découvertes dans les sites MSA d’Afrique du Sud, aux alentours de v. 60.000 AEC, au voisinage de la limite entre les MIS 4 et MIS 3. Toutefois, jusqu’à présent, les aiguilles à chas les plus anciennes ont été retrouvées en Eurasie. Quoi que cela ne soit pas attesté par l’archéologie, elles pourraient être apparues dans la région du ‘’hub’’ moyen-oriental en même temps que le reste de la panoplie du Paléolithique supérieur eurasien, peut-être v. 50.000 AEC ? Puis, au sortir du MIS 4, l’aiguille à chas aurait constitué un important vecteur de l’expansion humaine sur la ‘’voie du Nord’’, reliant le Moyen-Orient à la Chine via le système des steppes asiatiques. De fait, une aiguille à chas trouvée à Denisova (Altaï) daterait d’environ 42.000 AEC, date où l’expansion Eurasiatique avait déjà atteint ces lieux en provenance du Moyen-Orient [cf. carte L] ; mais il serait logique que l’expansion Déné-Caucasienne – qui la précéda selon toute vraisemblance – ait déjà bénéficié de cet accessoire indispensable à la confection de vêtements chauds sans lesquels il aurait été impossible de traverser les hivers sibériens du MIS 3. Au second pléniglaciaire, les aiguilles à chas seront bien attestées en Europe. Au total, ce petit instrument d’apparence anodine – qui permettait de réaliser des vêtements complexes bien ajustés – pourrait avoir été déterminant pour le succès de l’expansion humaine dans les régions froides. En ce sens – comme tous les progrès qui facilitent la vie des Hommes – il s’est agi d’une arme miniature, que l’on peut imaginer surtout maniée par des femmes ; guerrières à leur façon !
- Les lamelles / ‘’mode 4-(5)’’ et les microlithes / ‘’mode 5’’. Dans la longue marche vers notre Monde actuel, la miniaturisation des lames de pierre, ou microlithisme, fut une étape aussi importante que l’agriculture, la poterie, le métal, l’écriture, l’imprimerie ou l’informatique ; l’un de ces progrès technologiques qui articulèrent un ‘’avant’’ et un ‘’après’’ où tout était significativement différent. Des pièces lithiques de petite taille sont attestés dès v. 70.000 AEC (début du MIS 4) dans les industries précocement modernes du Sud de l’Afrique. Techniquement, cela réalise une industrie de ‘’mode 4-(5)’’ qui se serait développée environ 35.000 ans plus tôt qu’en Eurasie ! Certains chercheurs qualifient ces petites pièces d’authentiques microlithes tandis que d’autres atténuent la portée de ces découvertes en avançant que les petites pièces anciennes – non géométriques – pourraient n’avoir été que des déchets de fabrication ou bien des lames plusieurs fois retouchées ‘’jusqu’au trognon’’ mais sans qu’elles résultent d’une véritable conception planifiée pour réaliser des outils complexes. Mais alors, pourquoi ne trouve-t-on pas de tels déchets partout avant ou partout ailleurs ? La même question se posera en Eurasie du Paléolithique Supérieur Moyen (PSM), avec les premières pièces lithiques de petite taille – souvent qualifiées de lamelles – dont le statut véritablement microlithique est discuté par des chercheurs plus ou moins enclins à le leur accorder [cf. carte O]. C’est pour cette raison que nous qualifions cette étape PSM de ‘’mode 4-(5)’’, désignation qui permet de la distinguer des microlithes plus récents. Plus tard, les microlithes géométriques du Paléolithique Supérieur récent (PSR) furent sans conteste des modules standardisés qui étaient intentionnellement miniaturisés pour être emmanchés sur des armatures de bois ; il en résultait des outils complexes diversifiés, dont la forme et la fonction préfiguraient déjà ceux qui, plus tard, furent réalisés en métal. Nombre de ces microlithes devaient entrer dans la fabrication d’outils contondants, parmi lesquels des projectiles barbelés. Dans certaines régions d’Afrique, ces microlithes géométriques apparaissent au début du MIS 3, c’est-à-dire v. 55.000 AEC. Dans l’atlas, nous attribueront ce type d’industrie avancée à un ‘’mode 5’’, succédant au ‘’mode 4-(5)’’ du MIS 4. En Eurasie, la miniaturisation des pièces lithiques fut, nous l’avons dit, plus tardive qu’en Afrique ; sans trancher le débat entre chercheurs sur leur nature de ‘’lamelles’’ (simples lames de petite tailles) ou de véritables ‘’microlithes’’ (destinés à réaliser des outils complexes), on peut dater les débuts de la miniaturisation eurasienne aux alentours de 35.000 AEC et la situer une fois de plus dans la région du ‘’hub’’ moyen-oriental en raison de la dynamique multiaxiale de son expansion géographique. Ainsi, on trouve des microlithes v. 33.000 AEC en Inde, au Levant et en Asie Centrale ; vers 30.000 AEC en Europe gravettienne et dans les steppes proches de l’Altaï ; vers 26.000 AEC en Mongolie et en Cis-Baïkalie ; vers 24.000 en Sibérie Orientale, en Mandchourie et en Chine du Nord ; et vers 22.000 AEC en Afrique du Nord qui avait jusque-là pris du retard sur le reste de l’Afrique dont elle était coupée par la barrière du Sahara qui est toujours hyperaride pendant les périodes glaciaires. A cette époque ‘’récente’’ de la seconde partie du Paléolithique supérieur eurasien (Paléolithique Supérieur Moyen, PSM et Paléolithique Supérieur Récent, PSR), les progrès technologiques continuaient d’être véhiculés par les migrations humaines mais pouvaient désormais également se répandre d’une population moderne à une autre, selon un processus d’acculturation qui se mit alors – et alors seulement – à fonctionner de la même façon qu’aujourd’hui ! De sorte que, pour la première fois, c’est à partir de cette époque (seconde partie du MIS 3) que le mot ‘’culture’’ peut véritablement commencer à être utilisé à bon escient sur le continent eurasien. Nous avons vu cependant que le Sud-Est asiatique et le monde australien restèrent réfractaires à tous ces progrès jusqu’à l’Holocène.
- Le Propulseur. Le propulseur est un outil remarquable qui démultiplie la force du bras pour lancer un projectile emmanché ; que ce soit à la chasse ou à la guerre, qui n’étaient pour les peuples premiers que deux facettes d’une même réalité. Peut-être avant même le développement d’un véritable microlithisme, le propulseur découla-t-il d’une tendance à la miniaturisation des pièces lithiques, et du développement des outils en os. Il n’existe aucune preuve de l’utilisation du propulseur en Afrique, mais on ne peut pas exclure que certaines pointes de petite taille très anciennes, atériennes ou nubiennes, n’aient pas été emmanchées pour être propulsées ? Auquel cas, cette invention pourrait dater d’environ 70.000 AEC, dans une Afrique qui fut précocement innovante dans bien des domaines et qui le fut tellement que d’authentiques arcs auraient même pu rendre le propulseur obsolète dès v. 50.000 AEC, au moins dans certaines régions d’Afrique [cf. ci-dessous] ? Cette inconnue africaine étant posée, le propulseur apparait essentiellement dans nos sources comme une technologie propre au continent eurasien et de ses deux prolongements lointains, l’océanien et l’américain. En Eurasie, le propulseur est attesté v. 30.000 AEC, mais il pourrait avoir été plus ancien puisqu’on le trouve aussi bien à l’Ouest chez les *Gravettiens, qu’à l’Est chez les Eurasiatiques Amérindes qui semblent s’être séparés les uns des autres entre v. 45.000 et 35.000 AEC et dont l’expansion respective devrait peut-être lui être attribuée ? Ceci dit, rien n’empêcherait qu’une technologie de ce type ait été réinventée plusieurs fois en plusieurs lieux. En Amérique, le propulseur était encore en usage lorsque les Espagnols vinrent mettre un terme brutal à l’évolution séparée de ses habitants. Les Australiens aussi utilisèrent le propulseur jusqu’à ce que les Anglais s’imposent tout aussi brutalement sur leur sol. A ce propos, il est intéressant de remarquer que la Tasmanie ignora toujours son usage jusqu’à l’extermination de ses habitants, probablement parce que ceux-ci étaient les derniers représentants d’une Humanité moderne ancienne, antérieure à son invention.
- L’arc et les flèches. Nous avons déjà rencontré plus haut cette technologie demeurée en service actif jusqu’au seuil de notre époque, puisqu’elle était encore sollicitée dans des guerres tribales océanienne qui ne prirent fin qu’au milieu du XX° siècle. En effet, nous avons dit qu’en Afrique, de petites pointes pourraient avoir servi de pointes de flèche dès v. 50.000 AEC voire dès le début du MIS 4, remplaçant peut-être des prototypes plus anciens qui auraient été mus à la main ou par d’hypothétiques propulseurs africains non encore attestés ? En Eurasie, ce progrès, comme bien d’autres, fut beaucoup plus tardif. Il est possible que les peuples européens aient déjà connu l’arc et les flèches dès v. 20.000 AEC si les petites pointes de la gravette étaient des pointes de flèches comme certains l’ont avancé ? Mais, en Europe, le premier arc authentifié date de l’interstade de Lascaux, aux alentours de 18.000 à 17.000 AEC [cf. carte T].
- La céramique et la poterie. Comme les autres progrès évoqués dans ces pages, l’invention de la céramique se situe à des époques très différentes selon les lieux étudiés. Les toutes premières céramiques connues au Monde proviennent de l’Europe Centrale gravettienne (Pavlovien) v. 29.000 AEC, c’est-à-dire vers la fin du MIS 3. Mais il s’agissait d’artéfact à vocation ‘’artistiques’’, qui n’étaient absolument pas adaptés à un usage domestique. Pour cela, il faudra attendre le milieu du MIS 2 où les premières poteries utilitaires du Monde seront observées v. 20.000 AEC en Chine du Sud ; c’est-à-dire paradoxalement dans une région qui avait mis longtemps avant d’exprimer des marqueurs modernes. Il est difficile de comprendre ce que ce contraste signifie ? A partir de là, les poteries diffuseront assez rapidement en Eurasie Orientale ; mais elles ne seront connues qu’après le début de l’Holocène en Asie Occidentale, en Europe et en Afrique.
Au travers de ces divers exemples partiellement accessibles à l’observation, deux faits se dégagent :
- A partir du Paléolithique supérieur en Eurasie, mais dès l’Âge Moyen de la pierre (MSA) en Afrique, l’existence de cognitions modernes peut être postulée étant donné l’observation de marqueurs modernes (i.e., outils lithiques laminaires, outils en os d’utilisation complexe, manifestations ‘’artistiques’’). A partir de là, le rythme des inventions commença à s’enchainer plus rapidement, par rapport aux très lentes avancées des époques précédentes. C’est seulement alors qu’il devient licite de parler de ‘’cultures’’ au sens complet du terme. Mais par rapport au rythme des progrès que nous avons connus dans les derniers millénaires avant le présent, il s’agissait toujours d’un rythme assez lent ! En effet, lorsque l’on prend de la hauteur temporelle pour observer l’ensemble du parcours technologique de l’Humanité moderne depuis la mutation ‘’normo-cognitive’’, on se rend compte que nos ancêtres du Paléolithique supérieur se situaient seulement dans la partie quasi-horizontale de l’asymptote du progrès, tandis que nous nous situons dans la partie quasi-verticale de cette asymptote, en un point désormais tout proche de la singularité technologique qui en constitue l’infini. Le schéma ci-dessus représente cette progression des technologies culturelles où le microlithisme se situe au niveau du point d’inflexion de la courbe.
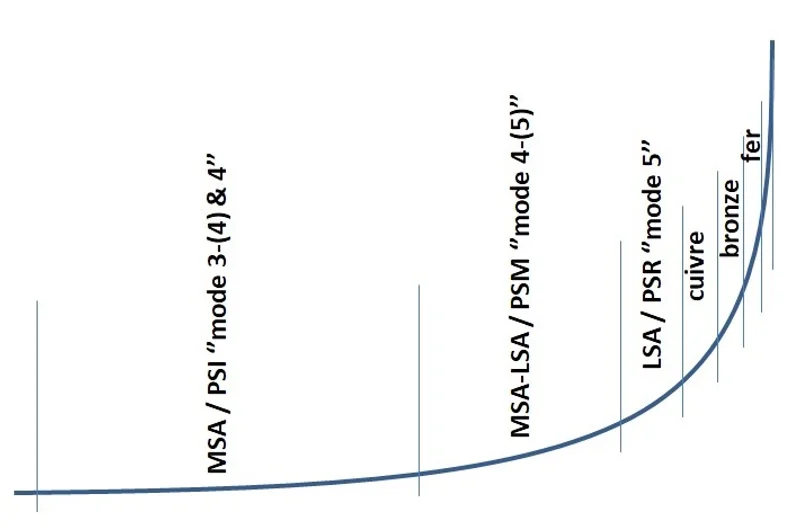
Progression des technologies culturelles
- Quel que soit le nom que les préhistoriens lui ont donné sur les divers continents, le Paléolithique supérieur commença toujours par les même marqueurs déjà cités (i.e., outils lithiques laminaires et outils en os d’utilisation complexe ; manifestations ‘’artistiques’’). A cet égard, répétons-le, il est remarquable de constater que tous ces progrès technologiques – qu’on devine sous la dépendance de cognitions devenues proches des nôtres – se manifestèrent : 1) très tôt sur le continent de naissance de l’Homme moderne ; 2) plus tard dans ses colonies d’Eurasie Occidentale, méridionales et septentrionales, antérieurement peuplées par les Néandertaliens et Néandertaloïdes levalloisiens ; 3) très tard dans ses colonies du Sud-Est asiatique, antérieurement peuplées par des Dénisoviens demeurés attardés dans des vieilles industries de mode 1 héritées du Paléolithique inférieur.
Pourquoi ces constats ?
Ontogénie et phylogénie des cognitions
‘’L’ontogénèse récapitule la phylogénèse’’ ! Depuis la fin du XIX° siècle, cette célèbre maxime de Haeckel a subi bien des critiques. Mais s’il ne s’agit pas d’une loi mathématique, puisqu’on peut lui trouver des failles ici ou là, elle se vérifie néanmoins le plus souvent.
Ontogénèse des compétences cognitives
Comme bien d’autres organes et fonctions, nos cognitions se développent selon un processus ontogénétique qui fut exposé par Piaget dans la première moitié du XX° siècle. Depuis cette époque, les connaissances neurocognitives ont beaucoup évolué et il ne reste rien de concret de l’approche psychanalytique qui a parasité ce travail pionnier. Mais une fois débarrassée de ces scories, la classification de Piaget demeure intéressante en cela qu’elle marque des étapes cognitives repérables, au cours desquelles la grille de lecture du monde et la manière de réagir à cette lecture changent profondément chez les enfants Humains modernes. Pour la résumer, l’enfant passe par une série de stades (et de sous-stades) successifs au cours desquels son intelligence et ses compétences évoluent drastiquement. Sans chercher à critiquer, ni à justifier, ni à détailler les termes de Piaget, les stades repérés sont les suivants :
- stade sensorimoteur (0 à 2 ans). Au cours duquel l’enfant échange avec le monde en utilisant essentiellement une interface sensorielle et motrice.
- stade préopératoire (2 à 6 ans). Au cours duquel l’enfant commence progressivement à manier des symboles et apprend à parler ; mais supplée son incapacité à raisonner logiquement par un fonctionnement de type intuitif. Une première sous-phase dite de ‘’pensée pré-conceptuelle’’ caractériserait l’enfant entre 2 et 4 ans ; à cet âge, il n’a pas encore la possibilité de générer des catégories regroupant des entités qui sont semblables par certains aspects et différentes par d’autres (par exemple, classer un chat et un oiseau dans une même catégorie ‘’animaux’’) ; la lecture (qui nécessite d’associer un signifiant arbitraire à une réalité signifiée) est impossible. A la sous-phase suivante, que Piaget appelle ‘’pensée intuitive’’ et qu’il situe entre 4 et 6 ans, la lecture commence à devenir possible. C’est manifestement lors cette seconde phase du ‘’stade préopératoire’’ que s’arrête le développement cognitif des Chimpanzés / Bonobos, puisque les plus doués et les mieux entrainés d’entre eux sont capables de ces opérations. Ainsi, après un entrainement intense, des Bonobos peuvent apprendre à lire des lexigrammes dépourvus de tous liens évidents avec les choses désignées (symboles) et peuvent même comprendre des actions complexes qu’on leur demande de réaliser via ce média.
- stade des opérations concrètes (6 à 11/12 ans). Au cours duquel l’enfant développe une pensée logique mais seulement basée sur des notions concrètes.
- stade des opérations formelles (> 11/12 ans). A partir duquel le raisonnement abstrait, de type adulte, commence à devenir possible. Cela étant, il reste encore à préciser que la maturation des régions antérieures de notre cerveau (i.e. les régions les plus ‘’cognitives’’) n’est pas terminée avant l’âge de 20 ans environ, et que, donc, le développement ontogénétique du substratum cognitif des Humains modernes ne s’achève vraiment qu’à cet âge. Il est bien évident que ce n’est pas la sagesse des législateurs de toutes époques et de tous lieux qui a fixé au voisinage de 20 ans l’âge de la majorité légale : ce qui compte, c’est le fait biologique que les Humains modernes ne deviennent pleinement performants et donc pleinement autonome qu’à partir de cet âge !
Phylogénèse des compétences cognitives
Par définition, les autres animaux ne sont pas des Humains. Toute tentative d’établir des parallélismes entre leurs facultés cognitives et celles de nos enfants ne peut aboutir qu’à des approximations critiquables. Et cela d’autant plus que la progression des compétences cognitives de nos enfants Humains modernes pourrait être très tôt déformée par une ‘’attraction vers le haut’’ qui pourrait être induite par un effet ontogénétique précoce d’une série de mutations ‘’pro-cognitives’’ qui ont successivement donné naissance au groupe Ergaster, puis au groupe Heidelbergensis, puis au groupe Sapiens archaïque / Néandertaloïde, puis enfin au groupe Sapiens sapiens [cf. atlas n°2]. Toutes ces étapes par lesquelles les ancêtres des Humains actuels sont passés, et par lesquelles AUCUN des ancêtres des autres animaux actuels ne sont passés, y compris ceux des Chimpanzés.
Il n’en demeure pas moins que si tout n’est pas ‘’comparable’’, tout n’est pas non plus ‘’non comparable’’ et que l’estimation de l’’’âge mental’’ des animaux adultes donne au moins une certaine indication de leurs compétences intellectuelles globales. Ainsi, et sous toutes réserves, un Chien pourrait avoir l’intelligence moyenne d’un enfant de 2 à 3 ans (ils connaissent de nombreux mots mais sont inaccessibles à tous symboles et inaccessibles à la logique). Un Macaque pourrait avoir l’intelligence d’un enfant de 4 ans, et un Chimpanzé / Bonobo celle d’un enfant de 5 ans. Ces derniers ont accès aux symboles puisque, avec de l’entrainement, ils peuvent ‘’lire’’ des signifiants arbitraires qu’ils relient correctement à des signifiés concrets issus du Monde réel ; ils ont également la capacité de développer des stratégies, mais ils restent toute leur vie inféodés aux notions concrètes ; et lorsqu’ils s’essaient à dessiner pour nous imiter, ils ne parviennent à produire que des gribouillis informes. Comme des tout-petits enfants.
Compétences cognitives des Humains archaïques
On peut se permettre de prolonger le raisonnement en spéculant sur la cognition des Humains archaïques. En effet, si nous n’avons pas la possibilité de leur faire passer des tests neuropsychologiques, nous avons accès à leurs industries lithiques qui étaient nécessairement le produit de leurs compétences cognitives. Dans l’atlas n°2, nous avons maintes fois constaté que ces industries étaient initialement frustes et se sont très progressivement sophistiquées, selon une dynamique entrecoupée de paliers de très longue durée pendant lesquels nous ne décelons aucun changement ; paliers que nous avons déjà rappelés plus haut dans la présente introduction. Rejetant la notion de ‘’culture’’ au Paléolithique inférieur (les cultures sont caractérisées par la variation rapide de leurs productions dans le temps et dans l’espace ; pas du tout par une uniformité inchangée sur le très long terme), nous avons avancé que l’Oldowayen / mode 1 (début v. 3.000.000 AEC) devait être attribué à Homo ergaster et à ses proches descendants eurasiens appelés Homo erectus antecessor et Homo erectus erectus ; que l’Acheuléen / mode 2 (début v. 1.700.000 AEC) était le produit des capacités cognitives d’Homo heidelbergensis ; et que toutes les industries levalloisiennes et apparentées / mode 3 (début v. 650.000 AEC) étaient le produit des Homo sapiens archaïques regroupés ici sous le nom de Rhodesiensis en Afrique et de Néandertaliens / Néandertaloïdes en Eurasie. Ces compétences longtemps stagnantes n’ont évolué qu’à la suite d’une série de mutations ‘’pro-cognitives’’ qui ont été la matrice phylogénétique du développement ontogénétique par lequel passent encore nos enfants.
Dans cette logique, les individus du groupe ‘’Ergaster, Antecessor, Erectus’’, avec leurs cailloux cassés très frustes (Oldowayen), pourraient avoir atteint l’âge mental d’un enfant de 6 ans, guère plus doué qu’un Chimpanzé. Puis, avec leurs beaux bifaces bien symétriques qui complétaient une panoplie de galets cassés d’allure parfaitement oldowayenne, les Heidelbergensis / Dénisoviens (Acheuléen) pourraient avoir atteint l’âge mental d’un enfant de 8 ans ? Enfin, avec leur méthode cognitive évoluée, consistant à créer d’abord une matrice inutile en elle-même avant de produire des outils utiles à l’issue d’une seconde étape, les Sapiens archaïques / Rhodesiensis / Néandertaloïdes(Levalloisien) avaient accès à une pensée logique qui pourrait avoir été similaire à celle de nos enfants de 10 ans ? Pensée logique mais concrète ! Comme Pierre Dac, à la fameuse question philosophique ‘’Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?’’, qui résume bien le sujet de cette série d’atlas, ils auraient probablement répondu très justement mais très concrètement : ‘’Je suis moi, je viens de chez moi et j’y retourne’’ ! Des individus qui demeureraient cognitivement toute leur vie des enfants de 10 ans (et à fortiori de 8 ans ou de 6 ans pour les stades antérieurs), pourraient-ils créer une civilisation technologique ? Auraient-ils la possibilité de créer une riche culture matérielle ? A l’évidence, la réponse est ‘’Non’’ ! Et c’est pour cette simple et unique raison qu’aucune civilisation technologique n’émergea jamais aux cours des beaux interglaciaires qui précédèrent le nôtre.
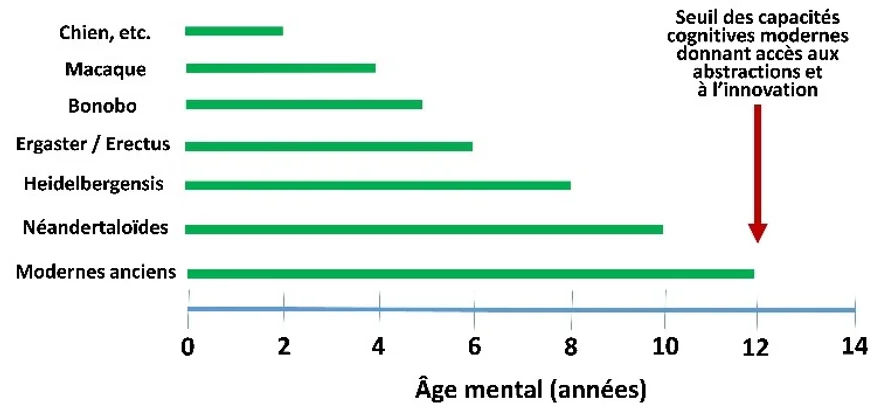
Et les premiers Humains modernes ? Pour accéder aux abstractions, le système de Piaget permet de supposer qu’ils atteignaient un âge mental au moins équivalent à 12 ans ; peut-être pas beaucoup plus au départ ? Il est possible que les premiers individus qui furent capables de cette nouvelle grille de lecture du Monde aient eu d’emblée un avantage sélectif sur tous les autres individus du voisinage ; peut-être parce que les autres étaient plus faciles à berner et à vaincre ? Dans ce contexte, la pression de sélection commença à tirer les cognitions de leurs descendants vers le haut, peut-être à un rythme beaucoup plus rapide que par le passé ?
Le schéma ci-dessus synthétise le raisonnement qui vient d’être tenu et dans lequel les âges mentaux proposés ne doivent pas être compris autrement que comme des ordres de grandeur qui n’auraient de valeur que comparativement les uns aux autres.
Les Hommes archaïques parlaient-ils ? Nous avons déjà abordé ce sujet très débattu [cf. atlas n°2]. Contentons-nous de dire ici qu’il existe des arguments solides pour penser que la configuration anatomique nécessaire à un langage articulé était déjà présente chez les Néandertaliens et que nous sommes moins bien renseignés sur les détails anatomiques des autres Hommes archaïques. Mais rappelons aussi que la plume est apparue bien avant le vol dans la lignée dinosaurienne des oiseaux, ou encore que les doigts et les poumons sont apparus bien avant le petit pas qu’osa faire hors de l’eau un poisson audacieux (cf. atlas n°1). De même, les systèmes biologiques (génétiques, mécaniques et neurologiques) nécessaires au langage, précédèrent nécessairement l’élaboration d’un langage capable de relater des faits et des souvenirs avec précision, et surtout de manipuler et de transmettre toutes les nuances de la pensée symbolique et abstraite (métaphorique). C’est le phénomène classique de l’exaptation : une partie essentielle de la machinerie biologique nécessaire à l’expression d’une fonction est présente AVANT que cette fonction émerge ; ensuite, elle n’a plus qu’à se renforcer grâce à la sélection naturelle qui favorise mécaniquement ce qui est le plus fonctionnellement utile au détriment de ce qui l’est moins ! Certes, les Humains archaïques devaient disposer de capacités de communication qui étaient certainement bien supérieures à celles des Chimpanzés et des Bonobos qui nous émerveillent déjà dans ces domaines. Il est même probable que leur communication comprenait un large éventail de sons et même de mots désignant des réalités concrètes de leur monde (proies, prédateurs, éléments naturels, et même noms personnels …). Mais il est invraisemblable qu’ils aient déjà possédé une pensée abstraite et un langage doublement articulé qui aurait été capable de transmettre toutes les nuances de leur pensée et de leur expérience, car, sinon, une civilisation technologique aurait dû apparaitre rapidement après l’émergence de ces capacités, au cours de l’un des nombreux interglaciaires qui précédèrent notre propre interglaciaire Holocène. Si leur univers technologique a stagné pendant si longtemps [cf. atlas n°2 et rappel chronologique ci-dessus], c’est nécessairement parce que les Humains archaïques – y compris les Sapiens archaïques dont faisait partie les Rhodesiensis africains et leurs proches cousins Néandertaloïdes eurasiens – ne possédaient pas des facultés cognitives et langagières aussi performantes que les nôtres. Où, pour être exact, que celles de la plupart des nôtres, car il existe toujours des Hommes modernes contemporains qui présentent d’importantes difficultés avec ces concepts, quand ils ne leurs sont pas tout simplement inaccessibles.
Pathologie des compétences cognitives
Nous l’avons dit, la comparaison entre la cognition des enfants Humains modernes et celle des animaux ou des Humains archaïques ne peut être qu’indicative d’un état de grandeur. Pareillement, les états pathologiques survenant chez les Humains modernes ne peuvent être invoqués qu’avec réserve pour spéculer sur les compétences cognitives des Humains archaïques. Nous constatons cependant aisément que si la plupart des Humains modernes ont accès à une pensée abstraite, cette compétence reste inaccessible à un certain nombre d’entre eux.
Au-delà de cette observation, il se pourrait que nous parvenions prochainement à comprendre pourquoi et comment ? Dans ce domaine, depuis le séquençage du génome des Néandertaliens et des Dénisoviens, des travaux pionniers commencent à pointer l’association entre des variants archaïques de certains gènes et des pathologies psychiques. L’avenir pourrait nous réserver des surprises en montrant – peut-être – que les individus modernes qui expriment préférentiellement telle ou telle forme archaïque de certains gènes, présentent davantage de difficultés cognitives objectivables que les autres personnes ?
La rencontre des hommes modernes et archaïques
L’atlas n°3 traite abondamment de la rencontre des Humains modernes avec les Humains archaïques. Notamment de leurs rencontres intimes, c’est-à-dire de leur métissage. Etant donné les compétences cognitives probablement différentes que nous venons de discuter à propos des différents types d’Hommes qui se sont succédés, ces métissages auraient-ils eu des conséquences cognitives que nous pourrions déceler archéologiquement malgré l’épaisse couche de terre qui recouvre les lunettes déformantes que nous braquons vers le passé ? C’est le sujet du dernier chapitre de notre introduction.
Le flux génique
Dans l’atlas n°2, nous avons postulé qu’il n’a jamais existé qu’une seule espèce humaine depuis Homo ergaster / erectus / antecessor, qui fut le premier grand singe dont le squelette post crânien était globalement identique au nôtre. La conséquence de cette position étant que toutes les dénominations latines bi-, tri- ou quadri-nominales qui sont couramment utilisées pour décrire la foule hétéroclite de ses descendants, seraient parfaitement abusives d’un point de vue zoologique ; abusives parce que ces dénominations donnent artificiellement l’impression d’un foisonnement de véritables espèces, là où il faudrait plutôt parler de géo-races et de chrono-races ! La notion d’espèce n’est pas consensuelle. Elle est particulièrement malmenée lorsque la passion taxonomique s’emballe et lorsque l’on accorde une foi excessive à cette taxonomie débridée qui voudrait nous forcer à admettre que deux espèces différentes peuvent être interfécondes. Il s’agit pourtant d’une tautologie qui, une fois repérée, devrait nous amener à modérer notre propension à nommer les choses différemment dès lors qu’on se trouve en présence de différences mineures. Restons donc sur la définition totalitaire d’une espèce, basiquement basée sur l’incapacité de ses membres à se reproduire avec ceux d’une autre ! Certes, il existe des semi-espèces : Mulets et Ligrons sont là pour nous l’assurer ! Et certes, nous ne pouvons rejeter a priori ni la notion d’espèce ni celle de semi-espèce lorsque nous étudions les Humains archaïques dont le génome nous est inaccessible et le demeurera peut-être toujours. Tout ce que nous pouvons dire aujourd’hui est que les Humains modernes (Homo sapiens sapiens, apparus v. 300.000 AEC en Afrique de l’Est) étaient interféconds avec les Humains archaïques Néandertaliens (Homo sapiens rhodesiensis / neanderthalensis, apparu v. 650.000 AEC en Afrique de l’Est), et que tant les Humains modernes que les Néandertaliens étaient les uns et les autres interféconds avec les Humains archaïques Dénisoviens, appellation génétique qui correspond vraisemblablement aux Heidelbergensis (Homo heidelbergensis, apparu v. 1.700.000 AEC en Afrique de l’Est) [cf. atlas n° 2 pour ces dates]. Sur la base de ces constats que nous projetons dans un passé encore plus ancien, il est plausible d’inférer qu’Heidelbergensis fut interfécond avec Antecessor et Erectus, c’est-à-dire les formes eurasiennes respectivement occidentales et orientales des premiers Ergaster africains ; mais à l’heure actuelle, cette hypothèse n’est pas formellement démontrable. A ce stade du raisonnement, la notion de chrono-race doit être envisagée. Comme les géo-races, il s’agit d’une première étape d’éloignement entre deux groupes qui continuent d’appartenir à une même espèce en dépit de caractéristiques biologiques mineures en voie de divergence ; mais il s’agit dans ce cas d’un éloignement dans le temps, tandis que les groupes géo-raciaux s’éloignent dans l’espace. Dans les deux cas, cet éloignement est la première étape d’un processus de spéciation ; lequel finira par aboutir ou non à deux espèces en ce qui concerne les géo-races (selon que les races éloignés dans l’espace resteront longtemps séparées ou, au contraire, se réuniront rapidement à l’échelle des générations) ; et lequel aboutira nécessairement tôt ou tard à une spéciation inévitable en ce qui concerne les chrono-races (puisque les individus ne pourront jamais plus se rencontrer à défaut de pouvoir voyager dans le temps). Ainsi, en contradiction apparente avec l’affirmation initiale selon laquelle il n’exista qu’une seule espèce humaine depuis l’apparition d’Ergaster il y a environ 2.000.000 d’années, l’hybridation pourrait très bien être devenue impossible entre lui et nous si nous avions la possibilité de nous rejoindre de part et d’autre de ce gouffre temporel ! Tout comme elle pourrait encore être possible cependant, parce que rien ne vient garantir qu’un écart de 80.000 générations est systématiquement suffisant pour séparer deux authentiques espèces ! Mais, quoi qu’il en soit, cela ne change rien au fait qu’un flux de gêne continu nous relie à Ergaster (et à ceux qui l’ont suivi) à travers le temps, tout comme un flux de gènes continu relie depuis toujours entre elles les géo-races de notre Humanité moderne. Ainsi, les deux extrémités d’un continuum géographique et/ou temporel peuvent très bien constituer des espèces distinctes (au sens d’une absence d’interfécondité) sans que cela n’entrave en rien l’existence continue d’un flux génétique entre ces extrémités. De la sorte, il est hautement probable que les Erectus / Antecessor (arrivés les premiers en Eurasie) ont échangé des gènes avec les Heidelbergensis / Dénisovien (arrivés les seconds en Eurasie) ; tandis qu’il est prouvé que ceux-ci ont bien échangé des gènes avec les Néandertaloïdes (arrivés les troisièmes en Eurasie) ainsi qu’avec les Sapiens modernes (arrivés les quatrièmes en Eurasie). Vu de la sorte, au sens d’un flux de gènes continu, il devient évident qu’il n’exista bien qu’une seule espèce humaine depuis Ergaster ! Au sens d’un échange de gènes continu entre tous ses descendants.
Mais alors, qu’est-ce qui pouvait bien distinguer les diverses chrono-races ou chrono-étapes qui nous séparent de lui ?
Hypothèse structurante
Tout comme la taille d’une personne ou sa pigmentation, ses cognitions sont sous la dépendance principale de facteurs génétiques. De ce constat résulte qu’une rencontre entre des Humains modernes – que nous présenterons dans l’atlas comme ‘’normo-cognitifs’’ – et des Humains archaïques – que nous qualifierons de ‘’pauci-cognitifs’’ –, pourrait avoir eu pour conséquence la naissance de métis dont les compétences cognitives étaient inférieures à celles de leurs parents modernes ? Ce qui pourrait avoir suffi à leur faire perdre temporairement l’accès à l’abstraction, et peut-être aussi l’accès à certaines compétences praxiques nécessaires pour créer le type d’artéfacts que nous attribuons technologiquement au ‘’Paléolithique supérieur’’ / ‘’mode 4’’ ?
En référence au développement ontogénétique des cognitions de nos enfants [cf. ci-dessus], nous avons dit qu’un âge mental d’environ 12 ans au moins doit impérativement être atteint pour accéder à la pensée abstraite. Cette barrière d’âge peut être considérée comme un seuil au-dessus duquel ou en-deçà duquel n’importe quel individu ancien ou actuel peut être situé : on a accès ou on n’a pas accès à la pensée abstraite selon qu’on se situe d’un côté ou de l’autre de ce seuil ! Pour progresser dans le raisonnement, il nous faut maintenant reprendre les estimations d’âge mental grossièrement tentées plus haut ; et nous livrer à des calculs qui sont assurément simplistes dans le détail mais qui illustrent peut-être un principe à prendre en compte ? La base est la suivante : Ergaster / Antecessor / Erectus = 6 ans ; Heidelbergensis / Dénisovien = 8 ans ; Sapiens ‘’Néandertaloïdes’’ / Sapiens rhodesiensis = 10 ans ; Sapiens sapiens ancien = 12 ans = accès à l’abstraction.
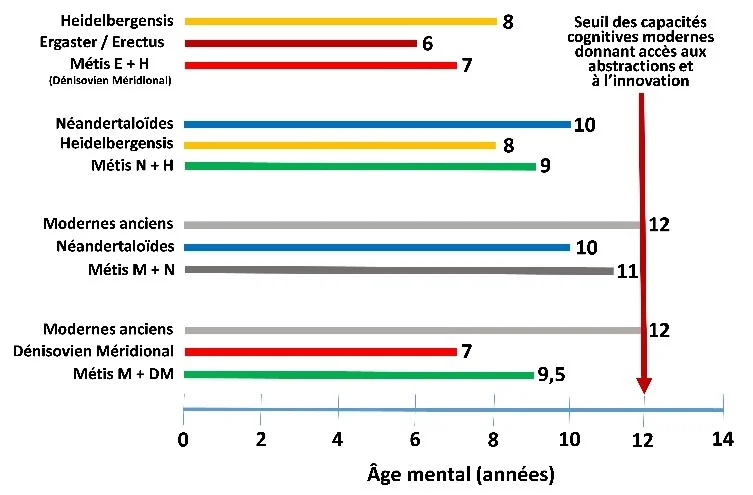
Âge mental
A partir de cette base, si l’on calcule de très bêtes moyennes, un métis ‘’Moderne + Néandertaloïde’’ = 11 ans (= accès limité à l’abstraction) ; un métis ‘’Néandertaloïde + Heidelbergensis’’ = 9 ans (= pensée concrète) ; un métis ‘’Heidelbergensis + Erectus’’ = ‘’Dénisovien méridional’’ = 7 ans (= pensée concrète pauvre) ; et un métis ‘’Moderne + Dénisovien méridional’’ = 9 ans ½ (= pensée concrète). Ces hypothèses sont résumées sur le schéma ci-dessous où l’on visualise bien que tous les métissages survenus entre des Hommes modernes anciens – qui atteignaient tout juste le seuil de la porte du Monde des abstractions et des innovations – et des Hommes archaïques moins compétents qu’eux, pourraient avoir inévitablement ramené les descendants métis dans un état de pensée concrète incompatible avec l’innovation technologique et l’établissement d’une société complexe avancée.
Nos calculs peuvent apparaitre dérisoires, voire même rebutants de bêtise au point de faire regretter au lecteur la patience dont il a fait preuve jusque-là ! Il aurait tort ! Car – illusoire précision mathématique mise de côté – ils constituent un modèle d’explication cohérent de toute l’anthropologie mondiale que nous allons essayer de reconstituer dans l’atlas n° 3 qui couvre l’intégralité de la dernière glaciation. Nous allons nous appliquer à le justifier.
La première expansion des cognitions modernes
Que s’est-il passé à l’origine des Hommes modernes ? Au MIS 8 (seconde phase du complexe glaciaire de Riss), il y a environ 300.000 à 250.000 ans, ce n’est pas une nouvelle espèce humaine qui émergea dans une Afrique de l’Est dont les communautés étaient à la fois démographiquement réduites et en même temps géographiquement fragmentées par la sècheresse qui résultait classiquement d’un épisode glaciaire intense [cf. atlas n°2]. Pas plus que l’apparition d’une plume orange, à l’endroit où tous les autres oiseaux de la même espèce arborent une plume jaune, l’apparition d’une nouvelle particularité cognitive n’impliquait l’émergence d’une nouvelle espèce ! Les espèces n’apparaissent pas en claquant des doigts ! Ne soyons pas dupes de notre esprit de catégorisation qui nous a fait nommer Homo sapiens sapiens idaltu ces premiers Hommes modernes anciens ! Si l’on veut bien sauter au-dessus des barbelés taxonomiques abusivement tendus en travers des prairies où tremblotent les ombres de nos ancêtres, ces étranges noms pseudo-latins ne conservent une utilité que pour scander un processus continu.
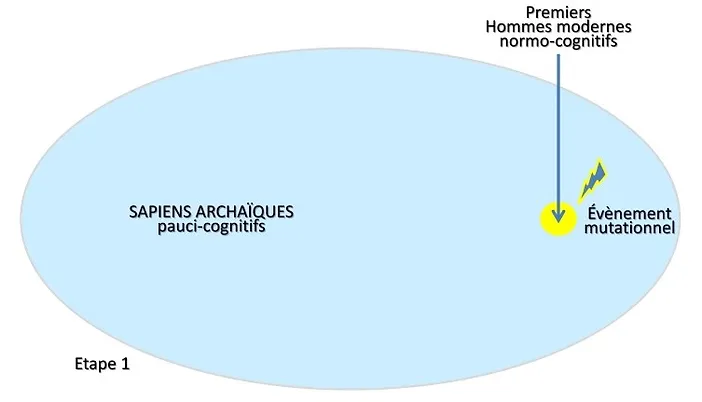
Étape 1
L’évènement qui redoubla notre qualificatif de ‘’sapiens’’ fut ‘’simplement’’ une mutation, modeste sur le plan génétique mais considérable sur le plan fonctionnel en ceci que cette mutation modifia profondément les capacités cognitives des êtres chez qui elle était survenue. Certains chercheurs pensent qu’il pourrait s’agir d’une mutation de FOXP2, un gène qui intervient dans le langage. Mais sans chercher à l’identifier plus avant, nous l’appellerons simplement mutation ‘’normo-cognitive’’ parce qu’elle conféra à ces individus des capacités cognitives que nous considérons aujourd’hui comme ‘’normales’’ chez les adultes modernes de notre espèce. Concrètement, la mutation améliora très significativement les facultés de décryptage du Monde chez ses bénéficiaires, en leur donnant notamment accès au maniement des abstractions ; ce qui leur permit d’élaborer un langage doublement articulé, qu’ils purent faire reposer sur des liens arbitraires établis entre des signifiants et des signifiés (Saussure). Aucun des autres Humains contemporains – Sapiens archaïques Rhodesiensis, Sapiens archaïques Néandertaloïdes, Heidelbergensis / Dénisoviens, Naledi d’Afrique du Sud et Hobbits de Flores – ne possédait cette faculté. Mais avoir des cognitions améliorées ne suffisait pas pour faire des Sapiens sapiens une espèce différente de celle des autres Humains. Ils étaient juste des Sapiens plus doués que les autres, parce que la Nature avait par hasard entrouvert la porte de la prison cognitive où avaient vécu leurs ancêtres et depuis le fond de laquelle ceux-ci ne percevaient qu’une partie seulement de ce qui nous est désormais accessible ; les tous premiers Hommes modernes étaient simplement des Sapiens ‘’améliorés’’ qui venaient d’acquérir des outils cognitifs suffisamment performants pour leur permettre, enfin, d’innover et, enfin, de créer des ‘’cultures’’ authentiques ; mais qui avaient encore tout à inventer sur la base de leur vieille technologie levalloisienne qui était la véritable marque de fabrique de tout le groupe Sapiens depuis des centaines de milliers d’années ! Pourtant, même avant d’avoir eu le temps de construire un Monde de nouvelles technologies et de nouvelles communications, l’intelligence aiguisée de ce nouveau groupe humain lui donnait déjà un avantage direct et immédiat sur tous ses contemporains. Alors, favorisée par ce blanc-seing de la Nature, la communauté moderne commença à se répandre autour d’elle, dans cette Afrique de l’Est dont elle était originaire.
Evidemment, les premiers voisins qu’ils rencontrèrent furent leurs proches cousins Sapiens archaïques africains que nous avons collectivement regroupé sous la dénomination pratique d’Homo sapiens rhodesiensis ‘’récents’’, en refusant le foisonnement des autres dénominations pseudo-spécifiques. Comme leurs cousins modernes qui venaient de s’extraire de leurs rangs, ces Rhodesiensis ‘’récents’’ maniaient une industrie levalloisienne basique, qui constituait la forme ancienne et encore indifférenciée du Paléolithique moyen africain, appelé Âge Moyen de la Pierre sur ce continent (Middle Stone Age, MSA). Cette industrie était technologiquement très voisine de celle des Néandertaloïdes moustériens d’Eurasie, issus comme eux d’Homo sapiens rhodesiensis ‘’anciens’’, mais issus d’un groupe de ceux-ci qui avait autrefois quitté l’Afrique ‘’pour’’ partir à la conquête du continent septentrional. Faute de mieux, on qualifiera de MSA-Ancien, ces industries levalloisiennes indifférenciées que nous attribuons à Rhodesiensis.
En Afrique, une première évolution du Levalloisien indifférenciée / MSA-Ancien réalisa le MSA-Sangoen. Quoique cela reste à prouver, il est possible que cette industrie ait été celle des premiers Humains modernes ? Elle restait cependant extrêmement voisine du Moustérien d’Eurasie, en dépit de quelques rares mais authentiques éclats laminaires parmi son éventail d’outils ; ce qui nous autorise à identifier le Sangoen comme un ‘’mode 3-(4)’’ sur les cartes. En l’absence d’autres marqueurs ‘’modernes’’ – comme des outils en os et des témoignages ‘’artistiques’’ (ocres, parures) – le Sangoen émergeant apparait cependant encore globalement peu distinct du Levallois indifférencie / MSA-Ancien, ce qui ne permet pas de définir consensuellement l’époque de son origine.
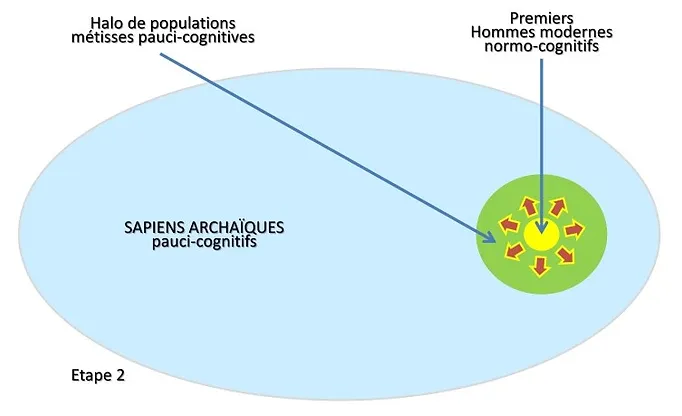
Étape 2
S’il ne s’agit pas seulement d’une lacune de nos observations, la pauvreté des marqueurs ‘’modernes’’ dans le Sangoen émergeant pourrait signifier que – malgré des cognitions modernes – il fallut du temps pour innover à partir de la base ancestrale ? Mais – en avance sur le raisonnement qui va bientôt être tenu au sujet de l’Eurasie – on peut aussi se demander quelles furent les conséquences cognitives du métissage des premiers Hommes modernes ‘’normo-cognitifs’’ avec leurs cousins Rhodesiensis qui étaient demeurés ‘’pauci-cognitifs’’ ? Selon les calculs grossiers auxquels nous nous sommes livrés plus haut, les personnes nées de ces relations pourrait avoir eu un âge mental moyen de 11 ans qui les auraient fait repasser ‘’en moyenne’’ juste au-dessous du ‘’seuil de la pensée abstraite’’. Dans ce cas, il se pourrait qu’il ait fallu ‘’un certain temps’’ pour que la pression de sélection élimine les gènes ‘’pauci-cognitifs’’ au sein des tribus métissées ; et donc un ‘’certain temps’’ pour que, dans ces tribus, les facultés modernes ré-émergent de nouveau au-dessus du ‘’seuil de la pensée abstraite’’.
En décrivant la première extension du groupe originel chez qui était apparue la mutation ‘’normo-cognitive’’, on devine la façon dont l’Humanité moderne colonisa le Monde entier de proche en proche. On peut se représenter les choses de la manière suivante : forts de leurs capacités psychiques nouvelles, et bien qu’encore ignorants de toutes les potentialités technologiques qu’elles recelaient, les premiers Humains modernes ‘’normo-cognitifs’’ de la première tribu moderne s’étendirent concentriquement dans toutes les directions, et se mêlèrent avec les Humains archaïques des tribus alentours ; et cela d’autant plus facilement que ces derniers n’étaient (presque) en rien différents d’eux. Il en résulta nécessairement une première pause de l’expansion moderne, car les enfants ‘’métis’’ virent régresser leur accès à la pensée abstraite et donc perdirent tout avantage guerrier sur leurs voisins ‘’pauci-cognitifs’’ de ‘’pur-sang’’. Mais en promouvant inlassablement ce qui est le plus efficace, la pression de sélection se mit à favoriser les gènes ‘’normo-cognitifs’’ qui s’étaient éparpillés au sein de ces tribus mixtes, parce que les individus qui les possédaient tiraient mieux que les autres leur épingle du jeu dans la dynamique sociale interne à leur groupe ; ce dont il résulta qu’au bout de quelques générations ces tribus mixtes furent de nouveau homogènement composées d’individus redevenus capables d’une pensée abstraite ; et donc d’individus qu’il nous faut appeler des ‘’Hommes modernes’’ au sens cognitif du terme. Peu importe pour cela si ces individus n’étaient plus tout à fait de ‘’pur-sang’’ du point de vue de la tribu originelle où était apparue la mutation ‘’normo-cognitive’’. Un homme moderne, c’est un homme qui possède une pensée ‘’normo-cognitive’’, quelle que soit sa généalogie complète. Bien sûr, ces Hommes redevenus modernes disposèrent à nouveau d’un atout cognitif qui les favorisa dans les conflits territoriaux qui ne manquèrent pas de surgir avec leurs voisins demeurés archaïques.
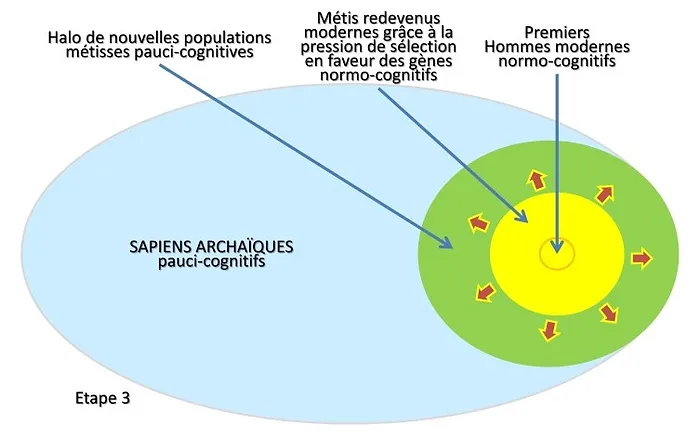
Étape 3
Alors, à partir de ce périmètre de tribus modernes qui venait de s’élargir, le processus d’expansion recommença et le territoire des tribus archaïques voisines fut à son tour colonisé. Par conséquent, les nouveaux métissages qui résultèrent de cette seconde phase d’expansion firent, comme les premiers, repasser les nouveaux métis au-dessous du ‘’seuil de pensée abstraite’’ ; et la pression de sélection recommença une nouvelle fois son œuvre pour favoriser une nouvelle fois la descendance des individus qui étaient les plus compétents parmi ces nouveaux métis. Alors, le mécanisme concentra de nouveau les individus ‘’normo-cognitifs’’ qui retrouvèrent un avantage pour s’étendre encore plus loin.
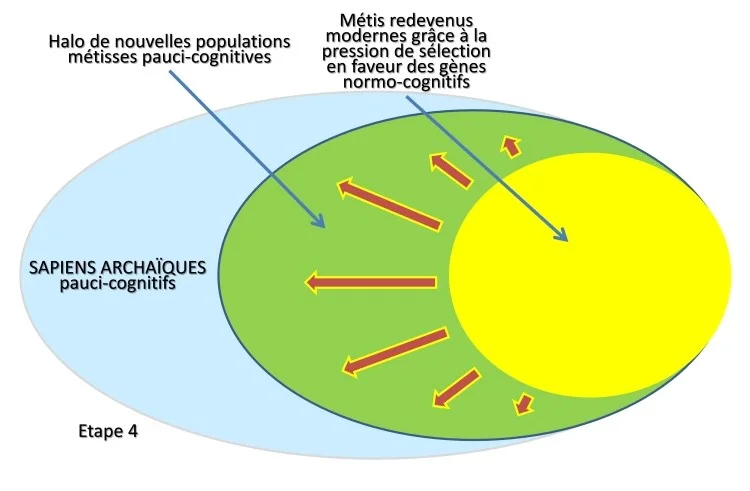
Étape 4
Ainsi, l’expansion moderne se fit elle au rythme des pétarades d’un moteur à deux temps : expansion ‘’normo-cognitive’’ à pause hybridée ‘’pauci-cognitive’’ à nouvelle expansion ‘’normo-cognitive’’ à nouvelle pause hybridée ‘’pauci-cognitive’’ à etc.
Avançant de cette manière, les Hommes modernes progressèrent à la manière d’un feu de prairie qui grignotait concentriquement la plaine mais qui laissait repousser derrière lui une herbe nouvelle, il fallut près de 300.000 ans pour que le Monde entier soit recouvert par ce verdoyant regain !
Il n’y a pas lieu de penser que ce phénomène combinant une mutation génétique pro-cognitive (i.e. donnant un avantage) et des métissages fut unique dans l’histoire. On peut même le transposer en bloc dans le passé du passé que nous étudions, notamment lors du processus de remplacement des Heidelbergensis acheuléens par les Sapiens archaïques levalloisiens (Rhodesiensis demeurés en Afrique et Néandertaloïdes migrés en Eurasie) et, plus anciennement encore, lors du processus de remplacement des Erectus / Antecessors oldowayens par les Heidelbergensis acheuléens, africains et Eurasiens [cf. atlas n°2].
Sur le plan génétique, il est possible que les premiers Humains modernes aient exprimé l’haplogroupe ADN-Y A00 ; parce qu’il est le plus ancien que nous connaissons et parce que son origine pourrait bien dater du MIS 8.
La conquête moderne de l’Afrique [cf. atlas n°2]
Au MIS 7 (v. 240.000 à 190.000 AEC), lorsque les conditions climatiques redevinrent favorables, les Humains modernes accélérèrent leur colonisation de l’Afrique, dans un contexte que facilitait la défragmentation interglaciaire des biotopes favorables à notre espèce. C’est peut-être dès cette époque que des groupes *Sangoens – possiblement porteurs de l’haplogroupe A00 – remplacèrent les derniers Rhodesiensis d’Afrique du Sud et mirent fin au Fauresmithien qui était la forme locale de leur industrie de type MSA-Ancien ; peut-être, aussi, ces premiers Hommes modernes d’Afrique du Sud furent-ils à l’origine de la disparition des très primitifs Homo naledi, ultimes vestiges du stade Habilis [cf. atlas n°2] ? L’industrie Sangoenne pleinement constituée est une industrie déroutante : dans la mesure où elle repose sur une base levalloisienne massive, on la classe généralement dans le MSA et donc dans le Paléolithique moyen africain ; mais chacun s’accorde à reconnaître qu’elle commence aussi à contenir quelques-uns des marqueurs typiquement modernes que nous avons cité plus haut : notamment des éclats lithiques allongés (lames) et des pigments intentionnellement recueillis (‘’art’’). Au cours du MIS 7, v. 200.000 AEC, il se pourrait que des groupes *Sangoens se soient avancés dans la vallée du Nil et aient débouché au Levant où apparut alors l’Hummalien, une industrie laminaire qu’on peine à expliquer en un tel lieu si l’on refuse d’invoquer un mouvement migratoire africain. Cet Hummalien proche-oriental du MIS 7 est étonnant : succédant au Moustérien local du MIS 8, il sera de nouveau remplacé par du Moustérien au MIS 6 ! Prise en sandwich entre deux industries ‘’anciennes’’ d’époque glaciaire, cette industrie ‘’moderne’’ d’époque interglaciaire semble s’être donc évaporée à la fin du MIS 7 … En suivant l’hypothèse cognitive et génétique qui structure ces pages, ces données archéologiques en forme de yo-yo pourraient s’expliquer par la succession d’évènements suivante : 1) arrivée d’une population africaine moderne au début du MIS 7 dans un Proche-Orient faiblement peuplé par des indigènes Néandertaliens (i.e. faible métissage et faible retentissement sur les capacités des Hummaliens du MIS 7, rapidement redevenus ‘’normo-cognitifs’’ sous l’effet de la pression de sélection) ; 2) développement local de la population hummalienne moderne au cours du MIS 7 ; 3) arrivé en nombre significatif de ‘’réfugiés climatiques’’ Néandertaliens moustériens au début du MIS 6 , conduisant à un métissage localement significatif ; avec pour conséquence un retour de toute la population proche-orientale au-dessous du ‘’seuil de la pensée abstraite’’ et donc un retour au Moustérien [cf. atlas n°2].
Loin au Sud, en Afrique de l’Est de ce même MIS 7, le groupe central des Humains modernes – désormais pleinement modernes en raison de la disparition de la quasi-totalité des variants ‘’pauci-cognitifs’’ à proximité du lieu géographique de la mutation ‘’normo-cognitive’’ – commença à augmenter la proportion des marqueurs technologiques modernes. Dans la logique d’une évolution technologique africaine graduelle, le MSA Sangoen d’Afrique de l’Est évolua alors en ce que l’on pourrait appeler un MSA *Sangoen-Lupembien si la précision de nos données permettait de définir une telle strate au sein d’un processus continu. C’est probablement dans cette région et à cette époque, v. 200.000 AEC, que les haplogroupes ADN-Y A0 et A1 émergèrent à partir de variants locaux de l’haplogroupe A00 ?
Au MIS 6 (v. 190.000 à 132.000 AEC), les Humains modernes finirent de coloniser toute l’Afrique sub-saharienne. Toutefois, plus longtemps qu’ailleurs, l’Afrique de l’Ouest pourrait avoir conservé des industries archaïques qui étaient non seulement dépourvues de marqueurs modernes qui mais qui contenaient même encore des éléments de type acheuléen. En effet, bien que la faiblesse de la documentation archéologique ne permette aucune certitude en Afrique de l’Ouest, le Sangoen de cette région pourrait avoir gardé une composante acheuléenne tardive jusqu’au MIS 5e inclus, en survivance d’une époque qui était révolue partout ailleurs sur le continent africain. Ce constat conduit à penser, qu’au MIS 6, les Hommes archaïques d’Afrique de l’Ouest étaient peut-être plus archaïques que ne l’avaient été ceux de l’Est et du Sud ? Et que leur peuple (qui n’a pas laissé de vestiges osseux) aurait pu résulter d’un métissage ancien entre des Heidelbergensis acheuléens (i.e. de ‘’mode 2’’) et des Rhodesiensis levalloisiens (i.e. de ‘’mode 3’’) ? Hybrides dont l’âge mental moyen aurait alors été de 8 + 10 / 2 = 9 ans, si l’on veut bien suivre notre méthode simpliste de calcul des compétences cognitives. Au MIS 6, l’arrivée des Hommes modernes sur ce substrat ‘’*Acheuléo-Levalloisien’’, fut à l’origine d’une industrie lithique difficile à classer, que les chercheurs peinent à rattacher pleinement au Sangoen. Le terme anachronique de *MSA-Acheuléo-Sangoen pourrait être avancé en raison de son caractère purement descriptif. En Afrique de l’Ouest, l’existence d’industries mixtes pourrait donc témoigner de métissages qui seraient localement survenus plus tardivement qu’à l’Est, et qui seraient survenus entre des Hommes modernes – peut-être arrivés v. 160.000 AEC (i.e. au décours du stade glaciaire de Drenthe ?) – et des Hommes archaïques un peu plus archaïques que ceux du reste de l’Afrique (9 ans d’âge mental en Afrique de l’Ouest de l’époque vs 10 ans pour les Rhodesiensis ‘’classiques’’). Quoi qu’il en soit de ces spéculations, c’est au MIS 6 que nous ferons disparaître les derniers Hommes archaïques d’Afrique, atteints par l’expansion des Hommes modernes auxquels ils léguèrent pendant quelques temps leurs cognitions anciennes : le temps que la pression de sélection ait réduit la proportion de variants génétiques ‘’pauci-cognitifs’’ chez les descendants métis. Vers 140.000 AEC (i.e. pendant la phase Tardiglaciaire du MIS 6, postérieure au stade glaciaire de Warthe), ces tous premiers Hommes modernes A00 d’Afrique de l’Ouest pourraient avoir été rejoints par d’autres groupes modernes originaires de l’Est, et qui étaient peut-être porteurs à la fois de l’haplogroupe A0 et de cette industrie de transition entre le Sangoen et le Lumpembien que nous avons nommée *MSA Sangoen-Lupembien.
Parallèlement à ce qui se passait en Afrique de l’Ouest, un MSA-Lupembien pleinement constitué se développa au MIS 6 en Afrique de l’Est, peut-être chez des populations porteuses de l’haplogroupe A1 qui se diversifia alors en une cascade de dérivés : d’abord A1a et A1b (v. 170.000 AEC, au cours du premier maximum glaciaire de Drenthe ?) ; puis A1b1 et A1b2 (v. 150.000 AEC, au cours du second maximum glaciaire de Warthe ?). Bien que toujours classé dans le MSA, le Lupembien était déjà une industrie moderne qui contenait déjà plusieurs marqueurs qui seront – beaucoup plus tard – considérés comme caractéristiques du Paléolithique supérieur d’Eurasie. Cette modernité avancée était peut-être rendue possible parce que l’essentiel des variants génétiques ‘’pauci-cognitifs’’ avaient déjà été éliminé chez ces descendants des tous premiers Hommes modernes qui s’étaient autrefois mêlés avec leurs proches cousins archaïques ? Le Lupembien pourrait être considéré comme la première véritable culture des Humains modernes, au sens d’une véritable capacité d’innovation. Son kit industriel comprenait des pointes lancéolées finement travaillées qui étaient probablement les extrémités d’outils emmanchés ; s’agissait-il de lances ? Ou bien d’épieux toujours utilisées d’estoc ? Quoi qu’il en soit, les outils emmanchés étaient abondants. On peut même dire, qu’au contraire du Sangoen, le Lupembien reflète la première fabrication massive d’outils composites utilisés pour la chasse, pour la pêche et pour la cueillette. Au total, le Lupembien était clairement une culture moderne qui serait attribuée sans difficulté au ‘’mode 4’’ si elle n’était pas aussi ancienne et si elle était située en Eurasie ! Sur nos cartes, nous l’identifions comme un ‘’mode (3)-4’’ (i.e. prédominance des outils modernes sur les outils levalloisiens), tandis que le Sangoen, moins évolué, réalisait un ‘’mode 3-(4)’’ (i.e. prédominance des outils levalloisiens sur les outils modernes).
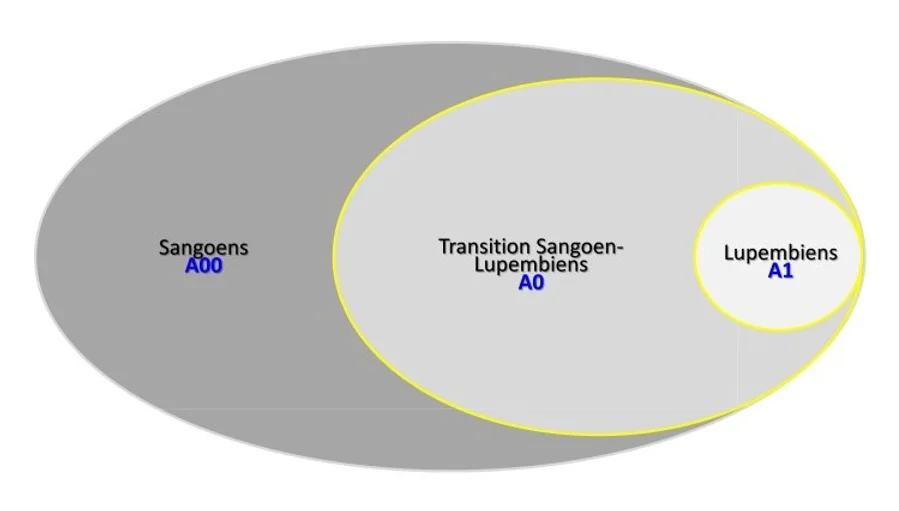
Pour résumer, la reconstitution que nous faisons du paysage ethnoculturel du MIS 6 africain est conforme au modèle du feu de prairie que nous avons avancé plus haut. Mais il serait également possible de se la représenter sous la forme d’une cible munie d’anneaux concentriques, si la mutation ‘’normo-cognitive’’ était apparue en plein centre du continent plutôt que sur l’un de ses bords. Vers 140.000 AEC, au cours de la phase Tardiglaciaire du MIS 6, l’Afrique de l’Est (située en plein cœur de notre cible décentrée), était le siège d’une culture MSA ‘’moderne’’ appelée Lupembien, portée par des tribus d’Homo sapiens sapiens entièrement redevenues modernes, qui véhiculaient l’haplogroupe A1 et ses variants. En première périphérie de ce cœur, une culture de transition *Sangoen-Lupembienne était peut-être portée par des populations A0 ? Enfin, en seconde périphérie, les tribus d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Sud, potentiellement d’haplogroupe A00, exprimaient la culture Sangoenne, dont la plus grande vétusté était peut-être la conséquence d’hybridations localement plus tardives (parce que géographiquement plus lointaines) avec des Hommes archaïques qui étaient par ailleurs plus éloignés génétiquement de la souche initiale des Hommes modernes ?
Au bel interglaciaire Eémien (MIS 5e) – par lequel se termine l’atlas n°2 –, les cultures MSA ‘’modernes’’ à pointes lancéolées s’étaient déjà différenciées en plusieurs traditions locales, c’est-à-dire en faciès culturels innovants et donc déjà quelque peu divergents ; phénomène culturel de la divergence qu’autorisaient désormais les cognitions modernes.
- En Afrique du Sud, le Lupembien (haplogroupe A1a ?) avait peut-être remplacé v. 120.000 AEC un faciès intermédiaire *Sangoen-Lupembien (haplogroupe A0 ?), qui avait lui-même remplacé v. 130.000 AEC le vieux Sangoen (haplogroupe A00 ?). Dans ce Finis Terrae, les tribus porteuses de ces divers haplogroupes s’empilaient certainement ?
- En Afrique de l’Ouest – l’un des autres Finis terrae du Monde – les haplogroupes commençaient déjà à s’empiler, ainsi que nous autorise à l’inférer la survivance – à des taux bas – des haplogroupes A00, A0 et A1a dans l’Afrique de l’Ouest actuelle. Des éléments archaïques Sangoens persistaient dans la culture matérielle locale, peut-être parce que la pression de sélection n’avait pas fini d’éliminer les variants génétiques ‘’pauci-cognitifs’’ hérités des anciens peuples.
- Au travers du Sahara vert, le Lupembien atteignit le Maghreb v. 130.000 AEC (haplogroupe A1a ?). Plus tard, peut-être à partir des oasis du désert occidental égyptien, d’autres groupes modernes atteignirent à leur tour le Maghreb v. 120.000 AEC (haplogroupe A1b1a ?), où ils constituèrent une population *Paléo-Atérienne dont les marqueurs technologiques n’étaient pas sans rapport avec le Complexe Nubien d’Afrique de l’Est. D’autres groupes s’étendirent peut-être dans la vallée du Nil puis, de là, en Lybie et au Levant qui sont les débouchés naturel de l’Egypte (haplogroupe A1a ?). Ce mouvement postulé pourrait être celui des ancêtres du peuple Humain moderne levantin qui a été improprement appelé **Proto-Cro-Magnons (site de Skhul). Dans ce cas, il s’agirait du 4ème ‘’Out of Africa’’ depuis les débuts de l’humanité : le tout premier des hommes modernes ! Si cette reconstitution historique est exacte, on devrait donc s’attendre à trouver un *Lupembien levantin au MIS 5e ! Pourtant, les premiers vestiges connus des Hommes modernes du Levant seront associés à une industrie lithique moustérienne ! A ce propos, il faut cependant faire remarquer que ce Moustérien des Hommes modernes de la région seulement attesté 20.000 ans après la date du mouvement supposé des hypothétiques *Lupembiens levantins. Alors, il faut peut-être se demander quel fut l’impact cognitif de l’hybridation entre des migrants africains ‘’normo-cognitifs’’ Lupembiens et les Néandertaloïdes ‘’pauci-cognitifs’’ moustériens qui avaient repeuplé le Levant au cours du MIS 6 ? Selon notre hypothèse, les capacités modernes pourraient s’être temporairement effacées pour laisser ressurgir le Moustérien originel des Sapiens archaïques ; en tout cas, c’est bien ce qui est observé.
Enfin, au MIS 5e, les Sapiens sapiens d’Afrique de l’Est développèrent le stade ancien du Complexe Nubien, peut-être porté principalement par des tribus A1b ? Une fraction de ces Hommes modernes A1b d’Afrique de l’Est passa-elle en Arabie dès cette époque ? C’est peu probable ! En effet, si des embarcations permettaient depuis longtemps déjà de traverser des bras d’eau très étroits, il devait être inconcevable de se lancer sur l’eau sans apercevoir une autre rive. Il est donc préférable de reporter au MIS 5d ce grand ‘’Out Africa through Arabia’’ [cf. carte A].
Les Hommes modernes du MIS 5d
L’expansion des Hommes modernes hors d’Afrique constitue la matière principale de l’atlas n°3. On ne la détaillera donc pas dans l’introduction. C’est du MIS 5d que nous datons le grand ‘’OUT Africa THROUGH Arabia’’ des Hommes modernes [cf. carte A]. Evènement limité dans le temps, dont il est assuré qu’il ne fut ensuite jamais répliqué de manière significative, comme nous l’enseigne la phylogénie des haplogroupes ADN-Y et ADN-mt. Cette migration fondatrice des Humains eurasiens fut probablement accomplie v. 115.000 AEC par des groupes pionniers A1b1b-M13, suivis v. 108.000 AEC par des groupes A1b2 = BT. A cette époque, toute l’Afrique était encore exclusivement peuplée par des individus porteurs des variants déjà bien diversifiés de l’haplogroupe A. On peine cependant à apprécier dans toute son ampleur cette diversité africaine de l’haplogroupe A au MIS 5e, parce cet haplogroupe n’a pas cessé d’être marginalisé par la suite, c’est-à-dire repoussé par des haplogroupes plus récents issus du variant A1b2 = BT qui est aujourd’hui porté par la quasi-totalité de l’Humanité. L’haplogroupe A (non-BT) demeure toutefois présent en Afrique de l’Est et en Afrique du Sud, ainsi que dans quelques poches d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord où ses quelques porteurs sont les ultimes témoins de son ancienne hégémonie. Aujourd’hui, c’est chez les Khoisan d’Afrique du Sud et de Namibie que l’haplogroupe A est le mieux représenté. Il faut également remarquer que c’est chez ce peuple que se concentre l’essentiel de la variation génétique de l’espèce humaine (ADN nucléaire) ; observation qui signifie concrètement qu’il y a moins de différence génétique (nucléaire) entre des Chinois de souche et des Bretons de souche séparés par près de 10.000 km, qu’entre deux individus appartenant à des tribus Khoisans pouvant n’être séparées que par moins de 100 km !
Les Hommes archaïques du MIS 5d
Plusieurs variantes d’Hommes archaïques – Sapiens pour certaines et Non-Sapiens pour d’autres – peuplaient l’Eurasie éémienne (MIS 5e) et post-éémienne (MIS 5d). Maintenant que nous sommes arrivés au seuil de la conquête du grand continent septentrional par les Hommes modernes, il nous faut mieux décrire ces peuplades indigènes que nous avons déjà plusieurs fois rencontrées dans cette introduction ; et cela en particulier lorsque nous nous sommes interrogés sur leurs compétences cognitives dans le reflet de leurs industries lithiques.
– Nous appellerons collectivement *Néandertaloïdes (Homo sapiens neanderthalensis) la majorité des Sapiens archaïques d’Eurasie. Leur industrie levalloisienne – connue sous le nom de Moustérien – était technologiquement proche du MSA-Ancien africain dont elle constituait une expansion septentrionale [cf. atlas n°2]. Au rythme des contractions glaciaires et des expansions interglaciaires des peuplements humains, les Néandertaloïdes d’Eurasie étaient parvenus à se répandre sur une aire géographique considérable dont l’extension culmina probablement à l’Eémien, parce que le climat chaud de cette époque leur offrait la possibilité d’avancer très loin vers le Nord, y compris en l’absence de technologie sophistiquée. Présents en Eurasie depuis plus de 200.000 ans et formant des petites communautés géographiquement très éloignées les unes des autres, il est hautement probable que ces Néandertaloïdes avaient eu le temps de développer des traits géo-raciaux très contrastées. Ainsi, déjà soumis aux mêmes contraintes biologiques environnementales qui continueront ensuite de s’exercer sur les Hommes modernes, leurs groupes septentrionaux étaient probablement leucodermes (pour faciliter la synthèse de la vitamine D), tandis que leurs groupes méridionaux étaient vraisemblablement mélanodermes comme l’avaient été avant eux leurs ancêtres africains (pour se protéger des excès d’ensoleillement). Outre ces caractères pigmentaires, d’autres particularités anthropométriques et génétiques accusées avaient nécessairement résulté de l’éloignement et de la fragmentation des groupes (dérive génétique). Une meilleure connaissance de ces races anciennes – qui eurent beaucoup de temps devant elles pour pouvoir acquérir des caractères marqués – permettrait de décrire la diversité du ‘’peuple Levallois’’ ! Mais, malheureusement, nous ne le pouvons pas faute de vestiges osseux en nombre suffisant. Cependant, malgré cette carence documentaire, nous pouvons quand même tenter de circonscrire les géo-races du grand peuple Néandertaloïde. Ainsi, les habitants éémiens d’Europe, du Proche- et du Moyen-Orient, d’Asie Centrale et de Sibérie Occidentale pourraient tous être appelés Néandertaliens sans trop de difficultés, même si les Néandertaliens les plus strictement définis et les mieux connus étaient ceux d’Europe. En Asie orientale et méridionale, il existait d’autres groupes plus ‘’exotiques’’ et certainement très différents les uns des autres, qui peuplaient la Mongolie, la Sibérie Orientale, et les Indes ; tout cela à condition que l’on accepte de considérer les outils Moustériens retrouvés dans toutes ces régions, comme les marqueurs ethnologiques qui sont à la fois nécessaires et suffisants lorsqu’on cherche à définir une présence Néandertaloïde [cf. atlas n°2 à ce sujet]. Plus loin encore, en Chine du Nord, l’industrie de cette époque était également rattachable au ‘’mode 3’’ mais sans pouvoir vraiment être qualifiée de levalloisienne, en dépit d’interrogations émises à propos de quelques rares outils retrouvés sur quelques rares sites ; dans la logique de notre raisonnement, cette ‘’hésitation technologique’’ chinoise pourrait facilement s’expliquer par l’hybridation de Néandertaloïdes véritablement levalloisiens, arrivés depuis la Mongolie au MIS 5e (au plus tard), avec des êtres plus archaïques qu’eux qui peuplaient l’Extrême-Orient avant leur arrivée ?
– En effet, l’Eurasie orientale des MIS 5e et MIS 5d abritait toujours des Hommes archaïques Non-Sapiens qui étaient issus de migrants africains plus anciens que les Néandertaloïdes. Les généticiens leur ont donné le nom de Dénisoviens. Qui étaient-ils ? Les gènes qu’ils ont légués aux Humains modernes asiatiques dessinent inparfaitement la surface du territoire qu’ils occupaient au moment de leur ultime rencontre : Nord-Est asiatique, piedmonts Sud, Est et Nord du massif Tibétain, et surtout Sud-Est asiatique, y compris le Sunda. Pour tenter de rattacher l’abstraction désincarnée des Dénisoviens à un peuple fait de chair et surtout d’os, nous avons proposé de les assimiler aux Homo heidelbergensis d’Extrême-Orient [cf. atlas n°2]. Venus d’Afrique, les ancêtres majoritaires de ces Heidelbergensis orientaux s’étaient installés en Eurasie à l’Eburonien, v. 1.500.000 AEC [cf. atlas n°2, carte I] ; puis, depuis l’Asie Centrale, c’est au cours du chaud MIS 11 (entre v. 420.000 et 370.000 AEC) qu’ils s’étaient aventurés en Extrême-Orient qui était alors peuplé d’Erectus récents avec lesquels ils avaient peut-être échangé des gènes au point de les absorber ? [cf. atlas n°2, cartes T & U]. Cette hypothèse – localisée dans un Finis Terrae où venaient s’empiler les peuples – pourrait expliquer que nous ne trouvons pas de vestiges véritablement acheuléens / ‘’mode 2’’ en Chine et dans le Sud-Est asiatique, en dépit de quelques pièces sujettes à interrogations (cf. atlas n°2). Beaucoup plus tard, à l’Eémien, la poussée orientale du ‘’peuple levallois’’ Néandertaloïde conduisit probablement les indigènes Dénisoviens de ‘’mode 1-2’’ à échanger des gènes avec leurs envahisseurs de ‘’mode 3’’ ? Ce qui sera à l’origine des industries extrême-orientales que nous trouvons difficiles à classer ; parce qu’elles sont hybrides.
A propos des Dénisoviens, il faut encore souligner l’étrangeté suivante : l’holotype archéogénétique Dénisovien provient de l’Altaï, en Mongolie, tandis que les Humains actuels exprimant le taux le plus important de gènes Dénisoviens vivent à 7000 km de ces montagnes, en pleine Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce gap géographique inspire l’hypothèse suivante : avant l’Eémien (MIS 5e), toute l’Asie orientale pourrait avoir été le domaine de peuplades Heidelbergensis qui s’étaient autrefois métissées avec les Erectus qui les avaient précédés, mais selon un gradient de métissage décroissant du Nord vers le Sud. Schématiquement, ces populations Dénisoviennes réalisaient ainsi plusieurs sous-groupes : 1) un sous-groupe ‘’Dénisovien septentrional’’ en Sibérie Orientale et en Mongolie (population peu dense en raison de conditions de vie rudes, et très peu métissé avec les Erectus) ; 2) un sous-groupe ‘’Dénisovien central’’ en Chine (population assez dense en raison d’une vie moins rude, et moyennement métissé avec les Erectus) ; 3) et enfin un sous-groupe ‘’Dénisovien méridional’’ en Asie Du Sud-Est et dans les îles du Sunda éémien (population très dense parce que les régions tropicales étaient bien adaptées aux Humains anciens, et très métissé avec les Erectus du fait d’un empilement ethnologique dans un Finis Terrae). C’est le groupe des ‘’Dénisoviens septentrionaux’’ qui fut impacté le premier par l’arrivée de Néandertaloïdes au MIS 5e. Ceux-ci prédominèrent rapidement en Sibérie Orientale et en Mongolie, ainsi que l’atteste un Moustérien (Levalloisien) bien constitué dans ces deux régions ; toutefois, des populations Dénisoviennes survécurent encore longtemps dans le refuge des montagnes de l’Altaï, et c’est là que l’holotype du groupe sera bien plus tard découvert. Les ‘’Dénisoviens centraux’’ de Chine furent eux aussi colonisés par des groupes Néandertaloïdes ; mais les hybridations successives parvinrent à affaiblir la technologie moustérienne des nouveaux-venus, avec pour conséquence l’émergence de ces industries hybrides que nous avons décrites plus haut et qui nous apparaissent comme difficilement classables parce qu’elles oscillent entre les ‘’modes 1, 2 et 3’’. Enfin, peut-être parce qu’il avait développé une adaptation forestière, mais plus certainement parce qu’il était le plus lointain et le plus dense, le sous-groupe des ‘’Dénisoviens méridionaux’’ du Sud-Est asiatique ne fut pas significativement atteint par les envahisseurs Néandertaloïdes et préserva sa vieille industrie lithique directement héritée du Paléolithique inférieur. Ainsi, lorsque les premiers Hommes modernes qui emprunteront la ‘’voie du Nord’’ et la ‘’voie du Sud’’ rencontreront bientôt ces trois sous-groupes de Dénisoviens, les conséquences anthropologiques et cognitives de ces rencontres seront bien différentes d’une région à l’autre parce que les substrats indigènes étaient bien différents ! En particulier, le métissage avec les Hommes très archaïques d’Asie du Sud-Est fera tomber les Hommes modernes de la région dans une sorte de ‘’puits cognitif’’ dont ils mettront très longtemps à sortir [cf. plus loin & carte Q].
– Pour terminer ce tour d’horizon des races anciennes, il reste à dire que les derniers Homo erectus soloensis avaient déjà disparu lors de l’Eémien, remplacé par ces ‘’Dénisoviens / Heidelbergensis méridionaux’’ dont nous venons de parler et dont nous venons de dire qu’ils s’étaient probablement métissés avec eux129 ? Mais de l’autre côté de la ligne Wallace, seuls véritables insulaires du Monde, les Homo erectus floresiensis de l’île de Flores constituaient encore le dernier vestige nanifié de la toute première conquête de l’Eurasie par les Humains Erectus [cf. atlas n°2].
Les rencontres en Eurasie et leurs conséquences
Si l’atlas n°3 déroule l’histoire de la colonisation du Monde par l’Homme moderne, il décrit aussi de facto l’histoire du recul et de la disparition des Hommes archaïques dont nous venons de brosser le portrait ; disparition dont on sait aujourd’hui qu’elle prit pour partie la forme d’une dilution des gènes archaïques dans le pool des gènes modernes. En effet, les Hommes archaïques n’ont pas vraiment disparu ; ils se sont partiellement fondus en nous au long d’un front de rencontre qui recula lentement sans jamais cesser de brasser les gènes jusqu’à la disparition des Hommes archaïques de ‘’pure souche’’, il y a de 30.000 à 20.000 ans seulement selon les régions.
Plus haut, nous avons dit qu’en Afrique, l’évolution techno-culturelle se fit dans la continuité, sur le mode de fondus-enchaînés ! Cela parce que les premiers Humains modernes n’étaient qu’une variante des Rhodesiensis locaux, avec lesquels ils partageaient l’essentiel des gènes et, initialement, une même industrie lithique levalloisienne MSA ; industrie qui – nous l’avons vu – évolua sans apports extérieurs, selon une dynamique de progression purement interne qui fit très rapidement émerger des marqueurs archéologiques caractéristiques du Paléolithique supérieur parmi d’autres marqueurs d’allure plus ancienne.
Ce rappel étant fait, il est maintenant nécessaire de comprendre qu’en Eurasie, l’évolution techno-culturelle fut extrêmement différente : 1) Les premiers Hommes d’Eurasie descendaient d’Africains déjà en possession d’une industrie quasi-paléolithique supérieure ; 2) leur technologie donne l’impression d’avoir régressé rapidement sous la forme d’un classique Moustérien ; 3) ce Moustérien stagna pendant longtemps de part et d’autre du front de rencontre qui séparait des Humanités différentes ; 4) puis, tardivement, des innovations successives semblent avoir pulsé depuis la zone centrale du ‘’hub moyen-oriental’’ et être allées à la rencontre de conservatismes périphériques selon une dynamique qui s’apparenta à une série de chocs coloniaux assénés grâce à un arsenal technologique (i.e. guerrier et autre) plus performant de vague de peuplement en vague de peuplement. Ainsi, tandis qu’en Afrique tout se fit dans la continuité, en Eurasie tout se fit dans la rupture, au gré des progrès technologiques et des oscillations climatiques qui permettaient – ou non – de diffuser ces progrès à longue distance ! Il s’agit d’une différence essentielle dans la progression des technologies sur l’un et l’autre continent.
Les premiers chocs ethniques
L’arrivée des premiers Humains modernes en Arabie méridionale les mit inévitablement en contact avec les Néandertaloïdes locaux ; un peuple que nous cernons très mal mais qui devait néanmoins exister. Dans cette situation, ces deux populations engagèrent inévitablement un conflit colonial pour la possession des territoires et de leurs ressources ; un conflit déséquilibré puisque les cognitions modernes donnaient un avantage aux envahisseurs sur les indigènes plus faciles à berner. Nous avons vu que des enfants métis résultent généralement de ces chocs frontaux entre ethnies rivales, puisque – contrairement à leurs hommes qui finissent en repas – les femmes du groupe vaincu sont généralement épargnées par les hommes vainqueurs. C’est exactement ce qui dût commencer à se produire à l’époque où les premiers Humains modernes commencèrent à se répandre en Arabie puis, à partir de là, dans les régions limitrophe du Golfe Persique qui était alors exondé. Ces questions de métissage reviendront régulièrement dans les commentaires des cartes, jusqu’à la disparition des Hommes archaïques.
Un métissage ‘’à la marge’’ ou massif ?
La recherche de formes intermédiaires – les fameux ‘’chaînons manquants’’ des siècles passés – à longtemps passionné les chercheurs. Au début, les indices ostéologiques intermédiaires – comme ceux des Néandertaliens du Proche-Orient au MIS 4 – avaient tendance à être interprétés comme des témoignages d’une évolution en cours entre deux espèces distinctes, celle des Néandertaliens et la Nôtre. Egalement, des particularités anthropologiques panchroniques – comme les incisives ‘’en pelles’’ des Mongoloïdes contemporains, qui étaient déjà présentes chez les Hommes archaïques extrême-orientaux (sinodontie) – semblaient signifier que l’Homme modernes avait évolué simultanément en plusieurs régions différentes de la Terre, à partir des Hommes archaïques locaux !
Puis, à la fin de la seconde partie du XX° siècle, des anthropologues commencèrent à soupçonner que les Humains archaïques s’étaient peut-être hybridés avec les Hommes modernes ? Ainsi, certains chercheurs osèrent suggérer que l’intrigante présence de traits néandertaliens typiques qu’on mesurait sur des crânes ayant appartenus aux premiers Hommes modernes d’Europe – en particulier des ‘’chignons occipitaux’’ plus ou moins prononcés –, pouvait témoigner de métissages entre les indigènes de l’Europe et desenvahisseurs venus d’ailleurs . Mais la position dominante conduisait toujours la majorité des chercheurs à affirmer que de telles unions étaient impossibles, parce ces Humanités ‘’étaient trop différentes’’ ! Ils se trompaient pourtant ! D’ailleurs, dans le même temps mais dans un tout autre domaine, des archéologues commencèrent aussi à se demander ce que pouvaient signifier les industries lithiques du début du Paléolithique supérieur européen, qui donnaient l’impression d’être issues de ‘’traditions’’ différentes ou d’assumer la ‘’transition’’ entre des industries successives ; certains osant même suggérer – souvent à demi-mots – que ces industries composites s’expliquaient par la survivance de traditions puisant leur origine chez les Néandertaliens. Pourtant ils ne furent pas suivis car, sur ce plan, la position dominante était – et reste encore – de traiter les productions lithiques des Humains anciens comme s’il s’était agi de véritables cultures comparables aux cultures des Humains récents ; et donc d’interpréter les outils d’allure hybrides par des ‘’influences réciproques’’, plutôt qu’en tant que matérialisation de facultés cognitives / génétiques hybridées, ainsi que nous le proposons !
Bien que notre position sur la véritable nature des productions lithiques pré-modernes demeure marginale, il est désormais devenu consensuel que des métissages se sont produits, et cela à plusieurs reprises. Raison essentielle pour laquelle il faut renoncer à décrire les Hommes archaïques comme ayant appartenus à des espèces différentes de la nôtre.
Que disent les travaux (2018) ? Que le génome des Européens et des Asiatiques extrême-orientaux actuels contient environ 2 % d’ADN Néandertalien ; et que le génome des populations extrême-orientales contient en outre des gènes Dénisoviens, quoique ceux-ci n’atteignent une fréquence très élevée que chez les populations de l’ancien Sunda et de Nouvelle-Guinée-Papouasie (jusqu’à environ 6 %). Au total, on peut estimer que c’est en moyenne moins de 1/20ème des gènes des Humains eurasiens actuels qui sont d’origine Néandertalienne et/ou Dénisovienne. Ce taux est cependant beaucoup plus bas chez les Humains africains actuels, parce que la proportion de leurs ancêtres qui ont vécu en Eurasie est beaucoup plus faible, quoique loin d’être nulle en raison d’une série de rétromigrations [cf. carte F].
En Eurasie actuelle, la proportion d’ADN archaïque est basse, et cela pourrait nous amener à conclure que les occasions de métissage entre Hommes modernes et archaïques furent des évènements assez rares. Mais notre regard est peut-être biaisé ? En premier lieu, on peut faire l’hypothèse que cette proportion reflète tout simplement le déséquilibre démographique des Hommes archaïques (peu nombreux parce que leurs cognitions limitées et leur technologie fruste les contraignaient à une vie précaire) et des Hommes modernes (rapidement devenus plus nombreux que leurs compétiteurs, parce qu’ils étaient cognitivement et technologiquement mieux outillés pour détourner à leur profit toutes les ressources d’un territoire) ! Mais cette réponse n’est pas suffisante. En effet, les taux que nous observons aujourd’hui sont bien plus bas que ceux qui existaient peu de temps après la rencontre ! Ce sont les progrès de l’archéogénétique qui ont permis d’observer qu’en Europe, le pourcentage d’ADN Néandertalien était plus élevé qu’aujourd’hui à l’époque de la conquête Aurignacienne, avec une moyenne de 5 % vers 43.000 AEC, mais avec des taux pouvant individuellement atteindre jusqu’à 10 % . Au cours des milliers d’années qui suivirent, ces taux initialement élevés ont régulièrement baissé jusqu’à atteindre les 2% actuels. Pourquoi ?
L’impact cognitif et la régression technologique
La réponse est : Parce que la plupart des variants génétiques Néandertaliens subirent, sur le long terme, une pression de sélection constante qui tendit à les éliminer, ainsi que nous avons déjà commencé à l’expliquer plus haut à propos de la colonisation initiale de l’Afrique par les Hommes modernes. Que pouvaient être ces variants génétiques non favorables et qui furent donc supprimés par la sélection naturelle ? La réponse est limpide : il s’agissait pour l’essentiel des variants génétiques ‘’pauci-cognitifs’’ qui donnaient des cognitions ‘’archaïques’’ aux enfants métis qui avaient eu la malchance de les hériter au lieu de leurs contreparties modernes ! Etant moins compétents que leurs concitoyens pour des aptitudes considérées comme essentielles par les Humains modernes (abstractions, langage doublement articulé), ces enfants avaient un handicap social procréationnel qui était bien plus important que celui de leurs frères et sœurs qui – bien que métis tout comme eux –, avaient eu – eux – la chance d’hériter de cognitions ‘’modernes’’ parce qu’ils avaient reçu les variants génétiques ‘’normo-cognitifs’’. Le handicap social cognitif et procréationnel suffit à expliquer pourquoi une grande partie des gènes archaïques fut éliminée du pool génétique des populations hybrides dont descendent tous les Eurasiens d’aujourd’hui. Cependant, tous les gènes archaïques ne furent pas éliminés. En effet, les descendants des métis ‘’intelligents’’ continuèrent à transmettre des gènes archaïques à leurs enfants, lorsque ces gènes n’avaient pas d’effet délétère. De plus, lorsque certains gènes archaïques conféraient – sans que personne ne s’en doute – un avantage quelconque pour faciliter la vie dans les latitudes élevées de l’Eurasie où pour mieux résister aux agents pathogènes locaux, ces gènes-là se maintenait et diffusaient même rapidement à l’ensemble de la population ; c’est notamment de cette façon que les variants alléliques archaïques responsables d’une pigmentation plus claire se répandirent parmi les populations eurasiennes : parce qu’ils étaient très utiles pour synthétiser la vitamine D dans les régions peu ensoleillées.
Tant qu’il y eut des Hommes archaïques de ‘’pure souche’’ au-delà des collines, à l’arrière un front de rencontre qui reculait de générations en générations, un filet continu de gènes ‘’pauci-cognitifs’’ irrigua le génome des Hommes modernes eurasiens et contrebalança la pression de sélection qui tendait à éliminer ces gènes parce qu’ils altéraient le fonctionnement de l’esprit selon les standards attendus par une communauté moderne. De sorte que les Hommes modernes qui vivaient juste en avant du front n’étaient jamais complètement modernes, et qu’il fallait que le front s’éloigne de quelques centaines de kilomètres pour que, de nombreuses générations plus tard, leurs descendants le redeviennent enfin complètement … sauf ceux d’entre eux qui avaient suivi le recul du front de rencontre. Dans le même temps, ces transfusions génétiques ‘’au goutte à goutte’’ permettaient de concentrer systématiquement tous les variants génétiques indigènes qui étaient avantageux pour mieux vivre dans la région où l’on s’enfonçait. Et c’est ainsi que les Humains modernes d’Europe et d’Asie occidentale purent conserver ou plutôt retrouver la pensée ‘’normo-cognitive’’ de leurs ancêtres africains, tout en adoptant progressivement une peau plus claire et un gros nez !
C’est aussi par ce phénomène qu’il faut peut-être expliquer la ‘’régression’’ technologique que nous sommes forcés de constater chez les premiers Humains modernes d’Eurasie, qui étaient moins avancés sur ce plan que ne l’avaient été leurs ancêtres africains ! En effet, il est aisé de constater un intervalle – très long et très dérangeant pour les chercheurs – entre l’arrivée des premiers Hommes modernes en Eurasie v. 108.000 AEC et la véritable explosion de la civilisation ‘’artistique’’ et technologique du Paléolithique supérieur eurasien qui survint plus de 50.000 ans plus tard ? Et même plus de 90.000 ans plus tard lorsqu’on s’intéresse à cette région particulière d’Asie du Sud-Est où nous avançons que le métissage avec des Hommes ‘’archaïques très archaïques’’ fit tomber les Hommes modernes régionaux dans un ‘’puits cognitif’’ dont ils mirent particulièrement longtemps à sortir ! Fallut-il attendre que suffisamment de gènes archaïques ‘’pauci-cognitifs’’ aient été éliminés du patrimoine génétique des hybrides pour que les Hommes modernes d’Eurasie développent enfin pleinement leur potentiel moderne [cf. carte Q] ? Ce potentiel moderne qui s’était pourtant déjà pleinement exprimé des dizaines de milliers d’années plus tôt en Afrique, parce que les métissages remontaient à une époque très ancienne (i.e. la pression de sélection avait eu beaucoup de temps pour agir) et avaient concerné des Hommes archaïques très peu archaïques (i.e. les gènes archaïques locaux étaient moins archaïques que ceux d’Eurasie). Ce potentiel moderne que les métis eurasien recouvrèrent plus rapidement lorsqu’ils vivaient à distance du front de rencontre, et que le métissage s’était fait avec des Néandertaloïdes plutôt qu’avec des Heidelbergensis !
En attendant une validation ou une infirmation de notre hypothèse, contentons-nous de dire qu’il faut aujourd’hui comprendre la disparition des Hommes archaïques comme un recul et une raréfaction progressive de leur population de pure souche, accompagnés d’une dilution dans les populations modernes ! Ils n’ont pas disparu ! Ils vivent encore en nous. Mais si nous avons su intégrer et même profiter d’une partie de leur legs, il est possible que la vieille pression de sélection contre leurs gènes ‘’pauci-cognitifs’’ n’ait pas totalement fini de s’exercer.
Ce qu’il y a d’ancien dans les races modernes
Après avoir fait le point sur les diverses sortes d’Hommes archaïques qui peuplaient la Terre éémienne, et sur leur legs génétique à l’Humanité moderne, nous allons maintenant nous intéresser à la part déterminante qui fut la leur dans l’émergence des grands groupes ethniques qui se partageaient la planète jusqu’au début du XXI° siècle et que l’on appellerait volontiers ‘’races’’ si l’on pouvait débarrasser ce mot des connotations socio-politiques qui le tabouisent en occident depuis 50 ans. Osons malgré tout utiliser le terme ‘’race’’ sans s’en effrayer, quitte à devoir rappeler que les caractéristiques qui permettent de définir des groupes particuliers au sein d’une espèce – Humaine ou non-Humaine – ne sont pas de nature à connoter des valeurs philosophiques ou hiérarchique, positives ou négatives ; ces notions étant parfaitement dépourvues de sens dans les sciences du Vivant ou tout n’est que gènes, cascades biologiques, environnements, pression de sélection et adaptations. Loin des délires foisonnants de ceux qui le vénèrent ou de ceux qui le nient, le phénomène racial concerne toutes les espèces de notre planète dès lors qu’elles peuplent une aire géographique étendue. Lorsque le flux génique se réduit (notamment parce qu’un stress de la biosphère réduit la densité des individus et cantonne les survivants aux zones géographiques les moins impactées), la population initiale, jusque-là homogène, se fragmente et des caractéristiques différentes commencent à s’accumuler dans les groupes séparés. Ce phénomène naturel découle à la fois de mutations sans conséquence qui surviennent au hasard, et de mutations sélectionnées par la pression environnementale (par exemple, développement d’une stature trapue dans une région froide ou d’une stature longiligne dans une région chaude). Au fil du temps, si le flux génique n’est pas rapidement rétabli entre les groupes cousins autrefois séparés, ces légers changements deviennent majoritaires dans toute l’aire géographique isolée où ils sont apparus, et cela d’autant plus facilement que les populations survivantes sont peu nombreuses ; ce qui signifie qu’en quelque générations à peine, n’importe quel ‘’mutant’’ sera devenu l’ancêtre de toute la population de la région où il a fait souche ! Ensuite, lorsque les conditions environnementales s’améliorent, il apparait que les descendants des groupes épargnés par les crises de la biosphère sont devenus légèrement différents les uns des autres pour toute une série de caractéristiques. Une race, c’est simplement cela : une série de caractéristiques plus fortement représentées dans un groupe plutôt que dans un autre groupe. Ces différences ne sont jamais absolues (i.e. il existe toujours quelques individus longilignes dans le groupe des trapus, et inversement) et peuvent facilement se diluer si la panmixie est rétablie, c’est-à-dire si les unions redeviennent complètement aléatoires entre les membres d’une même espèce. Toutefois, en l’absence de moyens de transports modernes, la panmixie est illusoire lorsqu’on habite à 20.000 kilomètres les uns des autres, les uns dans des steppes glacées et les autres en bordures des forêts tropicales … Tout cela vaut pour les Humains autant que pour les Pâquerettes ; c’est un aspect des mécanismes adaptatifs qui ont permis à la Vie terrestre de se diversifier et de subsister sur le très long terme.
Ainsi, avant d’être un outil politique manié à tort et à travers, la race est tout simplement un ensemble de caractéristiques anthropologiques et génétiques qui sont surreprésentées dans une aire géographique donnée, comparativement à tout le reste du Monde. La vraie question n’est donc pas de savoir si les races humaines existent, mais combien de temps il faut pour que des caractéristiques différentes s’accumulent au point de pouvoir observer des groupes devenus suffisamment distincts pour être appelés ‘’races’’ ! Jusqu’à récemment, les chercheurs répondaient différemment à cette question selon qu’ils adhéraient au modèle d’une très longue évolution multirégionale (i.e. les groupes Humains actuels sont en filiation directe avec les groupes archaïques qui vivaient dans la même région qu’eux) ou au modèle d’une très courte évolution post out-of-Africa (i.e. les groupes Humains actuels ont développé leurs caractéristiques raciale depuis leur sortie d’Afrique il y a environ 100.000 ans, c’est-à-dire en 4000 générations seulement).
Mais la découverte des métissages anciens que nous venons d’exposer a considérablement rapproché ces deux positions. Ainsi, la question raciale peut aujourd’hui se poser dans les termes suivants : plutôt qu’une diversification des types humains modernes qui se serait produite spontanément et très rapidement après la sortie d’Afrique (en quelque dizaines de milliers d’années seulement), les différences raciales observées chez les Humains d’aujourd’hui ne résulteraient-elles pas essentiellement des métissages survenus entre les premiers migrants modernes et les Hommes archaïques qu’ils ont rencontré en chemin et qui avaient eu – eux – plusieurs centaines de milliers d’années pour se différencier dans leurs zones géographiques respectives ?
Dans la logique de cette hypothèse qui permet de ‘’donner du temps au temps’’, voici ce qui aurait pu se passer :
- Les caractéristiques ethniques des Capoïdes (Khoisans) d’aujourd’hui pourraient constituer le meilleur reflet de celles des premiers Homo sapiens sapiens, en dépit de métissages survenus très anciennement avec des Homo sapiens rhodesiensis d’Afrique du Sud, puis avec quelques-uns des Hommes modernes qui atteignirent ces régions beaucoup plus tard.
- Les caractéristiques ethniques des Africoïdes (ou Congoïdes ou Négroïdes) actuels pourraient avoir découlé de l’assimilation progressive des Homo sapiens rhodesiensis d’Afrique de l’Ouest, qui avaient peut-être eux-mêmes intégré un fort héritage de leurs prédécesseurs Homo heidelbergensis ? Vivant les uns et les autres dans des régions tropicales très ensoleillées, les premiers Humains modernes d’Afrique de l’Est et ces Hommes archaïques d’Afrique de l’Ouest étaient certainement mélanodermes les uns et les autres, à l’instar des Humains Africoïdes d’aujourd’hui. Il ne faut cependant pas se focaliser sur ce seul critère cutané qui saute aux yeux de chacun et qui a pour cela tant fasciné les Européens, les Asiatiques et les Africains eux-mêmes. Si nous parvenons, un jour, à connaître le génome des Hommes archaïques d’Afrique, la diversité de leurs legs aux Hommes modernes d’Afrique de l’Ouest pourra plus facilement être appréhendée.
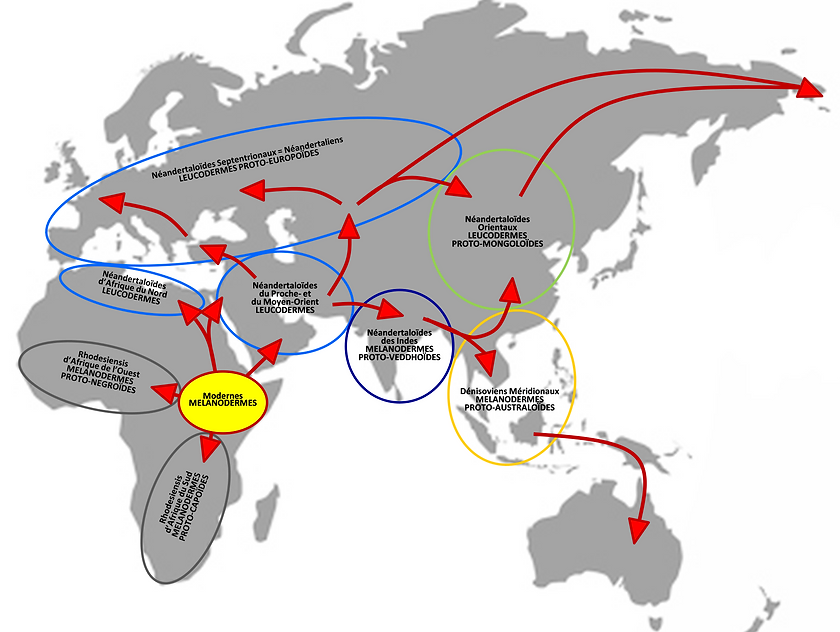
Carte
- Les caractéristiques ethniques des Europoïdes (ou Caucasoïdes) actuels pourraient – comme nous l’avons déjà dit – avoir découlé de l’assimilation progressive des Homo sapiens neanderthalensis d’Europe, d’Asie Centrale et de Sibérie occidentale par les premiers Hommes modernes qui colonisèrent ces régions au MIS 3. On pourrait même oser dire que le type anthropologique des anciens Néandertaliens d’Europe et de Sibérie était déjà *Proto-Europoïde ! Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner les reconstitutions ‘’forensic’’ récentes de Néandertaliens : malgré leur stature trapue et leurs visages grossiers pour nos standards, c’est davantage parmi les Europoïdes que parmi tout autre groupe racial actuel qu’on serait conduit à les classer si un seuil décisionnel spontané nous était demandé. Nous avons vu que la proportion de gènes Néandertaliens est aujourd’hui modeste chez les Européens ; bien plus modeste qu’au moment de la première colonisation de l’Europe par leurs ancêtres modernes. Cependant, elle semble être demeurée importante pour les gènes qui déterminent la couleur de la peau et des cheveux ; en rapport avec la synthèse de la vitamine D comme il a déjà été dit. Il faut cependant mentionner que des humains modernes à peau foncée pourraient avoir longtemps vécu en Europe, au moins jusqu’au seuil de l’époque néolithique : c’est au moins ce qui est postulé pour l’Espagne (La Brana, v. 5000 AEC) et pour la Grande-Bretagne (Cheddar, v. 8000 AEC). Si les données archéogénétiques sont correctement interprétées, cela pourrait signifier que les premiers Hommes modernes qui pénétrèrent en Europe avaient encore une peau assez foncée, et que les métissages avec les Néandertaliens leucodermes locaux n’ont pas été suffisants pour faire disparaitre rapidement cette caractéristique ?
- En Inde, les caractéristiques anthropologiques Veddhoïdes définissent le morphotype de certaines populations tribales du Deccan et du Sri-Lanka. Elles pourraient avoir eu pour base un type *Proto-Veddhoïde qui aurait été celui des Homo sapiens neanderthalensis indiens que nous pouvons supposer mélanodermes en raison du climat [cf. atlas n°2] ? Toutefois, l’absence quasi-totale de restes humains anciens en Inde, et notre complète ignorance du génome des indiens archaïques, ne permettent pas d’aller au-delà de la question. Force est cependant de constater que l’Inde du MIS 3 n’a pas subi le marasme technologique qui caractérisa très longtemps l’Asie du Sud-Est, et qu’elle fut même intégrée précocement au monde microlithique. Comme en maints autres points d’Eurasie, cette émergence relativement rapide d’une technologie avancée pourrait s’expliquer par la relative proximité génétique des Sapiens Néandertaloïdes indiens et des Sapiens modernes avec lesquels ils se sont métissés ; ce qui aurait facilité le travail de la pression de sélection en faveur des gènes ‘’normo-cognitifs’’. Au contraire, dans le ‘’puits cognitif’’ d’Asie du Sud-Est, les Hommes modernes se mêlèrent à des Hommes archaïques non-Sapiens dont les cognitions étaient sensiblement moins développées ; ce qui eut pour conséquence qu’il fallut plus longtemps pour voir (re)apparaître des populations ‘’normo-cognitives’’ [cf. carte Q] ?
- Les caractéristiques anthropologiques des Mongoloïdes (ou Asiatiques) actuels – dont la sinodontie – pourraient être un legs des Homo sapiens neanderthalensis d’Asie orientale septentrionale, qui avaient eux-mêmes intégré une partie du patrimoine génétique des Homo heidelbergensis septentrionaux / Dénisoviens septentrionaux [cf. atlas n°2]. Dans ce mélange ancien qui constituait un type *Proto-Mongoloïde, les gènes Néandertaliens prédominaient peut-être au Nord sur les gènes Dénisoviens . Tandis qu’en Chine du Sud, les proportions du mélange étaient peut-être plus équilibrées ?
- Les caractéristiques anthropologiques Australoïdes actuelles – dont la sundadontie – pourraient être le legs d’un type *Proto-Australoïde qui aurait été celui des Homo heidelbergensis méridionaux / Dénisoviens méridionaux du Sud-Est asiatique. Dans ces régions tropicales semblables à celles où vivaient les premiers Humains africains, la population archaïque pourrait avoir été plus dense qu’ailleurs, ce qui aurait peut-être rendu les occasions de métissages plus fréquentes et sur une plus longue durée ? Ceci pourrait expliquer pourquoi les populations Australoïdes actuelles sont celles qui expriment le taux le plus important de gènes archaïques (jusqu’à 7%). Ces Dénisoviens méridionaux pourraient avoir été plus archaïques que leurs cousins du Nord, dans le cas où ils auraient préalablement incorporés des gènes d’Homo erectus ? On ne peut que poser la question en l’absence absolue de connaissance sur l’ADN des Erectus ; mais on doit faire remarquer que dans l’ancien Sunda, les Homo erectus soloensis vécurent plus tardivement que partout ailleurs, jusqu’à la fin du MIS 6. De tous les Humains archaïques évoqués dans ces pages, ces Homo erectus étaient génétiquement les plus éloignés des premiers Hommes modernes dont ils s’étaient séparés de la souche près de 2.000.000 d’années plus tôt [cf. atlas n°2]. En raison de cette longue durée, ils pourraient avoir eu le temps de devenir une espèce humaine véritablement distincte de celle des Hommes actuels ? Nous avons cependant déjà dit que la notion d’espèces temporelles ne peut être que théorique en l’absence de machine à remonter le temps, et que – de proche en proche – un flux génique à quand même très bien pu s’établir jusqu’à nous via les Dénisoviens méridionaux !
Permettons-nous encore réflexion sur les races. Si notre hypothèse est vraie, cela signifie que, vagues migratoires après vagues migratoires, les génomes anciens d’une région donnée n’ont jamais cessés d’être transmis aux groupes humains plus récents qui se sont succédés dans cette même région ; exactement comme un témoin qui passe de main en main dans une course de relai ! Les races humaines actuelles nous offrent un reflet pâli mais toujours bien visible de ce à quoi ressemblaient physiquement et physiologiquement les races archaïques d’autrefois !
Histoires parallèles
Sommes-nous cognitivement différents des premiers Hommes modernes ? Autrement dit, après que la pression de sélection ait enfin rendu aux Eurasiens les cognitions de leurs ancêtres modernes Africains, ceux-ci s’en sont-ils contentés ou ont-ils continué à renforcer toujours davantage leurs compétences cognitives jusqu’au niveau que nous mesurons aujourd’hui ? Et dans ce cas, ont-ils évolué en parallèle de partout sur la planète puisque, malgré des controverses, rien n’est venu démontrer consensuellement l’existence de cognitions plus performantes chez l’un ou l’autre des groupes Humains actuels ? Il n’y a pas encore de réponse à ces questions. Mais il n’est pas impossible que l’apparition des facultés d’innovation ait été le point de départ d’un emballement cognitif qui aurait été convergent dans les différentes peuplades. C’est le besoin de l’emporter sur son prochain – où que l’on vive sur terre – qui pourrait avoir été le moteur de cette pression de sélection dont résultait la mise au point de meilleures techniques qui augmentaient progressivement les chances de victoires guerrières et donc de reproduction ? Il est possible que les progrès de la génétique et de l’archéogénétique nous permettent un jour de dire si les progrès technologiques croissants et l’accélération progressive de ces progrès se sont faits à ‘’cognitions constantes’’ ? Ou bien à califourchon sur des cognitions qui ont grimpé la colline au galop ?
Au point où nous sommes parvenus, il est grand temps d’entrer dans le vif du sujet en commençant à dérouler le fil du temps qui sera scandé par les grandes oscillations climatiques. L’atlas n°3 est un essai qui tente de regrouper nos connaissances fragmentaires et de produire une histoire continue cohérente à l’aide d’une approche où les données issues de champs différents contraignent mutuellement les gros fils de la trame. Cependant, de nombreux trous demeurent par lesquels la vérité peut facilement s’échapper. En particulier, les mouvements et les dates que nous proposons pour expliquer la répartition actuelle des haplogroupes sont en grande partie hypothétiques. Il serait donc bien présomptueux d’affirmer que ce que nous allons relater est bien ce qui s’est réellement passé entre v. 115.000 et 9.600 AEC, c’est-à-dire entre 4680 à 464 générations avant nous. Espérons cependant, que notre reconstitution en est au moins le reflet.